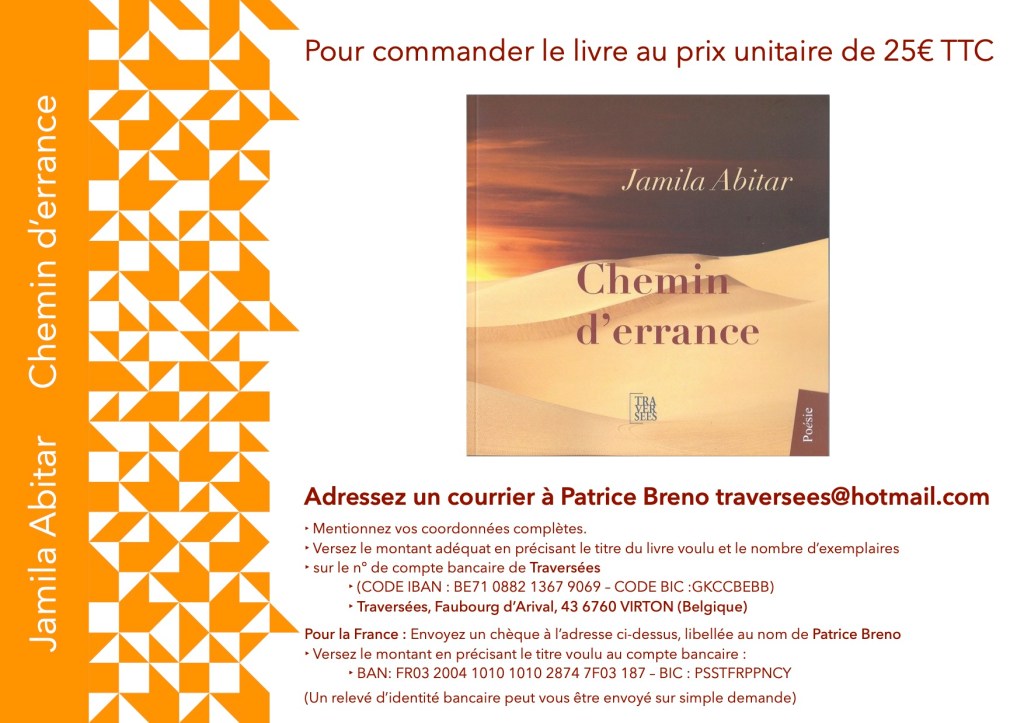Une chronique de Marc Wetzel

Jamila ABITAR – Chemin d’errance – Traversées, 2022, 60 pages, 25€
« Vous referez mon nom et mon image
De mille corps emportés par le jour,
Vive unité sans nom et sans visage,
Coeur de l’esprit, ô centre du mirage
Très haut amour » (Catherine Pozzi)
« Je perds la chronologie
et perçois l’être vivant.
J’ai puisé tous mes rêves
dans l’invocation de l’Unité
et c’est dans l’Union
que j’ai brûlé le temps » (Chemin d’errance, p.54)
Il y a relativement peu de poétesses d’origine arabe dans la poésie française actuelle, et chaque émergence intéresse et instruit. Chez les jeunes hommes, plus nombreux à s’exprimer, le rap surtout permet un équilibre poétique entre engagement socio-politique et fidélité religieuse ou spirituelle (on peut y dénoncer ce que la France fait des coutumes ou des attitudes de vie qui ne sont pas nées d’elle, dans une langue retournée ironiquement, ou agressivement, contre sa propre souveraineté butée). Mais le rap reste pour l’essentiel masculin, car il ne peut combattre le rapport de la langue française à elle-même sans, peu ou prou, la combattre tout court. Les poétesses ont, elles, d’autres moyens, plus malaisés mais plus discrets et nuancés. De toute façon, les sentiments dominants dans ce recueil (la gratitude, la joie, la confiance, l’humilité, la perplexité) ne sont pas choses « rappables ». Et puis cette poète, elle, paraît compter sur la société et la vie pour la délivrer de sa fièvre poétique, et non l’inverse ! Lui importe le sang qu’elle héberge (« j’ai pris mon sang pour ma plume« , p.25), non celui qu’elle verse; et elle vit sa propre force poétique comme une troublante malédiction, comme si ce qui l’anime alors la forçait (douloureusement) à se dresser contre elle-même. Le chemin littéraire lui est spontanément comme une errance vitale : le droit que vient prendre son talent lui est trahison de ce qu’elle devait rester. Elle ne chante donc pas délibérément, mais ce qui la dépasse se sert d’elle (sans grand ménagement ?) pour se manifester. Trois courts passages le disent assez :
« J’aurais aimé ne pas être poète.
Ne jamais rencontrer sa flèche
à l’angle d’un souvenir
et tomber dans ce puits
de mythes » (p.54)
« Le poème n’est pas l’objet que l’on travaille,
nous sommes l’objet de son travail.
Il s’impose comme une vérité nue
et renverse parfois l’ordre établi » (p.52)
« Qui pourra me libérer
de cette âme poétique
emprisonnée dans mon sang ?
Je me perds dans la logique du dialogue,
je reconnais l’exil de moi-même,
le pas à pas d’une culture » (p. 32)
Cet « exil de soi-même » est chose complexe, et remarquablement sincère. C’est à la fois le déchirement d’une inspiration qui, par principe, entraîne trop loin, fait prendre langue avec ce qui nous échappe, amène là où notre passé n’est pas prêt; c’est aussi le tranchant d’une transplantation : de la lisière marrakchie du désert aux bureaux de l’Unesco ou aux bibliothèques de Cachan, se saisir de ce qui nous aura fait vivre (ce dont est comptable tout effort poétique) forme voie aiguë et périlleuse : la parole doit à la fois choisir sa direction (pour se mettre en chemin), la distance à parcourir (le bout de chemin à authentiquement faire), son intensité (pour se frayer quelque chose d’à la fois vivable et sensé dans ce qu’on explore), et rien n’est jamais joué, car la greffe des rêves successifs doit, dans la poésie, impérativement prendre : on ne peut s’y permettre le luxe de voir en nous rejetés les éléments de monde qu’on prend le risque constant de s’adjoindre. Parfois la largeur d’esprit qu’un poète exige de soi l’épuise (on laisse un instant filer la délicate identité à construire : « J’aime cette quiétude/ de ne plus être moi » p.53), mais l’irremplaçable cadeau de la poésie (parole qui permet à l’être de « toucher » ce qui n’est pourtant qu’à l’intérieur de lui, de « visiter l’indicible espace du dedans » (p.50) héroïquement.) ne peut plus se refuser bien longtemps. Jamila Abitar trouve là des accents d’une merveilleuse justesse, d’autant qu’avec la sincérité unique de la rescapée, elle fut aussi, à chaque fin de « désastre », sa seule confidente assurée. L’intimité blessée, et résiliente, réagit alors comme universellement à elle-même :
« Etendre le verbe à sa fonction la plus noble
et attendre qu’un vers tombe d’un nuage de légendes.
Braver les feuilles mortes
et disparaître dans le décor.
Aimer l’éclair d’un instant
mourir sans l’ombre d’un silence.
Mourir, en permanence dans le silence.
Suspendre l’envol, la fulgurance dans son instantanéité
et traduire en larmes ce qui n’aurait pu être écrit.
Le poème respecte les règles de la nature,
dans la joie, il l’emporte ! » (p.45)
Malgré l’obscure richesse du propos, tout importe ici. La noblesse est vivante (la noblesse consiste à se sentir fait(e) pour le meilleur. Ce que l’on sait du Bien, le faciliter et travailler à le répandre : voilà l’office « noble » – oui, chevaleresque et solennel – qui se fait devoir de mériter tout rang auquel prétendre, et ne fait blason de conduite que de sa seule bonne volonté ! L’exigence de la poète éclate partout : toute devise facile à vivre serait publicitaire ou illusoire). Sa résistance est résolue, mais respectueuse : « Aucune résistance n’est plus forte/ que celle qui échappe à la mort » dit tranquillement la page 51 : cela veut dire que résister à la mort fait savoir infailliblement à quoi exactement obéir valablement à et dans la vie; et il s’agit bien de résister à la mort de sa conscience, non à une vie d’elle qu’on voudrait se cacher, comme le patient du divan « résiste » à tort parce qu’il ne veut pas entendre parler de la vie réelle de sa conscience ! Le refoulement, dit-on, décide (ruineusement) de supprimer toutes les images pour s’en cacher sûrement une seule, alors que la parole de la poète voit et veut l’inverse :
« S’écrit le poème,
vent violent
assis sur un nuage de consciences.
Les poètes sont les témoins de l’image perdue.
Ils tentent de la restituer dans toute sa véracité (…)
Un tas d’immensités égaré dans le vide,
dans un rien, où l’on trouve le mot à dire » (p.44)
J’ignore s’il y a une tonalité arabo-musulmane propre à l’existence dans ce qui est chanté ici; le réalisme spirituel (en Occident, les croyants revendiquent leur âme, les athées la réfutent – mais ici notre poète se demande plus prosaïquement si elle serait d’abord digne d’avoir usage de l’une d’elles) en tout cas impressionne. La tension avec l’environnement laïque est formulée (et apprivoisée) de manière fine et surprenante :
« Marche exilée
De tout temps, j’ai porté des voiles pour assurer
à ma démarche, une part de féminité.
Je porte toujours l’habit qui rappelle
le dernier instant » (p.31)
De même, le multilinguisme heureux trouve matière à (p.19) faire se connaître des langues entre elles dans le locuteur, et fait de la poésie (p.13) l’amorce sûre de leur naissant goût mutuel. Dans la poète même, peut-être, la langue arabe est son orient (« l’éternel regard du soleil levant » p.33), qui laisse ensuite se déployer librement, hors d’elle, la course « française » du sens jusqu’à son logique crépuscule. De toute façon, on ne comprendra pas tout, mais (admiratifs, et reconnaissants) on s’inclinera, car si bien des aveux, c’est vrai, restent (pour l’instant ?) ici mystérieux, cela signifie pourtant qu’à chaque fois, par cette poète vaillante et délicate, rude et raffinée, le mystère est, pour nous, passé aux aveux :
« J’ai vu la stupeur remplir leurs yeux,
rebrousser chemin.
Il faut être du pays pour parler aux pierres.
Il faut être d’ailleurs pour reconnaître les fleuves.
D’où je viens,
la brise du matin est une évidence.
La musique est noble et atteint des hauteurs
que seule l’ivresse ou la langue peuvent approcher.
C’est ici et maintenant que se joue le verbe,
dans une ultime déraison, je touche son nom.
S’élargissent les mots, les pleurs et la censure.
Aurions-nous tort de croire au seul pouvoir des mots ? » (p.37)
©Marc Wetzel