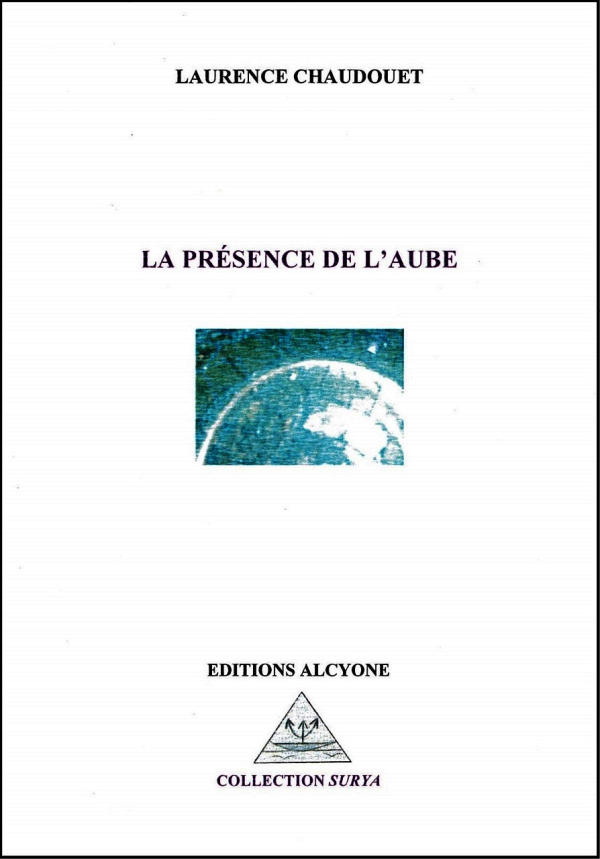Une chronique de Xavier Bordes

GWEN GARNIER-DUGUY Enterre la parole, suivi de La nuit phoenix – Poèmes (Ed. De Corlevour – Revue NUNC – Lettre et postface de Jean Maison.)
Il y a chez ce poète une passion intime pour la vie, dans le sens exaltant du terme, qui depuis que je le connais me convainc par son ton de sincérité. Élan secrètement métaphysique ou foi discrète, cela n’altère pas son écriture mais on sent son langage imprégné par une sorte de capillarité venue des profondeurs, qui m’évoque en moins tourmenté, Baudelaire parlant du secret de son oeuvre comme recelant « un autel souterrain au fond de sa détresse ». Sans me sentir capable d’une vue sur la poésie de Gwen G-D. aussi pénétrante et synthétique que celle du poète Jean Maison, son aîné et ami, lequel nous éclaire dans le livre à deux reprises par des pages de commentaires denses, j’en ai instinctivement éprouvé l’enthousiasme (au sens de l’en-thusiasmos grec), la joyeuse richesse, dans ce double recueil (le premier comme le second titre étant assemblés en un seul volume). Se présentent ainsi deux faces de son talent, celle du rapport poétique au monde extérieur et à la nature, d’une part, et de l’autre du rapport au monde intérieur et à l’incarnation de la nature dans la figure d’une femme aimée. Si la face extérieure du « naturel » conduit vers l’intériorité de la proximité à la présence aimée, cette même intériorité reconduit vers le monde extérieur, et rejaillit sur les choses : « Ton âme ce soir allumera le firmament… » énonce hardiment (p. 139) notre ami Gwen, en une phrase quasi-conclusive de « La nuit phoenix », – qui aussi bien est une ardente nuit androgyne ! Il y à là un battement, une alternance, qui prendra forme, se matérialisera typographiquement, dans « la Nuit phoenix ».
Sous le premier titre, Enterre la parole, injonction que l’auteur s’adresse à lui-même sans doute, réside l’idée qu’il s’agit de semer du poème, de le disséminer en prévision de sa germination dans les consciences, et de l’épanouissement de son sens en osmose avec elles. Y affleure cependant l’idée que la poésie participe aussi physiquement, par le corps, à qui la reçoit : le corps humain créé, selon le mythe, à partir d’argile liée, de poussière terrestre informée (« ta main d’humus »), animée, grâce à la salive du verbe. Ce sont donc des poèmes généralement brefs, quelques grains d’un langage clos mais prêt à livrer l’amorce énergétique, le germe d’optimisme éventuel, qui sont latents dans le noyau de chacun d’entre eux… Avec innocence et simplicité. Je voudrais en faire lire trois, qui donnent quelque peu le ton et balisent l’espace mental du premier recueil :
P. 14 La guerre en cours invente
des combattants sans uniforme.
Impossible de distinguer
l’ennemi de l’allié.
Peut-être somme-nous
Nos propres ennemis.
Ceci, c’était pour la réflexion éthique. À présent pour la beauté des images et du symbole druidique :
Ta marche approfondit le territoire.
C’est hier que tu es entré dans ce royaume d’arbres
et quand tu parles à haute voix
l’écho te renvoie une présence ancienne.
Tu as suivi les charmes.
Ils t’ont conduit
au miroir d’eau.
En te penchant pour boire
tu vois des ramures à ton front.
Une tourterelle y déploie ton ondoiement.
Et maintenant, pour la troisième composante, que j’appellerais la positivité joyeuse :
Un merle offre son chant
brisant les à-quoi-bon.
Sa joie est preuve
comme au premier matin.
La vie est là.
La ferveur de ses trilles
renouvelle la terre.
Point de fioritures, mais une ferveur d’exister, de naître et renaître par cela que le poète appelle un « bouche à bouche nuptial », en lequel fusionnent sa vie, sa poésie, le cosmos, et l’amour qu’il porte à tout cela. Fusion qui est celle qui sans doute l’a entraîné vers « la nuit phoenix » : je note que selon lui, le poète-cerf (cf. la richesse symbolique portée depuis la nuit des temps – en attestent la figure homme-cerf des grottes préhistoriques – par cet animal emblématique) ne doit pas « s’attendre à un autre poème que celui de sa vie ». Et de la figure du cerf découle « la joie impatiente / d’embrasser la femme. » Il était donc logique de découvrir que la seconde moitié du livre, le second recueil, fût dédiée à « Pauline », et l’on comprend alors que des proses poétiques en italiques aient en face l’écho d’une autre prose en romaines, à l’instar d’une sorte de liturgie « en couple » avec répons et correspondances. Dans le langage, il y a un et deux ensemble, une page se repliant sur l’autre page. À la différence constituant le couple, l’écrit, donc la langue qui dit, réagit en dispensant le lieu de l’unicité, de l’androgynie dont je parlais. Mais je n’évoque cela qu’en passant, parce que c’est l’ambiance, la toile de fond, le sentiment dominant. Ce qui apparaît de ma part comme une interprétation un peu sophistiquée se manifeste en revanche par une belle simplicité dans les textes, par une touchante intimité, pudique et noble, d’insistante présence.
La conscience, lorsqu’elle est imbibée de cette dimension parasite qu’on nomme poésie, reste toujours étonnée, légèrement distanciée, de ce qui lui apparaît comme miracle incessamment renouvelé, entre homme et femme : ici, « l’amour ». Un certain amour. Non pas un amour de livre ou de roman, plutôt un amour qui transfuse sa vertu alchimique au langage, preuve journalière et songerie hors du temps. C’est ainsi en tout cas que je reçois cet autre versant du recueil. L’aval était l’effusion dans la Circonstance, autrement dit l’intuition de la relation avec la Nature, l’amont est le chemin dialogué entre deux personnes au sein de la force qui les aimante et les tient associés, force dont la Maison « bâtie au bord du Finistère » assume le rôle de symbole, de site où y ait lieu d’être ensemble… Un peu comme la source qui a vu naître un saumon est aussi l’endroit vers lequel il s’efforce de retourner, hanté par le besoin de remonter vers l’Origine. De sorte que, de la traversée du livre, donc des moments chiffrés d’une vie poétisante, on peut dire comme le fit Mallarmé dans son Coup de dés, « Rien n’aura eu lieu / que le lieu… » Toutefois, le lieu d’un amour. Ce qui hisse à une altitude poétique respectable le livre singulier de notre ami Gwen Garnier-Duguy, que j’ai eu plaisir à saluer ici.
Xavier Bordes (Opio, août 2019)