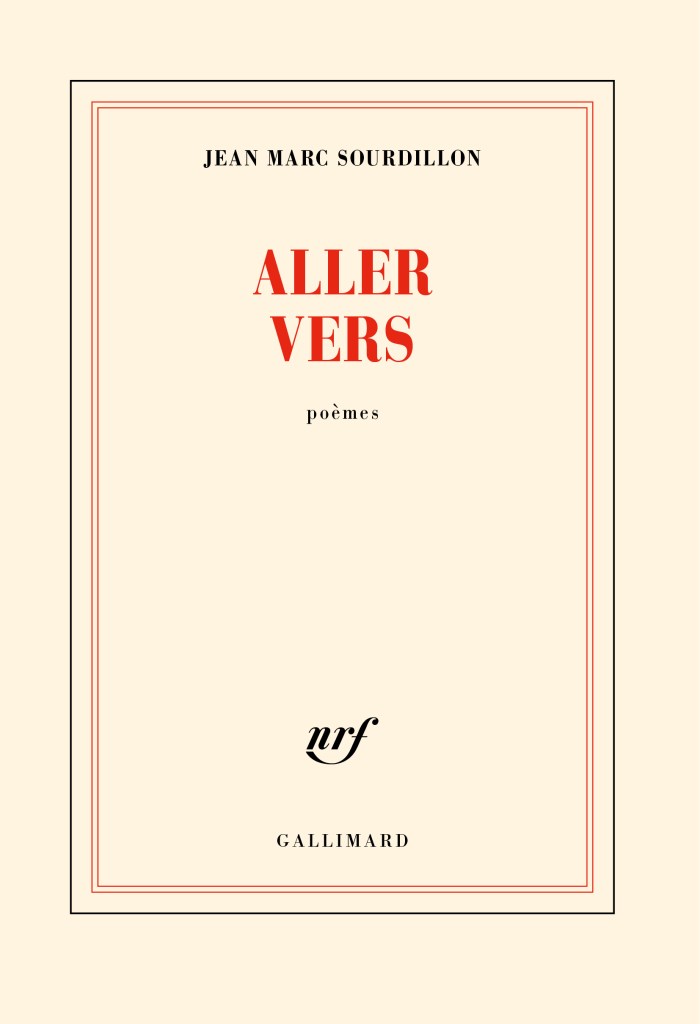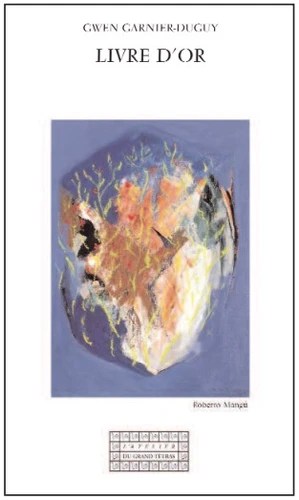Une chronique de Xavier Bordes
Jean Marc Sourdillon, ALLER VERS, poèmes, (Coll. Blanche NRF, Gallimard.)
Voici un recueil au titre à la fois limpide, et qui intrigue, tout en donnant le sentiment à l’oreille, d’une injonction déguisée, à soi-même certes, mais peut-être aussi au livre lui-même, en manière de bouteille à la mer, si on l’entend comme « allez, [mes] vers ! » Mais vers quoi l’élan des vers se trouve-t-il lancé ? Au fil de la lecture on a le sentiment d’un secret torrent de questions dont à l’examen chacune se disperse en absence de réponse, ouvrant sur un infini qu’il serait inopérant – ou superflu ? – de vouloir nommer. Comme un « influx de vigueur et de tendresse réelle » qui s’épanouit en éventail, ou plutôt en delta, à l’endroit de rejoindre la mer. Au passage, on ne s’étonnera pas que Jean Marc Sourdillon, de son propre aveu, ait très tôt rencontré une dimension particulière de la poésie à travers un poète qu’on disait « mystique sans Dieu », à savoir Joe (sans tréma, il y tenait) Bousquet, l’ermite de Carcassonne, dont la dimension au sein du paysage littéraire du XXième siècle grandit avec le temps…
Le recueil est fait de quatre sections précédées d’un prologue, « les bondissants » ; des entités énigmatiques, invisibles, qui semblent bondir dans « l’Ouvert » rilkéen, êtres qui « s’enlèvent » et ouvrent la marche en s’éparpillant, pour ainsi dire. Ils devancent l’auteur, apparemment, puisque le prologue, de façon assez éclairante sur sa démarche, s’achève ainsi : « Moi j’étais toujours là, je marchais sur le chemin seulement précédé par eux, avec ce son, ce souvenir à l’intérieur, comme un écho, comme une annonce de ma propre force, de mon propre élan, de cette capacité que nous avons de nous relever, de bondir sans jamais retomber, de poursuivre le bond en essayant de répondre du mieux que nous pouvons à l’imperceptible, à l’imprévisible appel qui toujours nous devance, toujours nous élève. »(P. 14) L’on devine alors qu’il s’agira d’un bond initiatique, l’histoire d’un saut tout ensemble dans la vie et dans la langue, comme celui du poète Élytis disant dans Marie des Brumes : « J’ai voulu tenter un saut plus vif que l’usure (des choses) ».
La première section « Chercher qui me cherche », placée sous l’exergue d’une citation d‘Alejandra Pizarnik, la poétesse argentine, autour du thème de la soif rimbaldienne page 20, amène la quête à devenir proprement quête poétique, en page 26 : « Et j’ai commencé à voir. Non pas toi, non, ni ton visage, ni tes mains, ni ton allure, mais le monde, mais les êtres à travers toi. Comme si la vitre s’était soudain lavée ou brisée.[..] Comme si mon vide d’un coup s’était peuplé de présences toutes proches qu’il fallait chercher. » Et vient la nouvelle section intitulée « Seines » au pluriel, qu’on entend aussi comme « scènes », le fleuve portant la figure du temps qui passe et, comme un souvenir du « Pont Mirabeau » d’Apollinaire, de ce «regard sur la beauté » (mira-beau), figure de la rencontre amoureuse qui débouche sur quelque chose d’immense : l’être aimé à « visage d’estuaire si différent » (P.46) – « estuaire » un mot qui revient, symbole du passage vers l’éventail infini des possibles. Éventail qui est mystique de la vie elle-même.
Désormais voici que l’élan diversificateur, jusqu’alors canalisé entre les berges, gagne l’espace aventureux, celui de l’avenir sans protection, celui du risque. L’espace des « Désabrités », nouvelle section, illustre cette situation qu’un passage (p.62) caractérise : « Je veux être celui qui dit oui, qui fait confiance et que constamment, dans tes rêves, tes insomnies tu vois présent à tes côtés, tel qu’il est, sans tricherie, / je veux être consentant. » Cette partie s’achève (p.73) sur une vision « Fra Angélique » : « Tu lèves les yeux de ton travail et tu perçois tout proche, comme un froissis, un chuchotement complice, ou loin là-bas, dans les profondeurs du coeur, comme un appel, ce scintillement qui te fait vivre ». Naturellement, on entre alors dans le grand poème « L’espace où naître », à partir duquel survient la maturité de vivre, « sur le fil », dernière section de ce parcours initiant à la vie poétiquement vécue en ce monde-ci : sous-entendant que toute vie humaine est funambulesque, que l’on en soit ou non conscient. « Je suis sur le fil de toi et je vais vers » dit le cinquième des neuf derniers poèmes qui achèvent le livre. Sur un fil comportant évidemment deux versants comme dit le poème IX : « Ainsi chaque instant est celui des retrouvailles, de la perte et des retrouvailles. Toi et moi c’est bonjour et au-revoir à la fois, une rencontre renouvelée dans une séparation supposée. […] Il y a vers / Ce vers quoi tout converge et qui est notre commencement / Va au diable Vauvert ou peut-être vers Dieu et son paradis vert. / Va vers le bout de la ligne, de toutes les lignes, de l’absence de ligne, va vers et ouvre-toi selon ce vers qui te déchire et te révèle./ La lame de vers »
Et c’est sur ce jeu autour du phonème « vers » que se conclut le trajet du recueil, trajet plein de rencontres et riche de trouvailles poétiques savoureuses et profondes à la fois. Un recueil que j’ai lu avec un sentiment de proximité, presque de consanguinité d’inspiration ; les passages assez nombreux que j’ai cités ne sont que les jalons, disons réduits à l’os, d’un parcours concret, charnel, imagé, original ; une voix où résonne l’authenticité du vécu, sous-tendue d’un élan de positivité lucide qui m’a poussé à en vanter ici les qualités. J’ai apprécié l’aestus de cet estuaire, ce bouillonnement de vie qui, de tout son Ineffable, investit une existence – la poésie étant l’accès à un vivre autrement – et dont rend si bien compte la langue-en-poèmes de Jean Marc Sourdillon.