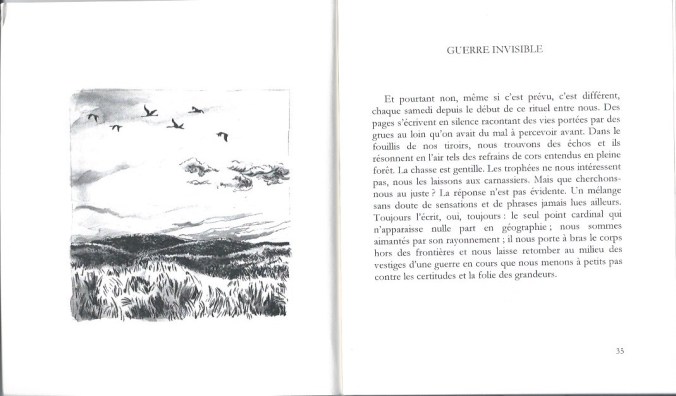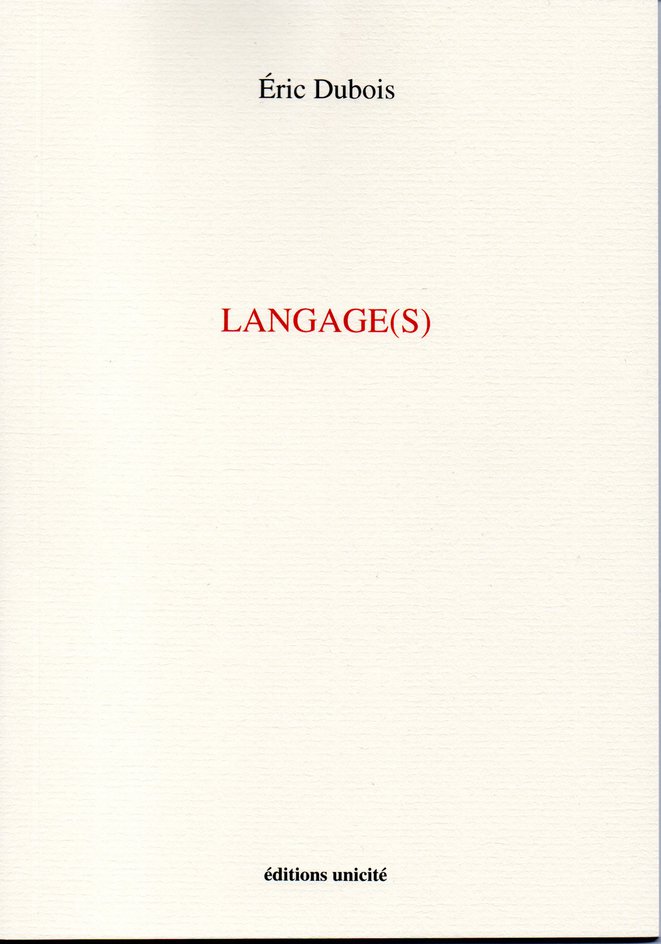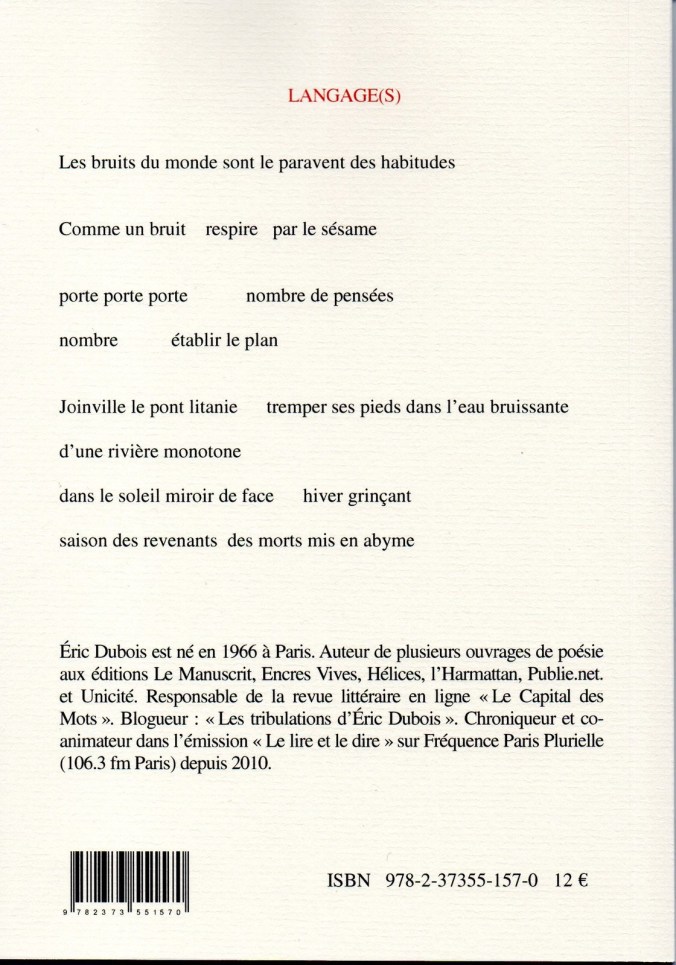Chronique de Lieven Callant

écrire-lire-écrire-lire
J’aime les questionnaires pour ce qu’ils ont d’insolite, parce qu’il réside souvent en eux le désir d’ordonner, de déterminer, de classifier ou de récompenser selon les éventuelles réponses que le questionneur attend et reçoit. Je participe aux jeux des questions bien souvent par goût de la déroute, de l’aventure des réponses qui induisent d’autres questions mais aussi et surtout pour me surprendre et apprendre à mieux me connaitre et à mesurer plus finement mes rapports aux autres, au monde qui m’entoure et me façonne.
Le questionnaire proposé ici par Eric Poindron se donne pour buts, ceux de susciter la curiosité, de réveiller l’imagination, d’emmener ses lecteurs sur les pistes de l’écriture, des écritures car l’on peut fort bien en guise de réponses proposer des schémas, des dessins, des peintures, des cartes, des rêves, des silences. L’auteur a pourtant instauré une règle ou deux et entre autres, celle de répondre en une minute à une question et donc en une heure aux soixante questions que contient le livre. Mais nous savons tous au moins depuis Proust que « Le temps est élastique » et que, comme à tous les jeux, on peut librement choisir d’adapter les règles. Eric Poindron cherche surtout à stimuler un rapport créatif aux textes, aux lectures qui se transformeraient volontiers en écritures étranges, étrangères à elles-mêmes, polysémiques, incongrues, surprenantes, détaillées ou allusives, poétiques, bavardes ou loufoques.
Le livre est jalonné de citations, d’évocations à d’autres oeuvres comme autant d’indices pour nous aider à parcourir les chemins sinueux de la lecture et de l’écriture.
Bien souvent lire un livre entraine pour moi la lecture d’un autre et d’encore un autre livre. Mes envies ne cessent de grossir et de se transformer et parfois de me permettre d’ inventer dans leurs marges, entre leurs lignes mes propres livres à l’instar de cet autre écrivain dont j’ admire le style, la clarté. Si écrire est avant tout se lire, s’interroger, c’est aussi et sans doute avant tout interroger l’autre, son style, ses choix littéraires, sa panoplie de mots, s’inviter dans la vie. Ainsi je bondis d’une question à une autre, d’un livre à plein d’autres.
Voici deux des nombreuses citations que comporte le livre de Poindron.
« Sur la mer, la nuit ne vient jamais d’en haut, elle monte des vagues, et l’on dirait que l’eau devient les nuages, un ciel renversé » Rachilde, La tour d’amour.
« Nous n’avons jamais appartenus à l’aurore. Nous sommes frileux et de vol lourd, rapides à nous dissimuler dans les trous des murailles et ne guettant jamais que de petites proies. Nous sommes la chauve-souris sinistre et prudente des crépuscules, l’oiseau d’expérience et de sagesse, qui sort après la rumeur du jour et craint jusqu’aux ténèbres qu’il annonce. il nous convient de nous appeler nous-mêmes crépusculaires. » Roger Caillois, Collectionneur de pierres, les êtres de crépuscule » Fata morgana, 2016
Le livre est aussi agrémenté d’images, souvent des photomontages à partir d’anciennes photographies dans lesquelles s’invite l’auteur et par la même occasion dévoile un autre aspect de son univers. Il est régulièrement fait allusion aux collections fantasques et fantastiques que comportent les cabinets de curiosités. Evidemment, pour être amateur de voyages en tous genres et explorateurs d’idées, il ne nous est pas demandé de posséder le moindre objet et encore moins d’en ramener de ses voyages malgré l’insistance de l’auteur. Mes collections d’ailleurs sont virtuelles et se composent pour l’essentiel de rêves et d’idées. On trouve sur le net de multiples endroits où les partager.
Le livre de Poindron s’invite donc partout, il n’est pas nécessaire même si c’est bien utile d’être un génie, un magicien ou un collectionneur de connaissances, un érudit, un écrivain, un philosophe. Il libère ce qui est en nous. Secrètement ou consciemment. C’est une invitation au voyage au centre de l’écriture et si possible au centre de l’écriture la plus étrange. D’ailleurs qu’est-ce que l’étrange?
Chaque lecteur peut s’il le souhaite faire parvenir ses réponses, ses questions à l’auteur qui est aussi « éditeur, écrivain, piéton, animateur d’ateliers d’écritures, critique et cryptobibliopathonomade ainsi que le curieux gardien d’un cabinet de curiosités ».
Pour vous donner envie de participer au joyeux élan initié par Eric Poindron voici dans le désordre quelques unes des questions et mes réponses.
Que savez-vous de la crypthobiblionomadie ou « égarement clinique à travers les livres qui n’existent pas » — & quels sont les trois livres qui n’existent pas que vous voudriez lire & quels en seraient les thèmes?
Je ne sais rien.
Je ne sais rien des égarements cliniques et je préfère ne pas chercher à découvrir de nouvelles pathologies, inventées pour normaliser les êtres vivants et leurs éventuels égarements.
3 livres: Le premier, je ne le lirai probablement pas mais il pourrait peut-être s’avérer utile à une partie de l’humanité. La Bible et le Coran et autres foutaises religieuses revus et corrigés par toutes les Divinités de l’Olympe.
Le deuxième: Le livre que Rimbaud rêvait d’écrire sur ses découvertes africaines – cartes, analyses, éléments de géographie, traductions de l’inconnu.
Le troisième: A la Recherche du temps perdu, tel que le livre aurait dû être si Proust avait eu le temps de le terminer.
Tous auraient pour thème la poésie, l’écriture, le temps.
Quel est en dehors de « la nuit avait l’allure d’un cri de loup », le bruit le plus étrange que vous ayez entendu?
Le cri d’un tigre maintenu en cage contre sa volonté.
Puissante alliance de lucide colère et de profond désespoir.
Depuis je l’entends toujours au fond de moi. J’ai un jour entendu aussi un homme pleurer et crier d’une manière similaire, ses larmes, ses sanglots invisibles creusaient un tombeau, remuaient la terre pour rien.
Rien ni personne ne veut et ne peut libérer le tigre.
Croyez-vous aux fantômes et croyez-vous que les fantômes croient en nous?
Je suis un spectre et j’ai une totale confiance en le genre humain. Les hommes et non les fantômes ont besoin de quelqu’un qui croit en eux sans l’ombre d’un doute et sans poser la moindre condition. Un sage chinois a d’ailleurs écrit « la confiance est totale ou n’est pas »
Que voyez-vous sur les murs de la pièce où vous vous trouvez et qu’aimeriez-vous voir sur les murs?
Un tableau de Jasper Johns, Zéro through nine, voilà ce que je vois.
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9/ un début de L’infini /
Est-il possible d’aimer autre chose que l’infini ?
Qu’avez-vous vu d’étrange et qu’avez-vous fait d’étrange ou de très étrange aujourd’hui ou ces derniers jours?
Mon coeur comme une luciole se balançait dans le noir en croyant être seul au monde jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’il était la petite lumière suspendue devant la gueule d’un monstre qui se nourrissait grâce à lui et à sa petite lumière.
Pour conclure ma chronique, j’aimerais rappeler le risque caché derrière tout questionnaire. Aussi ouvert soit-il, il espère, anticipe ou favorise toujours un certain type de réponses, il imagine rarement ce que le questionneur n’est pas en mesure d’imaginer ou de prévoir car nous avons tous et chacun nos limites et nos cadres de références. C’est peut-être là que réside la grande leçon de la lecture et de l’écriture, celle de nous apprendre à reconnaître nos limites pour s’intéresser à celles de l’autre et qui nous dépassent totalement. La curiosité est à mon avis une des plus belles et plus utiles formes de l’intelligence et elle est accessible à tous.
©Lieven Callant