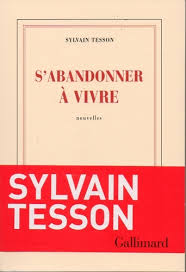Chronique de Nadine Doyen
La terre qui penche, Carole Martinez, roman, nrf Gallimard, (366 pages – 20€)
Qui n’a pas été embobeliné par le roman précédent Du domaine des murmures ?
Carole Martinez nous replonge dans ce décor envoûtant, quelques siècles plus tard.
Elle campe ses personnages au quatorzième siècle, époque qui connut les ravages de la peste et elle nous rappelle la condition de la femme et des jeunes filles.
Comme au théâtre, le voile laiteux de la brume matinale se déchire et s’ouvre sur la rivière. Mais la Loue, personnage à part entière, aussi « enchanteresse » que la Lorelei, capable de caresses comme de colères, a pris un aspect inquiétant. Pourquoi « une telle rogne » de « Furieuse » ? Affamée comme une ogresse, elle dévore ceux qui se risquent sur son dos. Quel sortilège a pétrifié ses eaux vertes ?
De qui veut-elle se venger ? Qui est cette Dame verte qui parfois en surgit ?
On découvre ce paysage de coteaux en pente, cette « terre qui penche », qui ravine par temps d’orage, toujours à reconstruire. « Les ceps disposés en espaliers s’enflent de lumière. » Surplombant la Loue, le domaine des Murmures et sa roseraie.
L’originalité du récit réside dans cette alternance des deux voix qui partagent la même couche : La vieille âme, à la mémoire défaillante et la petite fille, « petite, rousse et bouclée » qui n’a pas connu sa mère. C’est le plus souvent vêtue d’une « petite chemise » que l’on croise Blanche, « petit tas de tissus silencieux », « fragile ».
Par ces deux voix se déplie leur histoire commune et se tisse la vie de Blanche, la rebelle qui refuse sa condition de fille, contrainte de « filer, broder, prier, chanter ». Pas facile de convaincre un père dominateur, mais elle arrive à ses fins : savoir lire et écrire son nom, grâce à la patience de son précepteur Maître Claude.
La vieille âme revisite ses souvenirs, son enfance, s’émerveillant d’entendre Blanche « conjuguer jadis au présent ». Une résurgence de son passé riche en surprises.
On suit Blanche, « la fluette », « la transparente », à l’âge de l’innocence jusqu’à ce que son père décide de la marier à Aymon, dit « le Simple », un inconnu pour elle.
On est témoin des adieux déchirants, sa nourrice regrettant déjà son « Oiselot ».
Et voilà le lecteur embarqué dans un trajet plein d’embûches, où le diable malin et filou, en embuscade, peut surgir, avant l’arrivée au domaine des Murmures, où Blanche est abandonnée par son père, « ce gros seigneur », « redoutable guerrier », volage, au passé trouble (mystère de « la fine chemise de femme » brodée de roses).
Autour de Blanche, gravitent de nombreux personnages secondaires. Colin, le garçon d’écurie; Eloi, l’apprenti charpentier ; Aiglantine, promise à Guillaume mais qui aime Colin, la cuisinière sorcière aux dons de guérisseuse, qui rassure Blanche à l’apparition de « ses fleurs », sujet tabou. S’immiscent une horde d’êtres maléfiques.
Carole Martinez multiplie les temps forts, ajoute du suspense et tient son lecteur en haleine, dans ce roman si ample. On tremble pour la vie des protagonistes, lors du corps à corps de Blanche avec Bouc, une bataille féroce pour « petite Minute ». Ou suite à une noyade. On guette le moindre frémissement des lèvres d’Aymon depuis qu’il a plongé dans le sommeil. Des secrets de famille taraudent Blanche. Sa conversation avec la Dame verte, l’invitant à plonger dans les abysses de la Loue, univers hallucinant, féerique, lèvera-t-elle l’énigme de sa naissance ?
Si Blanche se retrouve confrontée au monde des adultes, « le grand cirque des vivants », avec leur violence, leur narcissisme, leur cruauté, elle découvre aussi un père débordant d’amour pour son fils Aymon. On assiste à la naissance de ses sentiments pour ce fiancé dont elle ne voulait pas. N’avait-elle pas vu en lui, « un monstre », « mi-enfant mi-chien », « un débile », malgré « son visage d’ange » ?
Les coeurs palpitent, les premiers émois causent un séisme intérieur étrange.
Blanche, qui a côtoyé tant de violence, succombe aux gestes tendres doux d’Aymon.
Des monologues mettent en opposition l’amour filial du père d’Aymon, Jehan de Haute-Pierre, et celui du père de Blanche, laquelle connaît le châtiment de la badine.
La maternité est abordée de façon métaphorique par la cuisinière, dans ses confidences à Aymon qu’elle a vu naître. Elle-même mère, se souvient de « tous ces fruits dans le ventre ». Tout aussi symboliques ces trois loups, fruits de l’imagination galopante de l’héroïne, qui s’échappent de sa robe déchirée.
Carole Martinez brosse un remarquable portrait de Blanche, celle qui répond aux noms de « Ma lumineuse », « Mon éclatante », et qui se veut aussi « chardon » et « Eau vive ». Blanche métamorphosée qui renaît, affranchie de son père. Touchante dans sa complicité avec Bouc, ce cheval « aux yeux bleus » devenu son « confident ».
Ce récit aborde les croyances religieuses de l’époque. La vieille âme s’interroge sur l’existence de Dieu, énumérant les raisons d’y croire.
Les chansons qui scandent le roman apportent un charme supplémentaire. Dans sa lettre à son éditeur, la romancière revient sur les sources de ces chants.
L’écriture sensorielle (parfums) et poétique de Carole Martinez charme, séduit.
Particulièrement réussi le défilé des saisons suscité par les pots que le jeune marmiton découvre et goûte à l’insu de la cuisinière. On note la richesse du vocabulaire lié au Moyen-Âge (haquenée, bliaut, mesnie, cordieu). Romanesques et romantiques les moments où les protagonistes s’abîment dans la contemplation du « ciel étoilé bercé par le tendre clapotis des eaux » ou se sentent en parfaite communion avec la nature.
L’auteure a su impulser un élan kinésique au récit, rendu par une profusion de verbes d’actions, emportant le lecteur dans cette fougue, ce tourbillon.
Après Le cœur cousu et Le domaine des Murmures, Carole Martinez confirme son talent de conteuse et signe un roman envoûtant, poétique, onirique dans lequel elle retrace l’enfance de Blanche la rebelle au royaume des vivants et des ombres fantomatiques, et met en exergue sa victoire d’avoir « gagné le droit de lire et d’écrire » ainsi que sa liberté. Une invitation à « caroler » avec l’auteure.
©Nadine Doyen