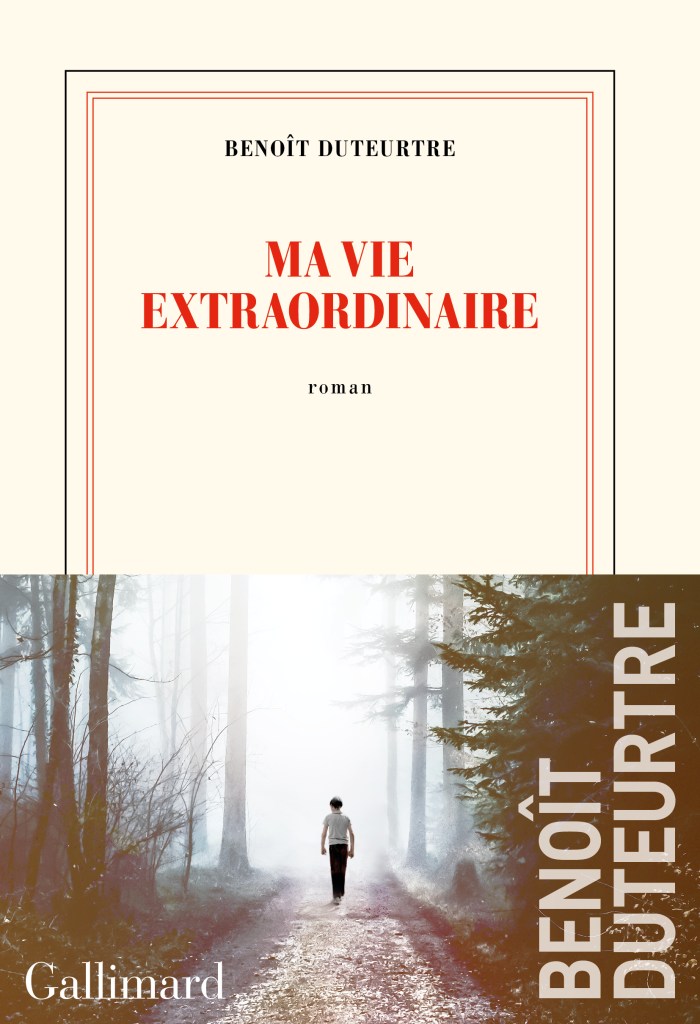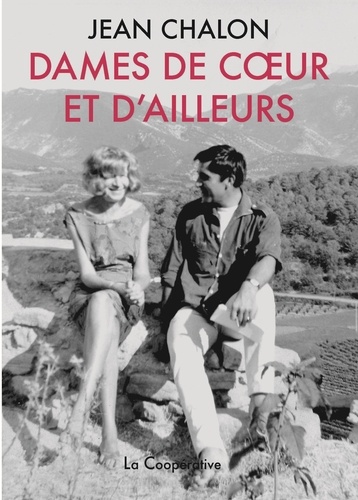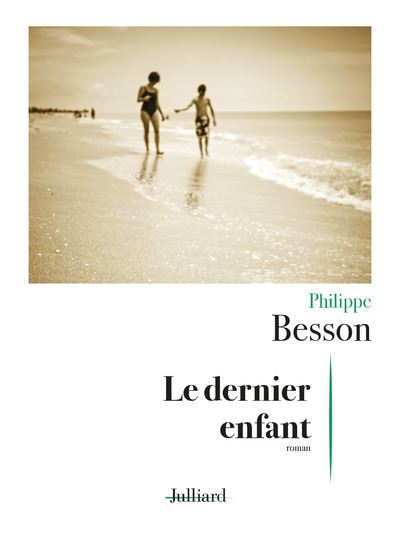Chronique de Nadine Doyen

Franz Bartelt. Un flic bien trop honnête Seuil, cadre noir ( 17,90 € – 193 pages)
L’écrivain ardennais revient avec un polar à la couverture orange flashy ! Dans la collection du cadre noir, occasion de rappeler le précédent : L’hôtel du Grand Cerf, auréolé de prix dont celui du Grand Prix de littérature policière 2018.
Il réussit son entrée en matière car quel individu peut arborer « un bonnet de bain surmonté d’une aigrette en plastique » ?! On apprend que ce dernier a eu un violent différend avec un autre passager durant un trajet en bus. Lunettes de marque cassées. En citoyen honnête, l’inspecteur Gamelle veut les lui rembourser, pris de remords quand il apprend que cet homme est aveugle. On suit donc ses investigations pour le retrouver. Un opticien lui donnera de précieux indices. Enfin une enquête fructueuse, qui le conduit au restaurant L’AmiPopol où l’aveugle, Ferdinand Ladouce, a ses habitudes.
Dès la première page,le narrateur jette le discrédit sur certains journalistes en rétablissant la véracité des faits : « Les choses ne se sont pas passées comme l’ont raconté certains journalistes… ».
Franz Bartelt campe son intrigue dans une ville de province, sans la nommer.
On serait tenté de la situer sur les terres ardennaises, par fidélité de l’auteur à son territoire. Une localité où la psychose règne, en effet la presse rend compte de 44 crimes. L’enquête diligentée par l’inspecteur Gamelle piétine depuis quatre ans.
Son bureau ? « Un foutoir » :murs tapissés de citations de Rimbaud et de Montaigne, d’articles,de photos, pages de catalogue…!
On peut aussi douter de l’efficacité de celui qui l’assiste car il s’agit d’un cul de jatte, obèse, dit « le bourrin », qui se déplace en chaise à porteurs, dont le passe-temps favori est de tirer des traits sur une page blanche !
Et si l’aveugle, croisé malencontreusement par l’inspecteur, s’avérait le plus intuitif, lui qui aurait voulu être policier ?! Ils se retrouvent à table et même au domicile de Ladouce. Aucun risque pour Gamelle de s’entrucher(1) quand l’aveugle lui offre le champagne, lui qui ne boit que de l’eau parle toutefois des vins comme un oenologue ! Mais sachez que le champagne, « ça s’écoute » !On peut « juger de la qualité des bulles, de l’accent qui marque le terroir » . Amélie Nothomb ne contredira pas cette assertion !
Or ce Jack l’éventreur tue « comme on fait des mots croisés », quatre victimes à son actif en un jour et le serial killer toujours en cavale. Pas de quoi affoler ce policier qui mise plutôt sur le hasard ! Cependant il consent à appliquer la suggestion de l’aveugle, courtois et intrusif, envers qui il est redevable. Cette idée saugrenue s’avérera-t-elle payante ?
On assiste à une scène cocasse, épique même : la toise des suspects.
Toujours est-il qu’une jeune stagiaire compte parmi les victimes. Tombée en mission pour un sandwich ! Ce drame anéantit le commissaire Valentin, qui l’aimait cette « magnifique créature » et l’avait même aimée dans le local de la photocopieuse !
Ce qui est nouveau, c’est que le criminel a opéré de jour, la paranoïa enfle…
Quand vous aurez, vous aussi, déduit qui est cet « effroyable monstre qui terrorise les arrêts d’autobus et les passages protégés », agissant selon un rituel bien codifié, vous serez sidérés ! Vous aurez même envie de revenir sur son parcours… N’avait-il pas rêvé d’embrasser la carrière de limier ? Rappelons que dans le roman précédent de Franz Bartelt, un personnage est diplômé d’EIFFEL (école internationale de formation des Fins Extra Limiers) !
Rebondissement quand l’inspecteur dépressif, endetté, prend un congé sans solde, trop attiré par le gain d’un futur job providentiel au salaire notoire ! Le comble, son employeur milliardaire est le compagnon de son ex-femme, Justine !
Pourquoi l’a-t-elle quitté ? (Ne dévoilons pas leur différence, sujet de mésentente, d’incompatibilité).
Ainsi il va découvrir un train de vie de luxe, où 20 employés sont au service du couple et croiser la bien plantureuse, callipyge serveuse, Magdeleine qui lui a fait de l’effet ! « Il conjecturait le coup de foudre ».
Le narrateur glisse un message écologique aux automobilistes afin de sauver la planète et évoque la conduite de Gamelle tout « en douceur », comme si c’était le corps de Justine (son ex) qu’il avait entre les mains, « freinant avec une délicatesse d’amant » ! Description très évocatrice, sensuelle et mémorielle pour le flic.
À noter que les personnages principaux de l’auteur apprécient de rouler dans des voitures qui en imposent. Celle du milliardaire Jeffrey Durandal- Beethove est « longue et large comme un bateau » . Dans Ah, les braves gens, Julius Dump se déplace en « Cadillac , une décapotable jaune citron » !
Quant au 48ème homicide, une histoire de bouton pourrait confondre le meurtrier !
Laissons le suspense… Une intrigue que l’on verrait bien adaptée à la scène !
Franz Bartelt se révèle virtuose d’un style tiré à quatre épingles, il manie l’absurde avec brio et nous inciterait à lire notre horoscope ! Loufoque. Détails croustillants…
Ses personnages sont toujours atypiques, déglingués, burlesques, hauts en couleur, leurs noms parfois un aptonyme comme Gamelle… (Franz Bartelt n’a pas son pareil pour nommer ses personnages, souvenez-vous de Vertigo Kulbertus dans L’Hôtel du Grand Cerf). Situations toujours aussi rocambolesques.
On retrouve sa verve, sa tendance au sarcasme, à la farce noire et sa plume corrosive quand il épingle les institutions ou évoque les mœurs illicites des soirées ludiques !
Du Bartelt pour jus qui réjouira les adeptes de ce genre de littérature. Savoureux.
© Nadine Doyen
(1) Terme entré dans le Robert 2022 : s’étouffer en avalant de travers. ( origine champenoise)