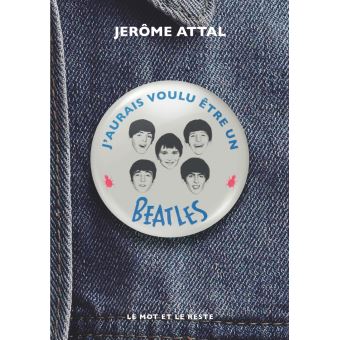Chronique de Nadine Doyen

Reprise des activités de plein air – Jean-Claude Lalumière
éditions du Rocher ( 17 € – 221 pages) Octobre 2019
Les îles inspirent les écrivains. Christophe Carlier a campé à deux reprises son récit sur une île.
Au tour de Jean-Claude Lalumière avec ce titre alléchant : Reprise des activités de plein air.
Un titre, synonyme de liberté, qui fait rêver quand on a vécu le confinement !
C’est sur l’île d’Oléron que Jean-Claude Lalumière campe son récit, évoquant son passé (bombardements en avril 45, pas encore de pont), l’esprit insulaire et « la rumeur : un décret irrévocable ». Il déroule en alternance la vie de trois protagonistes voisins.
Par respect d’âge, citons d’abord Philippe, instituteur retraité de 85 ans, détenteur d’un lourd secret de famille. Un mari des plus attentionnés pour son épouse qui se remet d’un accident.
Christophe, 47 ans, qui a choisi de rester dans la modeste maison de pêcheurs de « Mémé Rillettes », lors de sa rupture avec Valérie. Avec l’aide de Mickael (22ans), étudiant qui a pris une année sabbatique et qu’il héberge, il a entrepris de retaper la bâtisse simple mais encore « robuste » en vue d’y aménager des chambres d’hôtes. L’écrivain a l’art d’aiguiser la curiosité du lecteur, car une des chambres est occupée par Brigitte, qui ne sort pas encore, ayant été malade. Mais qui est donc cette Brigitte, avec qui Christophe aimerait faire une promenade sur la plage pour se changer les idées ? Le lecteur devra attendre pour connaître sa réelle identité ! De même pour Robert !
Peu à peu, on découvre le passé « des vies minuscules » de ces trois protagonistes, soit par le personnage lui-même ou sous forme chorale, par un autre. On comprend pourquoi Philippe est venu s’installer au nord de l’île, à Chaucre, près de la maison d’Henriette, « Mémé Rillettes », dans ce coin de l’île encore sauvage : « un endroit fabuleux, avec vue sur le large » et une dune qui, au printemps, se couvre d’odorantes immortelles.
Christophe, qui recycle en phares miniatures le plastique collecté sur la plage, déplore comme Mickael la pollution des mers. « La plastification du monde est irréversible » selon eux.
On suit les travaux de rénovation de la maison de la grand-mère, l’entreprise titanesque de consolider, « remonter la dune », qui subit l’érosion et leur dernier projet de restaurant.
On repeint en vert pour se distinguer de l’île de Ré !
Mais où sont les femmes ?
Christophe et Mickael ont vu leur bien aimée s’éloigner.
Christophe vient d’être quitté par Valérie, qu’il a du mal à oublier.
La petite amie de Mickael, Tina, poursuit ses études à Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre d’Erasmus.
Philippe, le plus âgé, est veuf. La récente disparition d’Elisabeth va resserrer les liens entre les trois solitaires qui vont s’épauler, s’entraider. Repas pris ensemble, recettes du cahier retrouvé testées, conversations autour de la littérature, et des femmes, prêts de livres. (Flaubert, Faulkner, Gogol). Occasion pour l’auteur de souligner le rôle de la lecture, « une amitié » pour Proust, qui peut apporter une consolation et de faire la distinction avec la « chick littérature », cette littérature sentimentale qui semblait être celle dont s’abreuvait Valérie, (l’ex de Christophe qui n’a pas de scrupules à sacrifier les livres qu’elle a laissés!). Geste un peu sacrilège pour les défenseurs du livre.
Dans cette intimité qui s’instaure entre les trois hommes, Philippe mis en confiance, va se libérer du poids du non-dit, et lâche la vérité concernant la grand-mère de Christophe. Les voilà en famille.
Et enfin le lecteur découvre ce qui justifie le titre du roman : les activités de plein air programmées, ce qui nécessite d’abord une initiation à la navigation par le loup de mer pendant une quinzaine ! Vont-ils vivre les mêmes aventures que celles des protagonistes de Jérôme K Jérôme ?
Ne dévoilons pas leur destination, mais le désir de « prendre un nouveau départ » les habite.
« L’île a eu des vertus réparatrices pour eux trois ». Le suspense clôt le roman.
Jean-Claude Lalumière aborde le thème du temps, de la précarité de l’existence, de la difficulté et la douleur de vider la maison d’un proche disparu, l’immense tristesse, désarroi de perdre une épouse. Il porte également un regard sur l’amour et le couple.
La complicité et la solidarité des 3 hommes, le silence parfois entre eux (« On reste sans rien dire pendant de longues minutes, profitant du calme. »), les femmes quasi absentes, rappellent les romans d’Hubert Mingarelli (1).
L’auteur épingle/brocarde cette amitié superficielle des réseaux sociaux et souligne la profondeur de celle qui s’est nouée entre les trois voisins. Scène touchante du trio attablé pour partager une boîte de pâté. Il se moque aussi de cette manie/addiction des touristes de prendre des selfies, et tout capter avec le smartphone. Il fustige ces estivants qui surconsomment, « l’homme moderne hyperactif à l’insatisfaction permanente ».
Alors que lui a choisi d’immortaliser l’île par écrit. Il insère même un article, compte rendu d’un conseil municipal envisageant de détruire les blockhaus, vestiges du mur d’Atlantique, jugés trop dangereux pour les estivants. Ce qui apporte une dimension historique (fortifications Vauban).
Une île qui connaît les tempêtes et les inondations. Une île où Christophe aime admirer « le ballet des pinasses » rentrant au port. Domino est « connu des paléontologues pour ses rudistes. »
A travers les références artistiques, en particulier Manet, on devine l’auteur familier du Musée d’Orsay. Ici, l’Olympia, c’est le nom d’un bar.
On s’imagine l’enfant qui voyageait et s’instruisait à bord des atlas, passion déjà révélée dans Le front russe. On note aussi des références cinématographiques selon les générations (37°2 le matin, Harry Potter, Mon oncle de Tati) et musicales (Madonna,Tom Waits, Patricia Kaas).
On retrouve avec délectation l’humour auquel nous avait habitué l’écrivain dans ses premiers romans dont La campagne de France. Plusieurs scènes cocasses dérideront le lecteur.
La construction du livre ressemble à des miscellanées où se côtoient : avis de décès, diary (2), articles de presse, dialogues, bulletins météo, recettes, notes de bas de pages, mails. Une série de chapitres courts qui se dévorent comme les desserts de « Mémé Rillettes » : Millas, galette à l’angélique et les jonchées dont le président Mitterrand était friand au point de s’en faire livrer jusqu’à Paris, apprend-t-on !
L’auteur signe un récit atypique qui met en lumière une amitié masculine intergénérationnelle, dans lequel une vague de tendresse et de bienveillance vient happer le lecteur.
Un roman où le vent du large apporte embruns et bouffée d’oxygène. On respire !
© Nadine Doyen
(1) Hubert Mingarelli : ( 1956 – 2020) auteur de Quatre soldats, Un repas en hiver, L’homme qui avait soif.
(2) diary : journal intime.