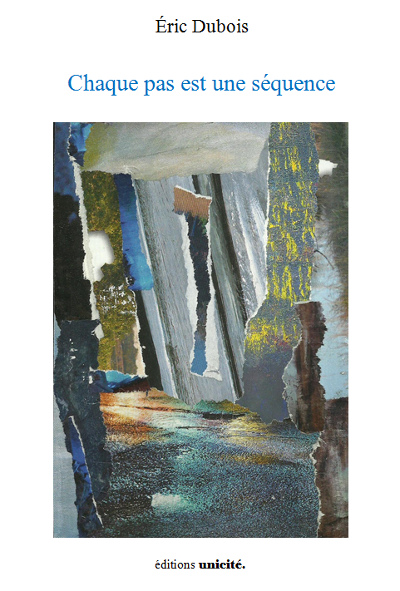Une chronique de Lieven Callant
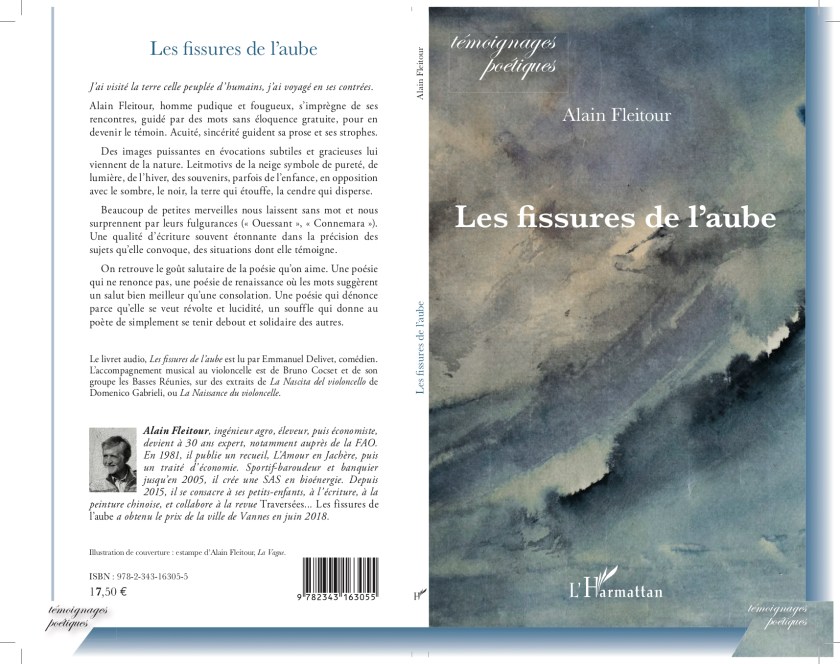
Alain Fleitour, Les fissures de l’aube, L’Harmattan, témoignages poétiques, 95 pages, 17,50€, janvier 2019
Douze parties pour ce recueil de poésies, autant que les mois d’une année. C’est que le temps, le tempo des saisons, la manière dont il recueille le présent, le mélange aux souvenirs et nous permet ainsi de l’habiter sont les clefs de voûte de ce livre.
Chaque étape s’attache par le biais des poèmes à nous inscrire dans une démarche sincère qui stimule autant le questionnement, la recherche d’un sens personnel à l’existence que la contemplation silencieuse et respectueuse des émotions. Elles surgissent immanquablement lorsqu’on côtoie de près l’autre en nous que l’on condamne à habiter les souvenirs.
Le livre s’ouvre sur un poème évoquant une photographie sépia de gens qui sourient, les personnes d’une même famille, les parents de l’auteur. Le temps passe, l’image ne conserve malgré son jaunissement que cet instant où tous étaient jeunes, heureux, insouciants. Le poème a la dure tâche de nous révéler que les parents de l’image sont morts, se succédant les uns les autres, à cause d’une fatalité à laquelle personne n’échappe. La mort au bout du poème? Pas seulement, le poème est avant tout la promesse de vivre pleinement le souvenir, de se rapprocher de la matière qui nous constitue sans perdre une certaine lucidité sans laquelle les sentiments ne s’exprimeraient plus au travers de nos émotions. S’inscrire dans la vie est ce que permet le poème tout en se délestant d’un fardeau impossible à porter sans rien perdre de la conscience.
Pour nous guider d’étape en étape, les poèmes nous parlent avant tout de la vie. De ses combats, de ses victoires et de ses défaites provisoires. Le poète se sert d’images, de métaphores, de symboles comme le peintre se sert des couleurs, de leurs nuances pour démarquer les ombres de la matière lumineuse, pour inscrire les corps et les objets sur la toile, sur notre rétine, dans nos souvenirs. L’imagination n’a plus qu’à les habiller de sensations et de sentiments.
Tout au long du recueil, nous est subtilement rappelé que le poème est une oeuvre malgré tout concrète, un geste, une volonté vivace d’inscrire, de rappeler, d’alerter. Chaque poème est en soi une petite révolte qui ne se limite jamais à émettre un avis fermé. Tous les poèmes de ce livre sont des portes ouvertes, tous les poèmes sont libres.
Pour marquer son attachement à cet esprit d’ouverture, Alain Fleitour a tenu à ce que ses poèmes soient lus, que la voix du comédien Emmanuel Delivet et le violoncelle de Bruno Cocset nous guident au-delà de nos propres lectures silencieuses. Ces exhortations musicales invitent une fois de plus la poésie à se tenir debout parmi nous.
Le titre Les fissures de l’aube trouve sans doute explications dans le poème du même titre à la page 79. Je pense que la poésie est une aube, un commencement. Un jour de plus à gravir. Le poète se glisse dans les failles et se sert des fissures comme le grimpeur s’en sert pour franchir un sommet.
Voici quelques vers soulevés par mes lectures, qu’ils vous suggèrent de lire et/ou d’écouter le livre!
Tu viens des herbes sauvages
Saturées de brûlures P18
Tes yeux me noient de ciels
Je suis un soupir dans la gamme des souvenirs
Au matin tu me ravives dans le ruisseau du soleil
Au murmure de ton chant. p26
Toutes leurs mains lancent des pétales de rires
Petits cerfs volants brillants
Éclats de soleil dans ce ciel d’azur. P32
La course nous portait
Aux premiers pas de l’aube
Inlassablement
Depuis le pied de la Fournaise. P37
On se lavait avec l’aurore
Aux bruits de l’humidité. P37
_________________________________
Chroniques d’Alain Fleitour sur Traversées: ici
© Lieven Callant