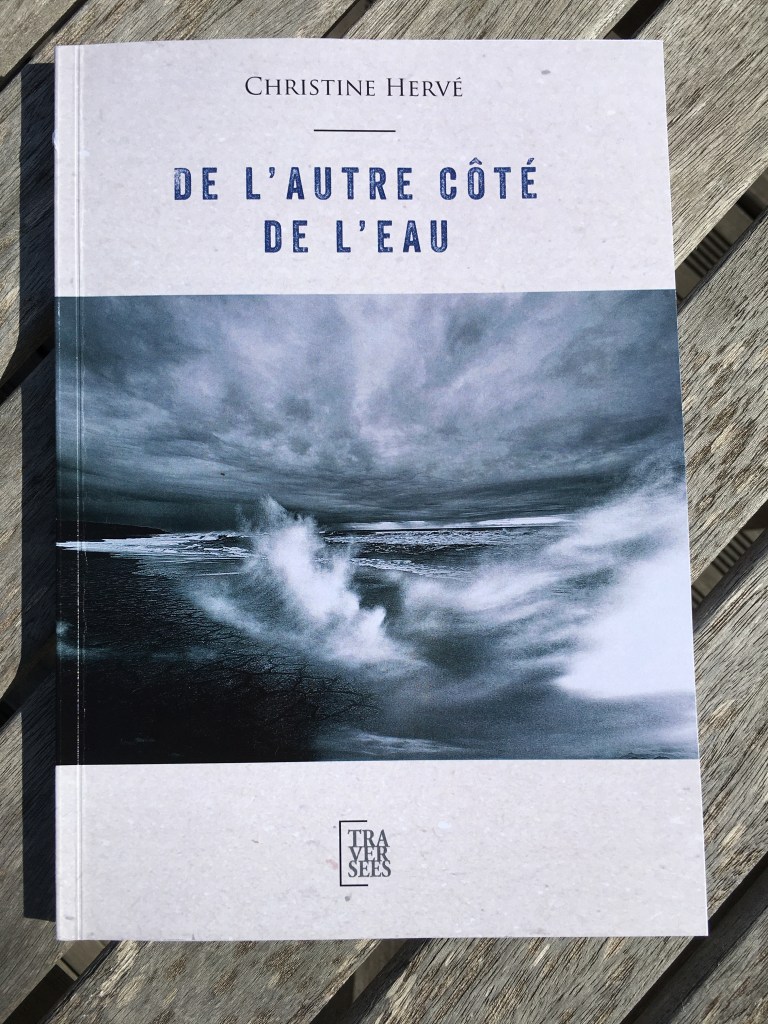Chronique de Lieven Callant
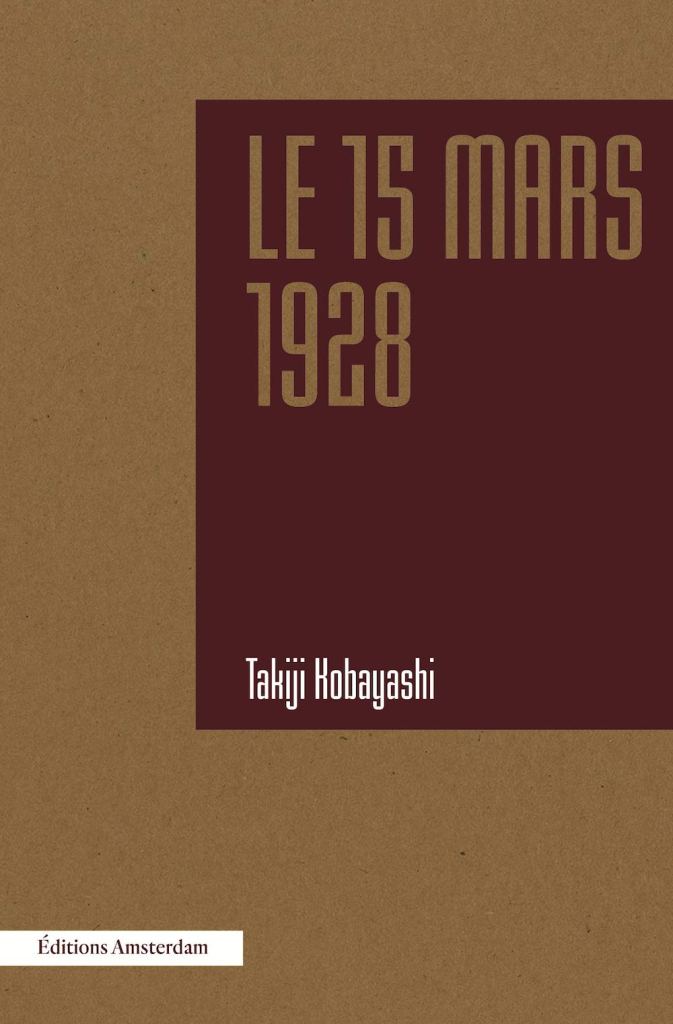
Takiji Kobayashi, Le 15 mars 1928, traduit du japonais par Mathieu Capel, Éditions Amsterdam, juillet 2020,121pages, 12€.
Le 15 mars 1928, les militants communistes et socialistes de la petite ville d’Otaru, sont par la police japonaise, arrêtés et emprisonnés de façon arbitraire. La presse de l’époque préfère se taire.
Takiji Kobayashi « figure majeur de la littérature prolétarienne japonaise » décide alors d’écrire un roman afin de documenter les évènements du 15 mars 1928.
Takiji Kobayashi commence son roman en adoptant le point de vue de l’épouse (O-Kei) d’un des militants arrêtés ce fameux 15 mars 1928. La description de l’intrusion en pleine nuit, de la police au domicile ne nous apparait que plus arbitraire et violente.
Toute la maison est fouillée jusqu’à la chambre de leur enfant qui terrifiée par les bruits de saccage préfère faire semblant de dormir. Á la violence quotidienne de la pauvreté s’ajoute celle de la répression policière.
Car la situation sociale et économique des militants est plus que déplorable. Les conditions de travail ruinent la santé des travailleurs qui disposent à peine de quoi survivre. Les habitations modestes sont à peine chauffées. Certaines familles n’ont pas toujours accès à l’électricité faute de pouvoir payer les factures.
Il existe pourtant entre les travailleurs une réelle solidarité. Grâce à l’organisation syndicale naît chez certains l’espoir d’un avenir plus juste même si la route semble longue et qu’il reste encore du pain sur la planche pour alerter les consciences sur le sort des plus démunis.
—« Elle avait entendu dire que, lorsque les colonnes de fourmis changeaient d’habitat et trouvaient une rivière en travers du chemin, celles de devant pénétraient dans l’eau et s’y noyaient, en montant les unes sur les autres, de manière que leurs cadavres fassent un pont pour les suivantes. Nous devons être les fourmis de tête, disaient souvent les plus jeunes du syndicat. Et c’était bien cela qu’il fallait faire.
« Il nous en reste du chemin! »—P42
« Pourtant, personne ici ne paraît s’en soucier. Ça ne peut être vrai. Comment—alors que des dizaines, des centaines de gens mettent leur vie en jeu, non pas pour leur intérêt personnel, mais pour les masses prolétaires — comment peut-on y être si indifférent? »
« Pour qui son mari et les autres faisaient-ils donc tout ça? O-Kei éprouva étrangement un sentiment de solitude et d’insatisfaction. Ils sont en train de se faire avoir! Mais non, ne dis pas de bêtises, enfin! Une forme de tristesse pourtant ne la quitta plus, obstinée comme un taon. »
TaKiji Kobyaki opte pour placer la suite son récit au niveau de chacun des prisonniers. Pris individuellement, le sort inhumain qui leur est réservé révèle au lecteur l’aspect systématique de l’oppression, son caractère irrévocable, irrémédiable. N’importe lequel d’entre nous est susceptible de subir ce qui est infligé à RyūKichi, Suzumoto, WaTari, Sakanihi, Saito, Ishida, Shibata, Kudo ou Sata.
En prison, après la stupéfaction de l’arrestation arbitraire et l’incompréhension quant aux motifs illégaux qui tentent de la justifier, l’espoir de justice sociale s’estompe de plus en plus. À l’absence d’explications quand aux motifs et à la durée de leur arrestation s’ajoute la privation de sommeil. Les repères habituels disparaissent. La peur est permanente.
« Sous la lumière de l’ampoule sale et terne, les contours de chacun s’estompaient, comme si ne bougeaient que des ombres. » P56
Les graffitis sur les murs de la cellule forment comme des dialogues entre les divers personnes passées par ces lieux. Un lien se forme entre prisonniers qui ont été enfermés à un moment donné, qu’ils aient ou non commis un crime. Toutes ces marques poursuivent le même but: le souvenir, comme si lutter contre l’oubli était désormais le seul espoir. La seule manière d’obtenir justice.
Un des graffitis résonne d’ailleurs comme un haïku.
« Et me voilà aux mains de la police. Un homme bien triste » P69
RyūKichi, « tue le temps » en écrivant lui aussi longuement sur les murs de la cellule:
« Nous, les travailleurs, on travaille et on travaille encore jusqu’à tomber par terre, et on est toujours aussi pauvres. Quoi de plus absurde! »
Un à un, les prisonniers sont interrogés et torturés.
« Quel visage?! Si tant est que ce soit encore un visage. Gonflé, violacé comme une aubergine pourrie. Un visage littéralement ravagé, et ce visage, mais n’était-ce pas celui de Watari? » p75
« Certains se retournèrent dans leur sommeil, des soupirs, des mots incompréhensibles éclatèrent çà et là comme des bulles de méthane à la surface d’un marécage. » p85
Peu à peu, de terreurs en horreurs, le piège se referme sur les prisonniers.
« Chaque fois qu’il se retrouvait au commissariat, il finissait par éclater de rire à l’idée qu’en ville on puisse leur donner du « Monsieur l’agent » et les tenir pour des hommes remarquables qui préservent « paix », « bonheur » et « justice ». Au fondement de la pédagogie bourgeoise: la prestidigitation. Pour faire passer, auprès de la plupart des gens, le blanc pour du noir, ils étaient d’une habileté, d’une méticulosité qui forçaient l’admiration. » p90
« La torture matérialisait en tant que telle l’oppression et l’exploitation de la classe prolétarienne. » P92
De nouvelles limites que l’on croyait infranchissables sont dépassées par la torture physique qui s’éternise plusieurs heures.
« Puis, quand s’achevèrent ces trois bonnes heures de torture, il fut jeté dans une cellule, comme de vulgaires abats. » P93
« Quand il se retrouva dans le couloir, titubant, appuyé à l’épaule d’un policier, sans plus savoir si son corps était bien le sien, il comprit désormais que tout ce qu’il avait pu imaginer ou redouter de la torture sans l’avoir jamais subie, ce qu’il avait pu anticiper de l’état misérable où vous plongeait tant de cruauté n’avait absolument rien avoir avec la réalité. (…) On crie : « tuez-moi, tuez-moi » mais sur le coup, en vérité ni la cruauté, ni la souffrance ne comptent plus. C’est plutôt cette tension extrême — oui, cette tension portée à son extrémité dernière. « Je ne vais pas en mourir », se dit-on: en tant que tel c’est exact. » p103
On comprend très vite que la vérité, l’obtention d’éventuelles informations pour les policiers et ceux qui les commandent n’est plus un but en soi. On veut détruire, on veut anéantir et faire ployer l’individu.
Certains concepts comme la liberté, la justice, la légalité deviennent complètement flous. D’heure en heure s’assombrit la situation des prisonniers puis arrive le moment où un enfer cesse, certains compagnons sont libérés, d’autres sont transférés. Tous passent d’un enfer à un autre.
Le 20 avril, le commissariat d’Otaru est à nouveau vide et silencieux, subsistent sur les murs des cellules les graffitis.«N’oubliez pas le 15 mars 1928!»
Le roman se termine sans nous dire le sort qui sera finalement réservé aux militants transférés à Sapporo.
Le roman de Tajii Kobyashi m’a bouleversé tant ses récits résonnent avec l’actualité qui a révélé des violences policières systématiques à l’encontre d’une partie de la population en ces temps troubles d’état d’urgence sanitaire. La dérive autoritaire de nos dirigeants se fait toujours plus grande. Un climat de peur, de défiance de l’autre s’installe peu à peu. Nos libertés ordinaires sont rognées.
Si ce roman se veut être le témoignage brûlant du sort réservé il y a presque un siècle aux opposants à un régime réactionnaire et d’une manière plus profonde du sort réservé aux ouvriers pauvres de la même époque, il met à jour des procédés, un mécanisme de domination et d’aliénation de l’autre. Méthodes que n’importe quel pouvoir peut nous imposer dans ses dérives autoritaires. Toujours plus de surveillance, et de restriction de nos libertés individuelles. La solidarité, le droit pour tous de vivre dignement, d’avoir accès à l’enseignement, à la santé nous sont présentés comme un luxe à mériter et non plus comme les droits essentiels de chaque humain.
Ce livre me rappelle qu’on ne peut fermer les yeux sur ce que subissent ou ont subi nos semblables pour avoir simplement le droit de se demander dans quel monde choisissons-nous de vivre?
©Lieven Callant
- Lire aussi l’article Pour réparer le silence par Feya Dervitsiotis