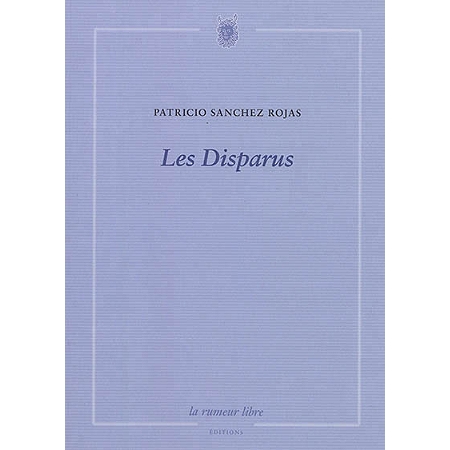Une chronique de Marc Wetzel
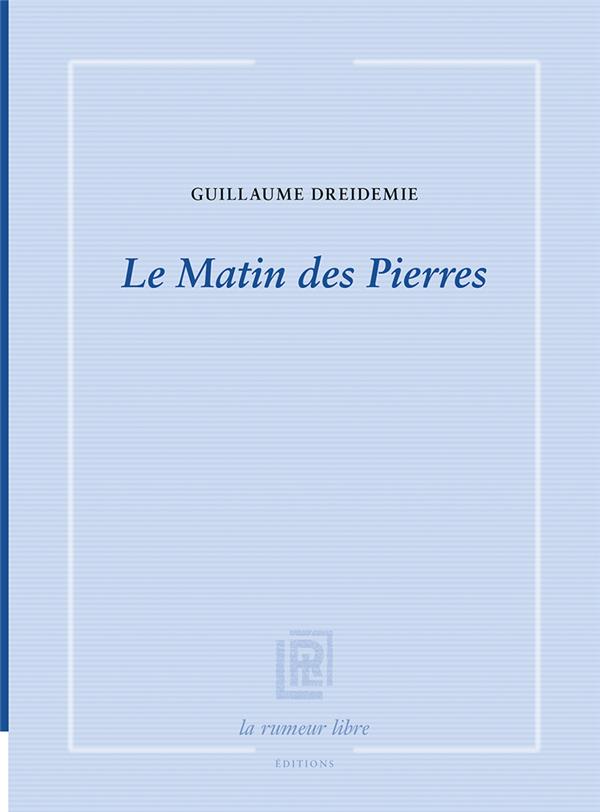

Guillaume DREIDEMIE, Le Matin des Pierres, La rumeur libre, 2023, 80 pages, 14 €
Quel « Matin des Pierres » ?? On imagine une sorte d’aube purement minérale (telle que sur Mars, ou dans un parfait désert, ou n’importe où sur Terre il y a plus de trois milliards d’années) : la matière d’avant la vie. Une aurore où tout allait être sous le soleil, mais rien ne se servirait de lui. Une lumière dont les êtres éclairés ne feront rien. Un « matin des organismes », ce serait, par contraste, celui d’êtres prélevant de quoi se développer, prenant contact avec à quoi s’adapter, mûrissant en eux de quoi se reproduire. Ici, non : la « misère de la pierre », c’est celle d’une matière sans usage d’elle-même, d’une masse et d’un volume partout en vis-à-vis exclusif, perpétuel et sans issue. Comme si le monde ne s’était pas encore pris en mains, n’avait pas songé à réorganiser (si peu que ce soit) ce dont il est fait. Empédocle, le présocratique Grec, décrit cet état archaïque, minimum, de la Nature quand il suppose quatre grands éléments (Eau, Terre, Feu, et Air ou Éther) et deux forces (l’une d’association et équilibre, l’autre de dissociation, écart et relance – qu’il nomme respectivement Amitié et Haine) qui, indéfiniment, jouent sur eux quatre sans pause ni terme. Or si ce monde strictement minéral n’apparaît pas tel quel dans ce recueil, Empédocle, lui, y est au rendez-vous. On connaît sa légende : par orgueil, désespoir ou folie, il se serait jeté (secrètement) dans la fournaise de l’Etna, une bouche du volcan recrachant plus tard une des sandales de bronze que portait toujours (pour se protéger des miasmes du sol commun ?) cet « homme divin ». Fournaise, en effet, où rien de vivant ne le demeure, et qui, usine à scories, semble – par ses panaches explosifs, ses coulées de lave, sa mortelle énergie – vouloir renouveler la minéralité même !
« Le sang bouillonnant du volcan
Déborde du cratère (…)
Une nuit de brume,
Le sage s’est enfui;
Est-ce sa sandale
Au bord de l’abîme ?… » (p.65)
« Au chemin de campagne
Nous verserons le vin,
Recueillant la sandale
Parfaitement intègre
Penchons-nous vers la terre,
La sandale a une aile !
Ô poète, messager des dieux !
Allons-nous survivre ? » (p.68)
Dreidemie se prend-il (pour quoi faire ?) pour Empédocle ? Empédocle était contemporain de la naissance de la raison (métaphysique et scientifique); il pressentait la venue d’un Platon, d’un Aristote – et le mauvais et desséchant triomphe d’une pensée de la définition, de la démonstration, de la classification – bref, d’une abstraction de la vie. Dreidemie, lui, assiste, comme nous, au crépuscule de cette même rationalité – dans son « bouquet final » logico-médiatique : l’ordre par le calcul, la méthode pour le profit, et leur liaison ultime : profit du calcul (algorithmes, Big Data) et calcul du profit (capitalisme). Il en cherche la (non-suicidaire ?) sortie : il veut jeter la raison malade dans sa propre fournaise, pour en recueillir – peut-être – la sandale ailée, et comme Empédocle philosophe et poète, il chante, il déclame, il herborise, il devine. Et, comme lui, Dreidemie refuse toute royauté rationnelle à la Platon (en dénonçant l’arbitraire d’une rationalité capable de tout dissocier et recombiner à sa guise !), chante pour apaiser les différends, trouve dans la nature même les remèdes à notre mésusage (ou surexploitation) d’elle, et fait le même constat de la fin des Sages (la difficulté à trouver des hommes sages, disait Empédocle, tient d’abord à ce que seuls des hommes déjà eux-mêmes sages sauraient les reconnaître !).
Guillaume Dreidemie est un jeune (31 ans) auteur étonnant, subtil et touchant. Étonnant par ce qu’il fait paradoxalement de lui-même dans ce livre. Recueil, en effet, d’une surprenante sobriété intellectuelle, d’un penseur qui fait le choix d’y avancer nu (sans idées), d’un rhéteur (c’est, dans la vie, un conférencier ardent, drôlatique et virtuose) renonçant ici à toutes formules. Il se cantonne à des questions simples
(« Aujourd’hui, qui nous regarde ? » (p.13), « Où veux-tu en venir, par ces mots-là ? » (p.40), « Allons-nous survivre ? » (p. 65), « Qu’allons-nous chanter ? » (p.66).
Il dresse les constats comme ils viennent s’imposer
(« Nous n’avons pas deviné (…) ce qu’aimer veut dire« (p.10), « Ce matin ?/ Corps perdu./ Simple présent/ D’une blessure » (p.16), « Difficile de croire en nous/ lorsqu’on nous regarde » (p.19),
et le déchirant :
« On ne peut rien/ Que tenter de guérir » (p.43).
Il va aux choix qui ne le décevront plus
(« Décide/ ce qu’il reste à découvrir » (p.21), « Ne cache plus tes mains à la lumière » (p.28), « Regarde ses mains, ignore/ Ce qu’elles ont touché » (p.41),
et le non moins déchirant :
« Ne pas éviter vos regards/ Trop longtemps./ Mais vous convier, ce jour/ à fermer les yeux,/ avec nous » (p.69).
Tout ceci, divers, mais qui surprend par sa simplicité et sa franchise (chez un auteur intellectuellement complexe et réservé) a-t-il, pour autant, une portée parcourable, une direction décisive ? Oui ! La ligne ici, ce sont, je crois, des questions actuelles, graves et fines, comme : Comment ôter l’écharde, sans perdre l’impulsion ? Comment décrucifier la Nature sans nous tenir trop facilement quittes (et escamoter notre responsabilité !) ? Et : ne devrions-nous pas carrément préférer la fin du monde à l’éternel retour d’une sauvegarde bancale (ou opérée de justesse) de celui-là ?
Un auteur subtil aussi, par un art constant de la devinette spirituelle. Deviner, c’est découvrir en pressentant, c’est formuler la sortie (malicieuse) d’une petite énigme. Par exemple : quels morts célèbres (que tu t’éloignes admirer, ou fuir) sont-ils capables de te mettre en retard auprès des vivants ? Réponse, ici : Baudelaire (p. 44 et 56). Ou : « Je ne la retiens pas,/ je sais que je pars avec elle » (p.33). De qui ou quoi parle-t-il ? Est-ce l’absence ? La nuit ? L’eau d’une baignoire ? Ou : « Il n’y a pas besoin de prier/ Pour que les roses vivent ou meurent, / Prions » (p.35). Prions pour qui ou quoi ? Pour que les fleuristes vivent ? Pour que nos vies ou morts soient des roses ? etc. Ou : « Devine/ Ce qui me retient/ De passer, semble-t-il,/ à demain » (p.48) . Alors, qu’est-ce ? Ma mort ? L’éternité ? Une fâcheuse habitude ? Dreidemie a l’énigme joyeuse, et le mystère partageux ! Et, parfois, de plantureuses et inattendues réponses :
« nous allons jouir d’une pure présence
comme un fromage d’Auvergne
abandonné sur la table
abandonné et frais ruisselant » (p.53)
Enfin, un auteur touchant, qui fait sentir ce à quoi il participe, et ce dont il reste exclu. Il y a une question (non plaintive, mais incessante) qu’il semble adresser à ses proches (en perplexité, en ardeur), à ses amis poètes, ses lecteurs loyaux, et qui est quelque chose comme : « Nos raisons de chanter reviendront-elles ?« . Les amis de la revue (L’écharde) qu’il a co-fondée, les fans de Laforgue et Verlaine, les camarades d’une aube authentique … font, alors réunis, penser ceci : le sens de l’amitié repose sur l’égalité d’inspiration, et sur l’étrange besoin de désintéressement (de complicité gratuite ou gracieuse). La sorte de bienveillance réciproque pour l’inconnu de l’autre, voilà l’amitié, comme ressort, énigmatique mais neuf, de la compréhension.
C’est, sans doute, cet appel (insistant, feutré) à l’ami – p. 31, p.58, p.59 – qui émeut le plus, alerte le mieux : avec un ami, nous remplissons exactement les conditions de mériter de dire « nous » ! L’entr’aide des inspirations, la solidarité spontanée des Muses respectives, font le commun réveil : on met à disposition ce qui nous apparaît, on comprend ce que l’autre veut faire de ce qui lui échappe, et épargner ou non de sa propre enfance (p.26). L’intelligence y adopte, prodigieusement, les moeurs de la grâce :
« Qui nous ramène doucement
la tête vers
ou bien ailleurs
ou bien jamais ? » (p.14)
« Matin », alors, non plus « des pierres », mais, bien plutôt, de l’épierrage bénévole du champ d’autrui – et c’est ce qui, dans cette oeuvre à la fois vive et tenue, ravit et instruit (on attend donc la suite – féconde et fine, sûrement – de cette première pierre du matin).