Une chronique de Marc Wetzel
Patricio SANCHEZ-ROJAS, Poèmes du bout du monde, Éditions Unicité, 3eme trimestre 2024, 68 pages, 13 €
« Poèmes du bout du monde » est un titre presque ironique : en tout cas pas le programme attendu du baroudeur des lointains, qui part chanter plus loin que tout ce qu’il fera entendre – mais quelqu’un, simplement, de déraciné, qui, où qu’il aille, se sent au bout du monde. L’exil (cette « géographie qui m’arrache« ), c’est en effet la punition du déracinement : on y perd, forcé, sa terre natale avec aussi peu d’avenir et d’espérance qu’on perdrait sa raison, ou se verrait banni de l’esprit ! Même, par chance, accueilli dans le parfait chez-soi des autres, on y est au « bout du monde », comme refoulé aux extrémités de l’ordre, du style de vie et du cosmos familier qu’est pour chacun son pays premier. On a compris que ce « bout » de monde du titre n’est pas un cap à venir vaincre , mais le constat d’une maximale distension, et d’un rejet sans retour. L’étymologie le dit : on est « bouté » hors de notre source de vie, poussé loin du vivable, écarté de l’équilibre natif.
C’est aussi le contraire du « voyage organisé », de la migration saisonnière du nanti. C’est bien plutôt le voyage de la désorganisation de soi, une croisière en radeau, une sorte de naufrage longitudinal. Patricio Sanchez le dit de multiples façons, en poète. En exil, d’abord, aucune porte n’ouvre plus sur un chez nous, mais seulement sur d’autres portes, qui à leur tour (p.10) … Ou bien : l’exil est « un navire chargé de fantômes et de lucioles » (p.11) – de fantômes parce que ce qui luit là est en réalité déjà mort; de lucioles parce que cela brille sans avoir la force d’éclairer. Ou encore : l’exil est un pays, non de fait, mais de carnet – un territoire qu’on apprivoise (peut-être, et au mieux) à coup de prises de notes, de suggestions, d’élans improvisés (« Ton pays aura à jamais la forme/ D’un cahier où tu inventes la vie« , p.12) : dans ce journal de bord qu’est la vie d’écrivain, c’est le journal qui fait le bord, et le bout de monde qui requiert le journal. Les formules qui suivent sont nettes et cruellement justes : il nous faut noter ce que le pays d’adoption nous fait vivre pour le vivre ! Le rapport natif à soi-même y est devenu illisible par les autochtones (l’exilé sent la vie même de ses entrailles livrée à des inconnus, p.13); tout ce qu’on découvre – même les dauphins de Gibraltar une fois parcourus Atlantique et Pacifique ! – n’offre d’abord que des visages d’emprunt.
Et surtout : la langue dans laquelle on devra désormais se comprendre soi-même pour être compris, la langue des évidences à venir … doit être apprise ! Même celle des rêves (où l’on revient à ce qui nous comprend) devra muter. Sanchez l’écrit profondément : « Ton langage est semblable à la fenêtre d’un rêve » (p. 16), d’un rêve qui « passe sans savoir où aller » (p.20). Et, à chaque réveil européen, le matin, l’exilé chilien doit repasser une frontière, laissant derrière lui (c’est à dire en lui !) « le colibri, le volcan, l’araucaria » (prestes et touffus comme chiendent de son inconscient) pour sa vie de naturalisé héraultais, où le thym, le chêne vert et la dolomie font leur paisible police. La vie du « naturalisé » ? Celle du passeport depuis lequel on a recommencé sa vie; celle d’une horloge, dont l’heure à jamais décalée qu’elle nous indique nous règle; celle du monde adoptif – qui dicte ses conditions d’appartenance, et vous fait prothèse légale (et non membre natif) de la communauté à laquelle il rive :
« Ton passeport
une horloge
et le monde » (p.30)
Etait-il poète avant l’exil ? Des images étonnantes et fortes témoignent d’une sensibilité protéiforme et archaïque : image (p.41) du nuage (polymorphe ou rien, qui doit ne tenir ni à sa forme ni à son coin de ciel ni à sa contribution réglée aux autres pour disposer de son être de nuage); image étrange (p.42) d’une « bouteille de Somalie », placée sur un tableau de François Boisrond, qui dit la greffe risquée, la transplantation improbable, l’assignation baroque à l’ailleurs – et pourtant la sagesse de se faire objet là où la vie nous pose, pourvu que ce soit avec art ! Assimilation poétique, en tout cas, de cet exil, avec une lucidité qui rôde partout, et hante l’espoir même du retour :
« Je sais, par ailleurs,/ que je ne reviendrai plus/ jamais/ avec la même valise,/ Ni avec le même visage,/ ni avec le même regard,/ ni avec les mêmes jambes … » (p.39)
C’est avouer, merveilleusement, que le retour au natal se fait ou fera, strictement, selon le monde adoptif. Revenant chez lui, c’est un autre – et non lui-même – qui cessera d’y être un étranger. C’est en français (et en Français !) qu’il se saisira là-bas né là-bas, comme le dit une formule paradoxale (puisqu’il est né en 1959 au Chili, et y a grandi à Talca et Valdivia, avant d’être expulsé avec sa famille vers l’Europe en 1977), ludique et infiniment sérieuse :
« car je suis né en France
dans une ville
qu’on appelle Talca,
à deux pas de Valdivia » (p.39)
Il y a, dans ce sobre et admirable petit recueil, la conscience d’une tragédie (l’exil – p.51 – , ce sont les stations d’un Calvaire sous un Dieu auquel on ne croit pas !), comme dans cet aveu : « Il faudrait qu’un jour prochain/ tu prennes l’avion/ direction Santiago du Chili./ Ta mère décédée doit se dire,/ peut-être, que son plus jeune fils/ est vraiment un ingrat » (p.60), mais la foi en la vérité (qui seule, permet de se dispenser de toutes les autres fois) y est bouleversante, et partageable :
« Pourtant, les cierges de l’église brûlent
et je sens fondre la cire entre mes mains de pierre.
On m’annonce que le pommier est en fleur.
C’est peut-être vrai.
(Mes yeux ne peuvent pas apercevoir cette
géographie qui m’arrache) » (p.61)
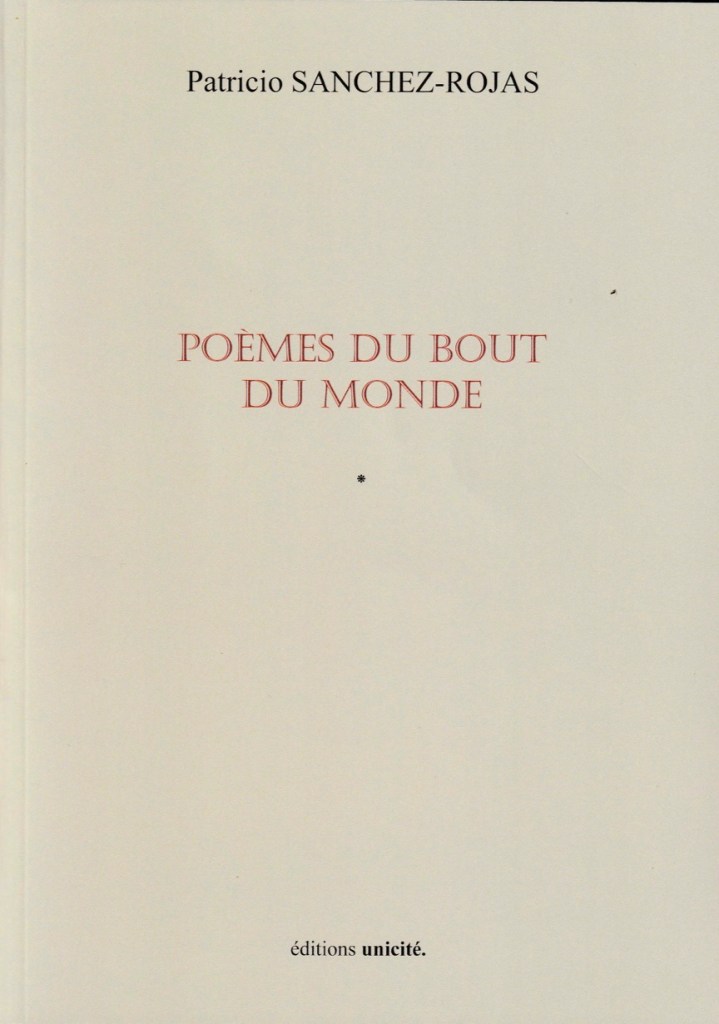

 Rémy Cornerotte, Seul, poèmes retrouvés, avec des photographies de Jacques Cornerotte, éditions Traversées, janvier 2018, 68 pages, 15€
Rémy Cornerotte, Seul, poèmes retrouvés, avec des photographies de Jacques Cornerotte, éditions Traversées, janvier 2018, 68 pages, 15€

