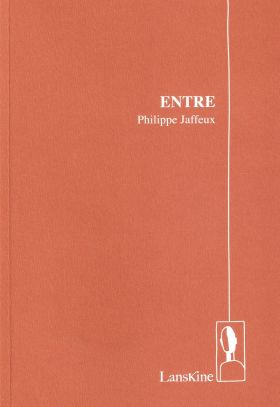Chronique de Lieven Callant

Philippe Jaffeux, Deux, Tinbad, Théâtre, 2017, 21€

La première fois que j’ai eu devant les yeux « Carré blanc sur fond blanc » de Kasimir Malevitch, j’ai pensé que l’artiste avait posé le geste ultime, qu’ensuite plus aucun peintre ne pourrait plus chercher à représenter le monde en pensant que c’était l’un des buts ultimes de la peinture, de l’art. C’était comme si Malevitch venait de tuer la peinture.
Il est bien des poètes qui posent à leur tour des gestes aussi extrêmes, remettant en cause non seulement le rôle du poème, de l’écriture mais aussi et surtout le rôle du poète et de sa place dans le monde qu’on scinde à volonté en catégories de genres, de styles.
Je pense que Philippe Jaffeux est de ceux qui poussent la réflexion artistique et donc poétique jusqu’à une de ses ultimes étapes et ce dans chacun de ses textes qui sont particulièrement difficiles à classer.
Ici, pour « Deux » on nous annonce qu’il s’agit de théâtre et sont effet rassemblés par Jaffeux les ingrédients de base: Un semblant de dialogue, des répliques alternativement numérotées N°1 et N°2. Un espace à multiples dimensions: la scène. Des acteurs autant que les lettres de l’alphabet, symbole cher à Jaffeux se partageront les 1222 répliques. Une thématique centrale: IL.
« IL existe à l’intérieur d’un silence qui dompte sa rencontre avec un malentendu théâtral. » Notre hôte habite une représentation théâtrale de notre voyage »
IL est ce qu’on désigne, c’est l’autre mais c’est aussi soi-même considéré comme un autre. IL c’est un dieu, (le God d’ « En attendant Godot » comme l’on remarqué certains chroniqueurs) un être créateur qu’on entoure de mystère et de respect parce qu’il pose l’acte, parce qu’il parle.
IL, le langage. IL, la pensée basique. IL, îlot. Lieu réservé entre scène et coulisses, entre salle de spectacle et cour.
« IL » pourrait tout aussi bien être un signe graphique: deux lignes verticales, une ligne horizontale. Le L dessine un angle droit, le coin d’un cadre et ce qui permet de délimiter un espace et de l’orienter.
Rien ne pourrait m’empêcher de penser que si les répliques peuvent être permutées et partagées selon le choix des acteurs de la pièc,e qu’on ne puisse pas aussi permuter les mots, leurs significations et construire ses propres lectures en associant mots et images, connotations et sous-entendus grâce à ce que disperse dans ses textes Philippe Jaffeux. Les interlignages, les blancs, les silences, les transparences, les oublis, le vide, la page blanche sont récurrents et reviennent constamment sous diverses formes dans le texte. « Une paire de numéros » représente une variété presqu’infinie de possibilités. À moi, lecteur d’établir le courant, des corrélations inattendues entre les locutions que met à ma disposition Philippe Jaffeux. L’auteur ne tempère pas son texte par des virgules.
Comme la peinture « Carré blanc sur fond blanc »de Malévitch ou celle de Piet Mondrian choisie pour la couverture, le texte de Philippe Jaffeux pose la question de la représentation. De la perception et propose une révolution de nos convenances esthétiques, visuelles et mentales.
« Deux » de Philippe Jaffeux n’est pas sans me rappeler « La dernière Bande » de Samuel Beckett où très peu de moyens sont engagés pour créer une pièce de théâtre qui se veut être une rupture, une remise en question des possibilités du langage à porter une pensée et à faire sens. Chez Jaffeux aussi on se rend compte qu’il s’agit surtout du monologue que l’artiste entretient avec sa propre oeuvre, son propre système de construction dérisoire, absurde, inutile mais qui pourtant revient à la charge avec ses questions, ses fausses affirmations, ses détournements, ses révoltes.
Jaffeux cherche à rompre nos habitudes de lecteurs qui font de nous très peu souvent des acteurs. La plupart du temps, on reçoit un texte et on en devient le passif spectateur.
« Deux », reprend les éléments chers à Philippe Jaffeux. Une structure de phrases simple où un nombre défini de mots, de blancs, d’interlignages sont permutés. Ainsi les sens des mots varient quelques fois en fonction du contexte et des assemblages. « Corps » fait à la fois référence à l’enveloppe charnelle d’un être vivant et à la taille d’une typographie, la place relative qu’elle prend dans l’espace. Le corps lié à l’interlignage détermine donc la lisibilité d’un texte. Notre corps nous rend-t-il plus vivant?
Bien des phrases s’attribuent aussi des sens aléatoires qui ne sont pas sans me rappeler les langues de bois, les compositions littéraires volontairement hermétiques qui masquent souvent le manque d’idées de leurs auteurs ou ne se limitent qu’à rassembler des mots parce qu’ils partagent des syllabes aux sonorités identiques. Le texte comme le corps d’un vide spirituel, comme l’écorce de ce que nous sommes. Alors lorsque le texte de Philippe Jaffeux livré à un coup de dé, au hasart, à une méthode arbitraire, tourne fou, se moque de la signification, je me permets subtilement de croire que Philippe Jaffeux aime tourner en dérision toute volonté de complexifier inutilement le langage pour de fausses raisons esthétiques.
Ne voit-on pas d’ailleurs les deux lignes noires de Mondrian s’entrecroiser dans le losange d’une toile blanche pou signifier un nouvel espace en révolte avec un cadre trop rigide et qui tend à restreindre l’espace infini de la pensée et du rêve?
« Deux » fait également directement allusion au système binaire, langage à la base de nos ordinateurs. On trouve sur le net les explications suivantes:
« Le système binaire est le système de numération ne possédant que deux chiffres : 0 et 1. Il utilise donc la base 2. Autrement dit, c’est une manière d’écrire les entiers naturels avec les seuls chiffres 0 ou 1.
C’est un système positionnel : les entiers s’écrivent comme une succession de 0 et de 1, mais la signification du 1 dépend de sa position dans le nombre : le chiffre 1 peut représenter un, deux, quatre, huit, seize, …
Les microprocesseurs des ordinateurs ne comprennent que le langage binaire. Soit le courant électrique passe, soit il ne passe pas. Mais il est facile de passer d’une base vers une autre. Par exemple 0 en base 2 est 0, 1 en base 2 est 1, 2 en base 2 est 10 et 3 en base 2 est 11. On peut également passer de la base 2 à la base 10. On peut même faire correspondre une lettre de l’alphabet à un nombre binaire en utilisant la table ASCII qui a été acceptée par tout le monde. C’est pourquoi on peut écrire sur un ordinateur : les lettres sont transformées en nombre binaire en utilisant la correspondance avec la table ASCII, nombre binaire que l’ordinateur peut comprendre.
L’élément IL comporte deux lettres, deux alternatives contraires, le 0 et 1, le oui le courant passe et le non, le courant ne pas pas. Philippe Jaffeux invente sa propre langue, sa propre mécanique et nous invite à le suivre en réinventant à notre tour la lecture. Pour nous guider, nous avons quelques consignes mais elles ne font certainement pas figures de règles absolues. Nous avons à marcher entre les lignes, à nous fier à notre intuition, notre imagination pour créer un sens si nous en avons besoin d’un.