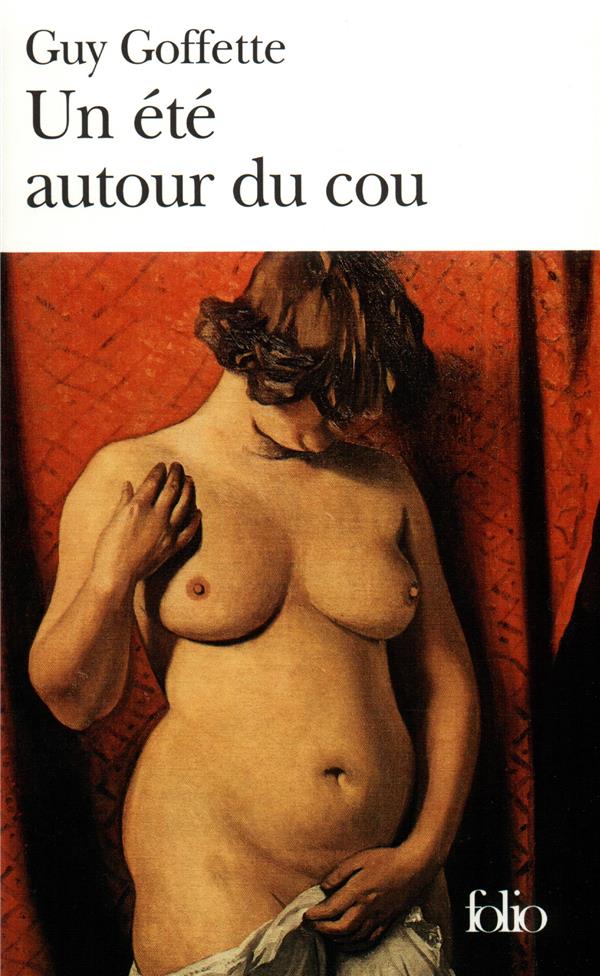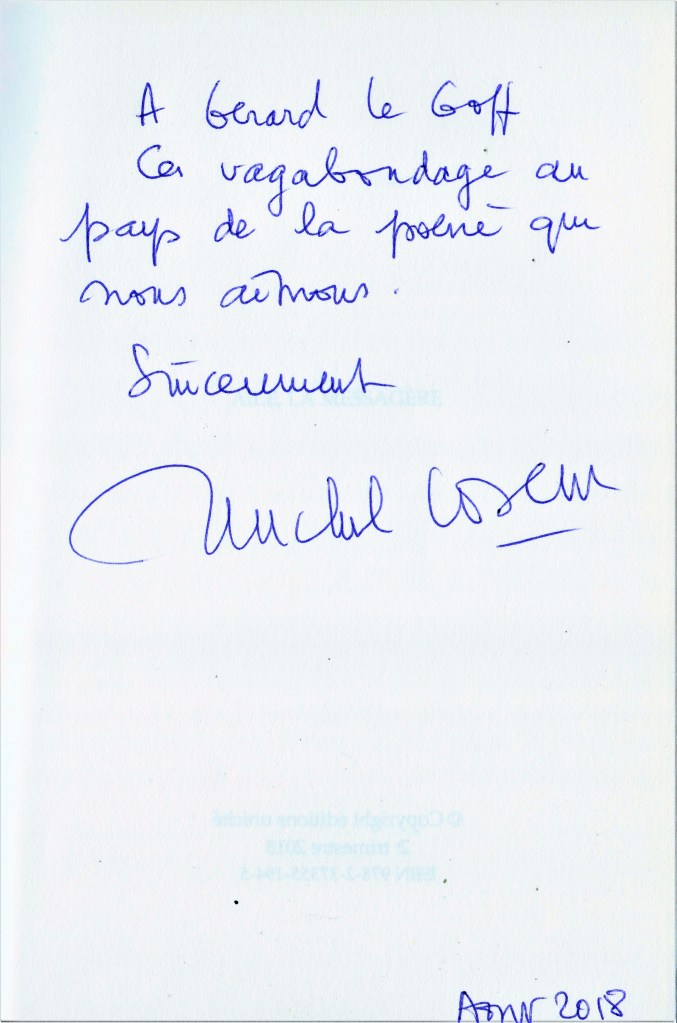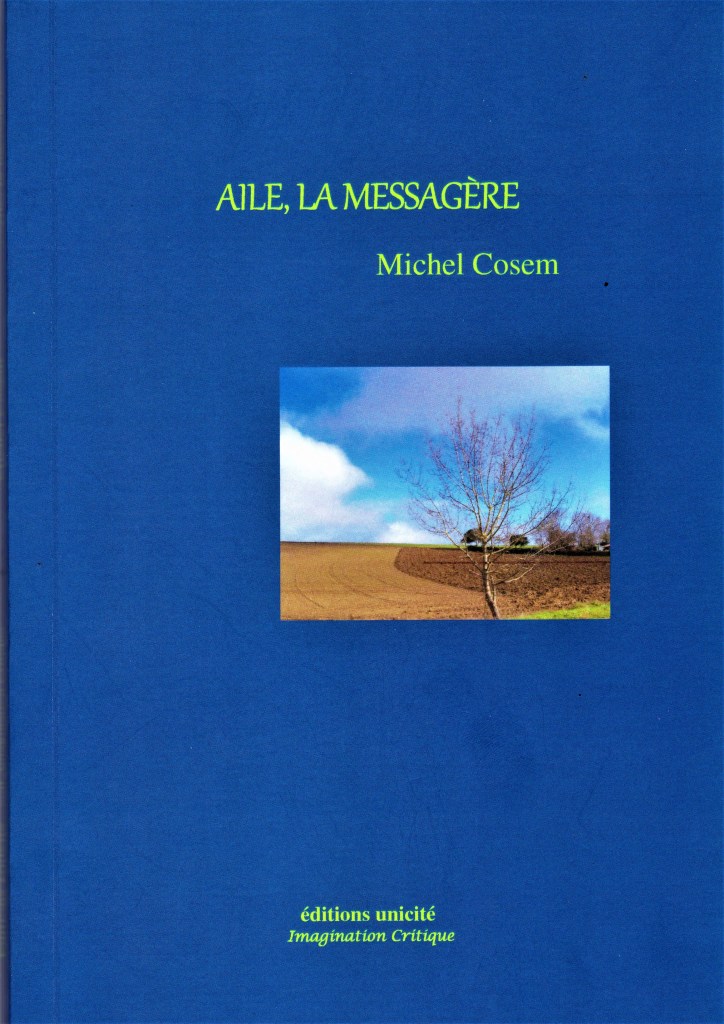Hommage à Paul Louis Rossi (1933-2025) par Marie-Hélène Prouteau, Médiathèque Jacques Demy, Nantes, 6 mars 2025.
Je voudrais intervenir ici en tant qu’écrivaine pour dire la part de reconnaissance qui est la mienne envers Paul Louis Rossi. Je l’ai rencontré à Nantes à la bibliothèque de la Maison de quartier du Vieux-Doulon en 1994, puis, en janvier 2008, pour l’hommage à Julien Gracq, salle Paul Fort. À ce propos, avec la disparition de Paul Louis Rossi après celles de Gracq et de Michel Chaillou, c’est un moment de l’histoire littéraire de Nantes qui s’en va.
Bien avant ces dates, ma première rencontre fut livresque avec Nantes paru chez Champ Vallon en 1987. Dans l’émotion de découvrir ces choses mémorielles si subtiles de son enfance nantaise. La cloche du campanile de Sainte-Croix, rappelant celle de l’église de Venise visitée, jadis, avec son père. Ou encore, certains jours, l’« odeur de café ou de vanille », ces petites résurrections du corps vivant de Nantes et de son histoire portuaire, restituées dans la chair des mots. Paul Louis Rossi est ce rêveur éveillé. Sur ma page facebook où je lui rendais hommage à sa mort, Pierre Michon a ajouté ceci : « Paul Louis Rossi. Le plus délicieux des hommes, le voilà dans les étoiles. Il y était déjà ».
Je retrouve bien là l’être-poète et l’effet qu’a produit sur moi la lecture de cet ouvrage Nantes en 1987. Combien cette prose tranchait alors, dans le formalisme du paysage littéraire marqué par Tel Quel ! Il fallait oser cette écriture du fragment en absolue liberté. Accueillant une parole de Bernanos des Grands Cimetières sous la lune à propos des trafiquants d’esclaves. Captant cette extase auditive, je le cite : « Ce carillon italien dans une Ville humide de l’Ouest / comme une couleur à nos yeux qui délivre quelque chose de vif, d’allègre, et de presque neuf ».
Un regard sur le monde, teinté d’onirisme, c’est la manière toute personnelle de Paul Louis Rossi. Liée à une expérience sensuelle et langagière qui joue sur la magie des langues, le breton, comme Le Queffelec, nom de sa grand-mère maternelle, l’Anse de Goulven ou bien évidemment la langue italienne, pour la musique et la peinture avec Fra Angelico, Artemisia Gentileschi. Qui joue sur l’espagnol « casida ». Ou sur les noms savants de la botanique. Comme cette phrase merveilleuse : « Je voulais revoir un fossile du crétacé que l’on nomme Lytoceras ». Et qui nous parle aussi d’« usines de construction de locomotives », de « gare de triage du grand Blottereau » et d’ usines de chocolaterie. Proust a capté la beauté imaginative des « noms de Pays », Paul Louis Rossi a donné leur dignité à ces noms du paysage industriel et ouvrier.
Une telle qualité de correspondances, d’analogies m’enchante, c’est la poésie même. Pour Paul Louis Rossi, tout communique, la géologie, la peinture, la musique, l’Histoire avec ses noirceurs. Comme chez Marguerite Yourcenar qui m’inspirait mes premières études littéraires publiées dans ces années 80 – mais bien différemment. Tous deux ont nourri ma propre écriture. Mon livre, La Ville aux maisons qui penchent en porte quelque trace. On écrit parce que d’abord on a lu et aimé, dans une sorte de trame mosaïque.
Il y a chez lui une évidence poétique de Nantes, comme Berlin en a une chez Walter Benjamin ou Naples chez Erri De Luca. Cela tient aux multiples présences humaines qui habitent sa ville, aux antipodes de celle de Gracq. Y passent les ombres d’André Breton, de Pierre de Mandiargues et une foule de figures picaresques, telle la mythique Isadora Duncan, en bateau sur le Nil, dialoguant avec l’artiste anarchiste Jules Grandjouan.
Pour finir cet exercice d’admiration, je voudrais évoquer les peintres, ses « alliés substantiels », selon la forme de René Char. Je me souviens avec ferveur de ce que Paul Louis Rossi écrit sur Lamber Doomer, sur William Turner en son voyage sur la Loire. Et des pages des Ardoises du ciel sur François Dilasser, son ami, le peintre finistérien qui peint des sortes de Kachina, ces poupées de la mythologie Hopi amérindienne.
La poésie est le creuset créatif des connexions et des méridiens. Merci à Paul Louis Rossi qui a su trouver pour nous le souffle et les mots pour ouvrir cet ample imaginaire analogique.