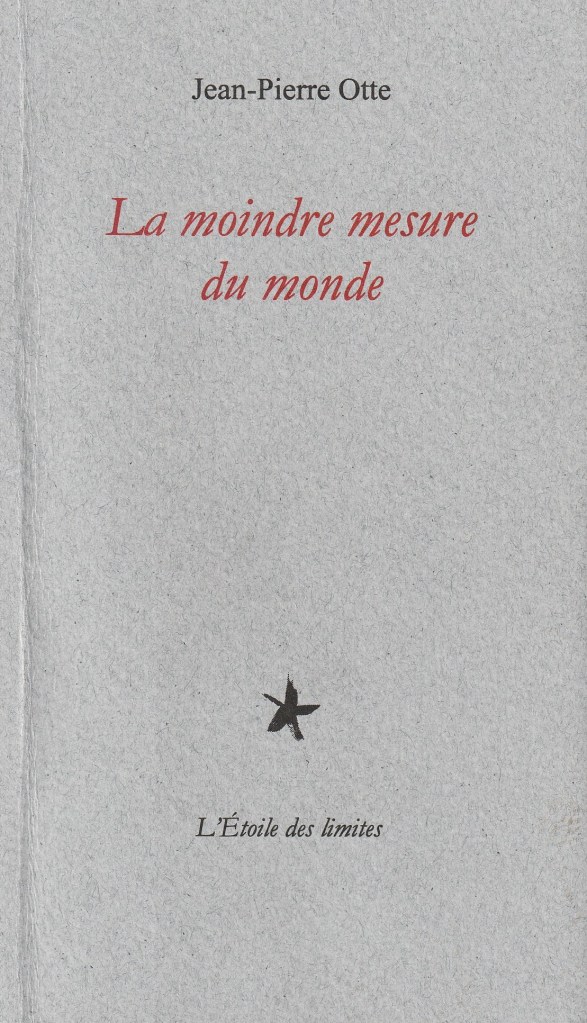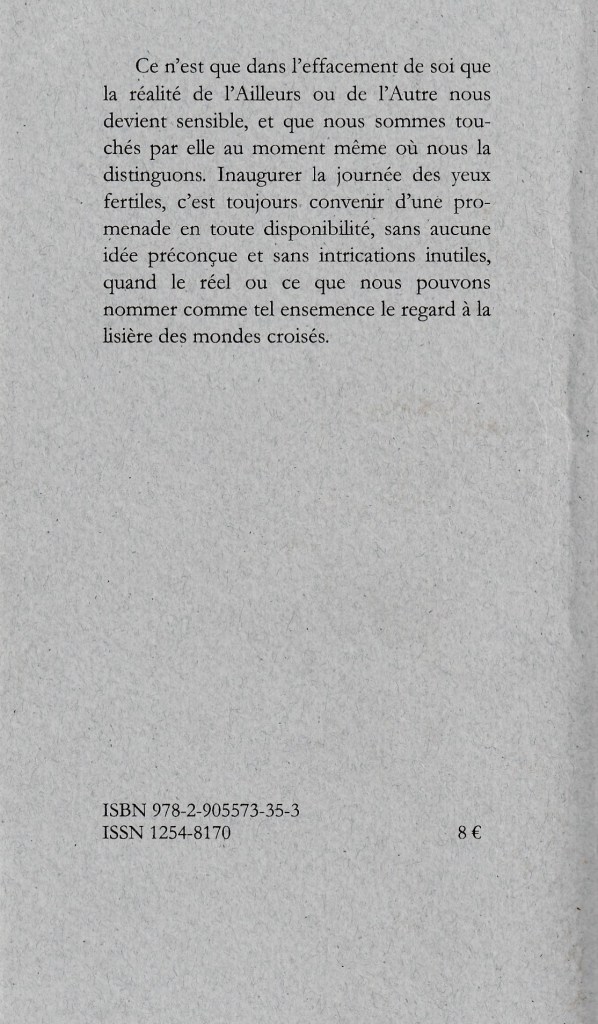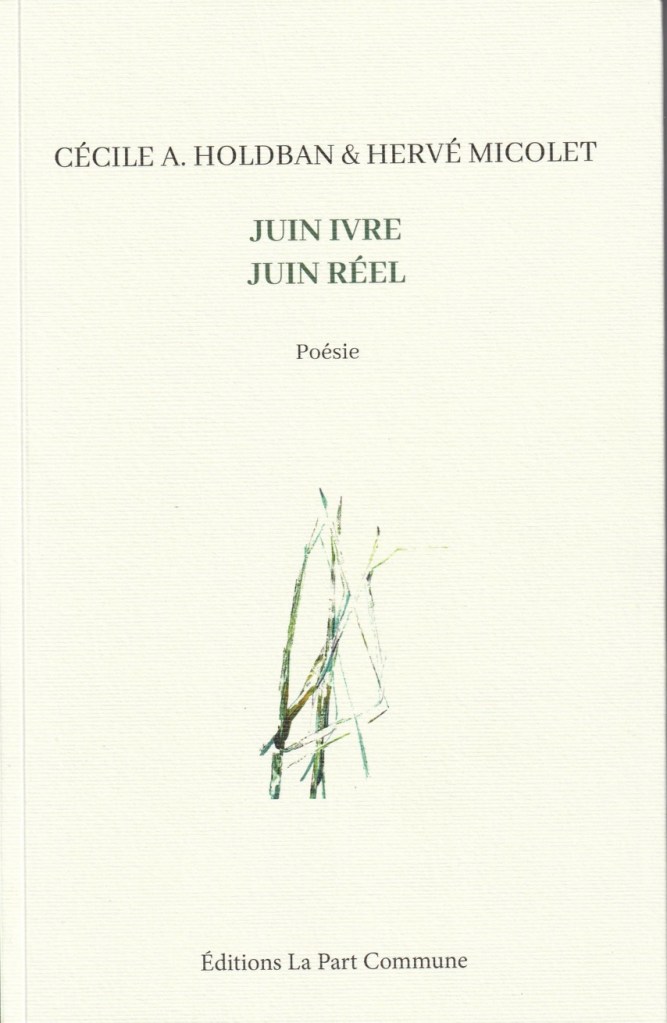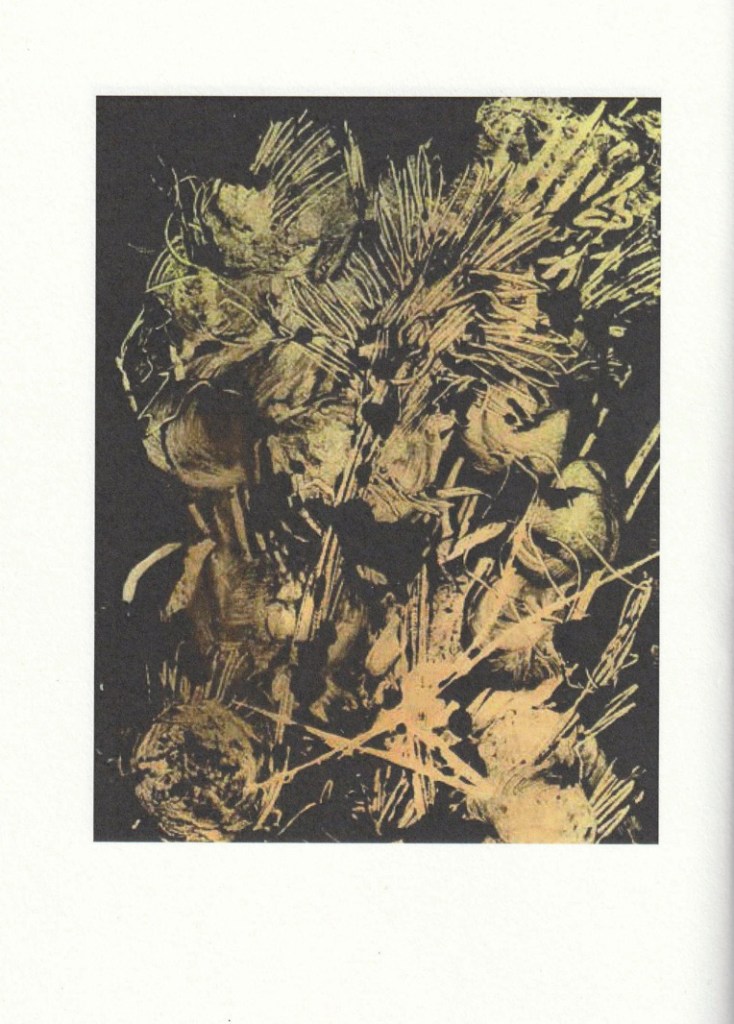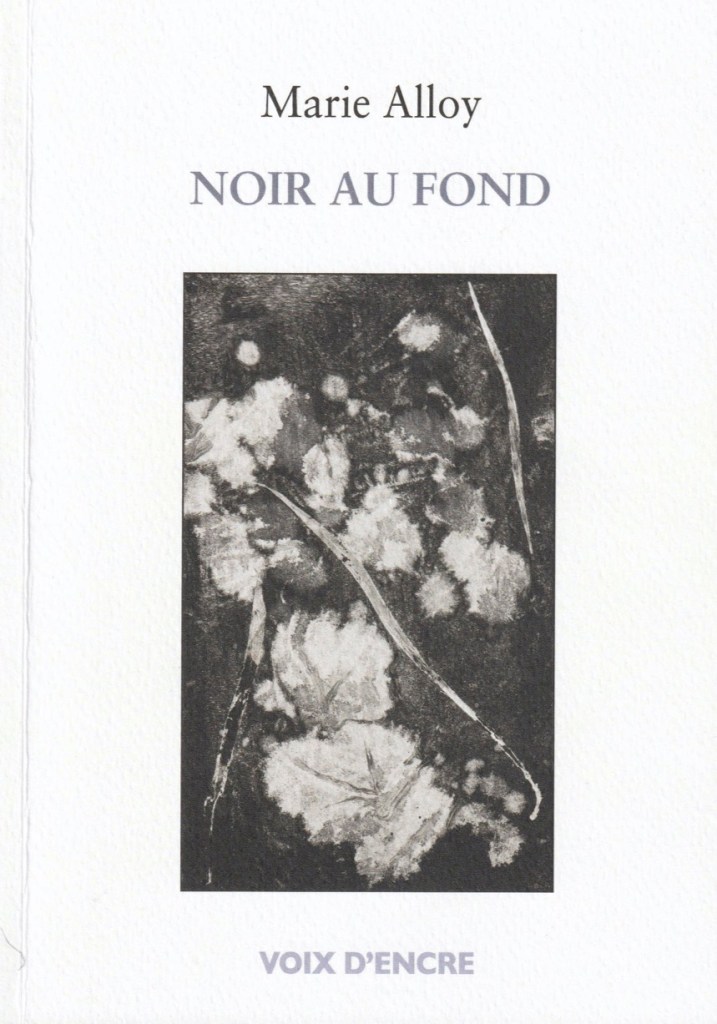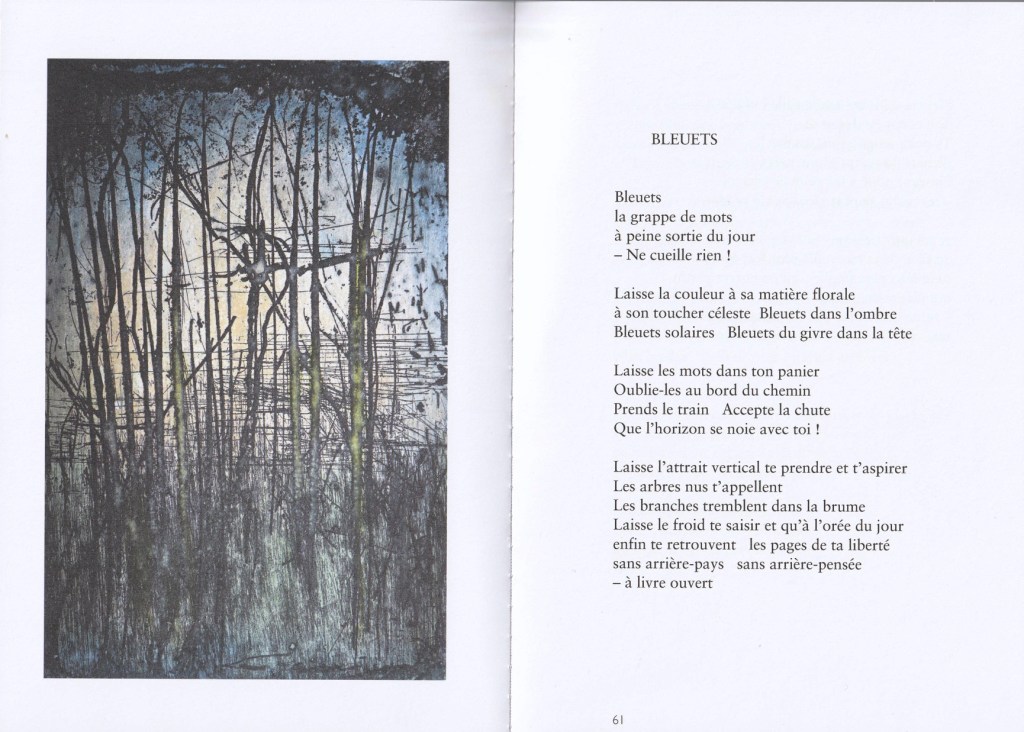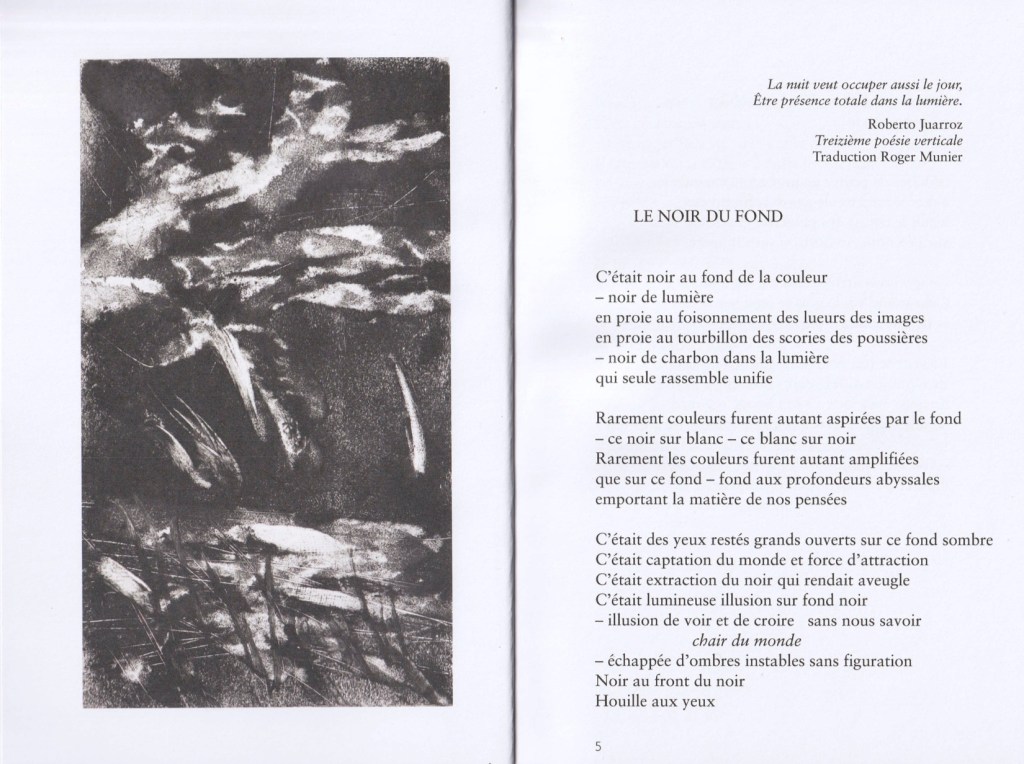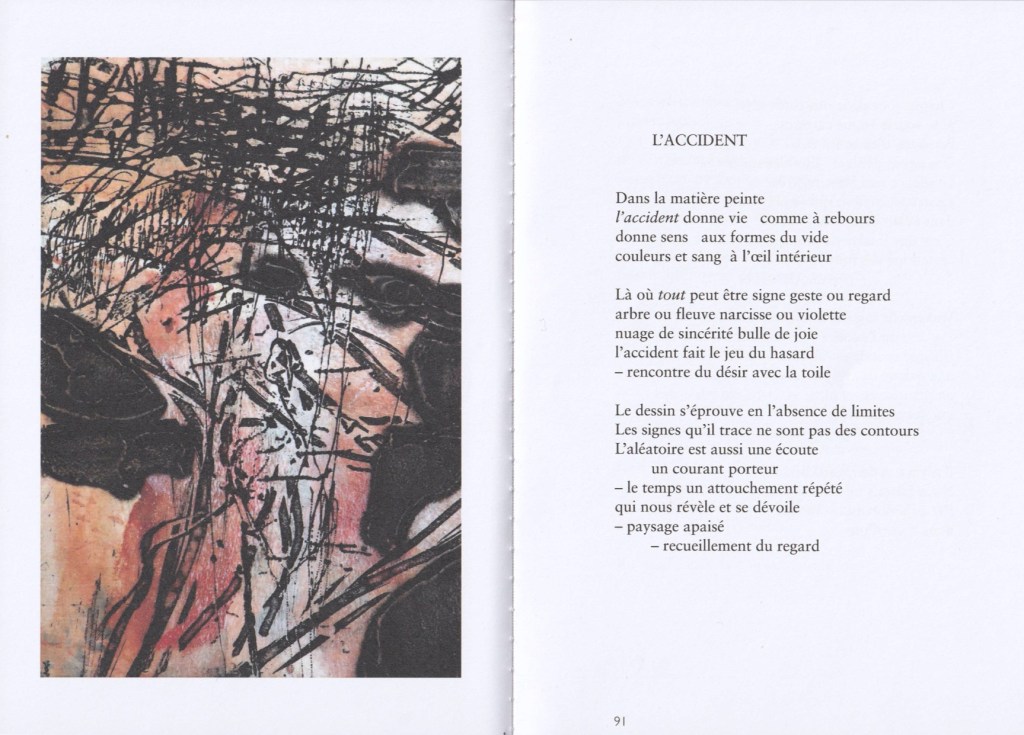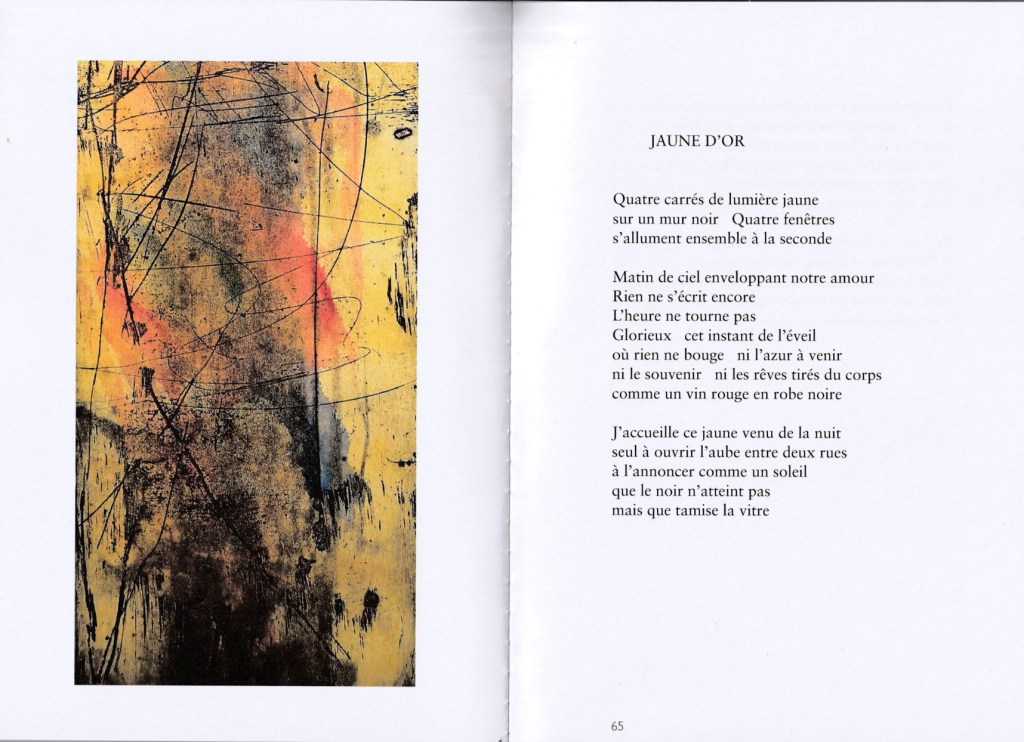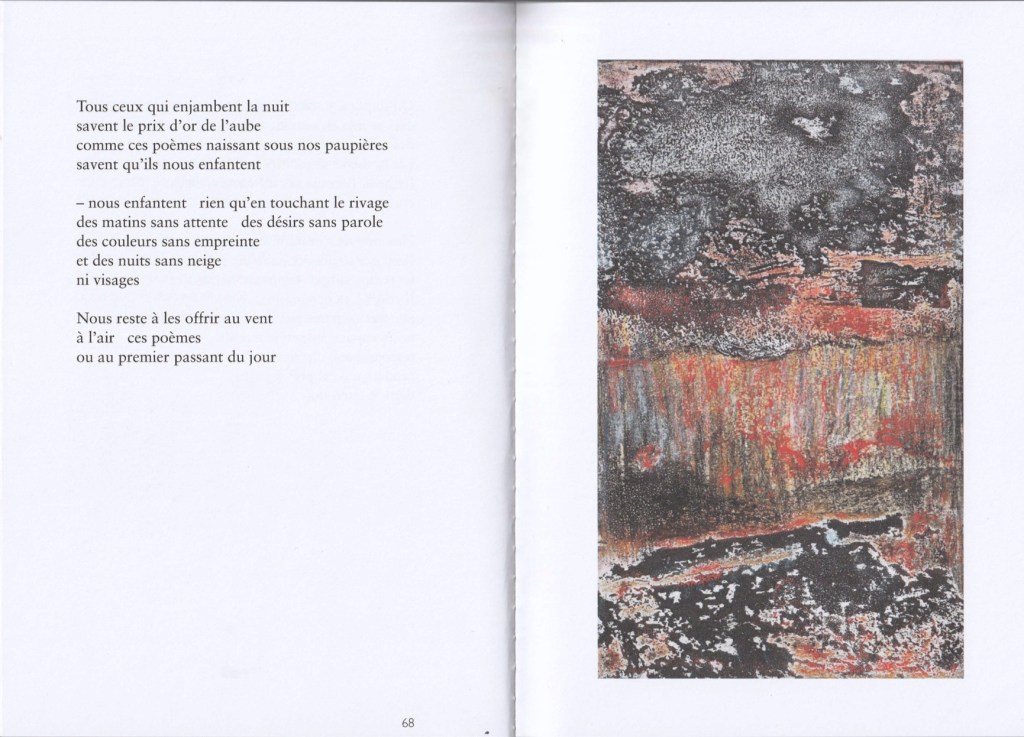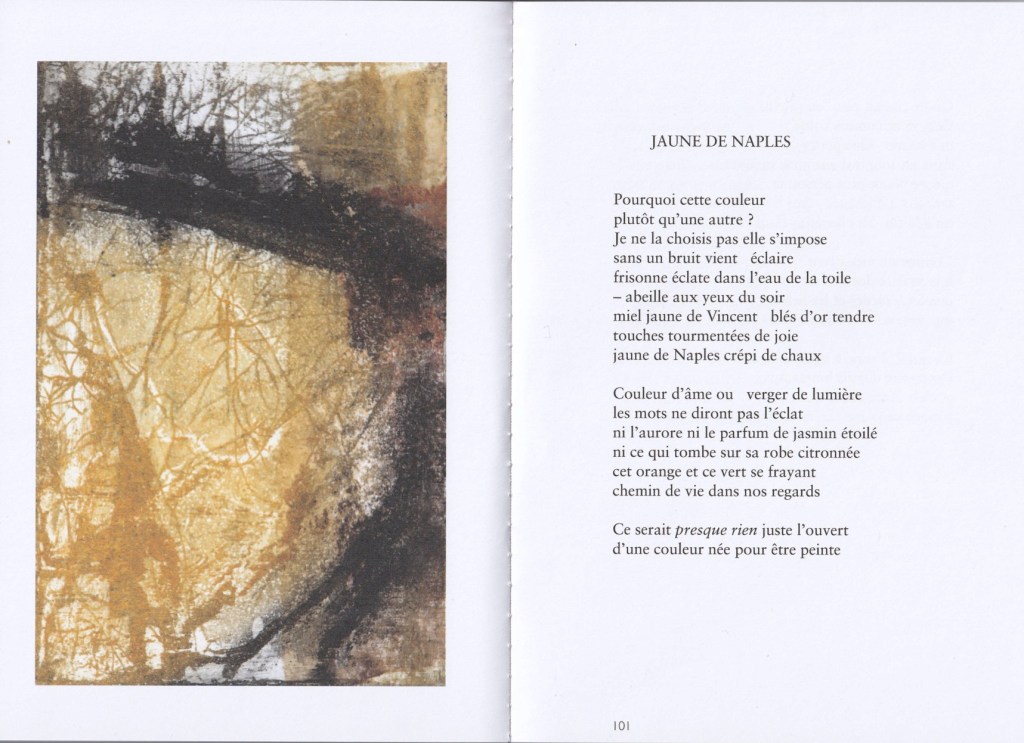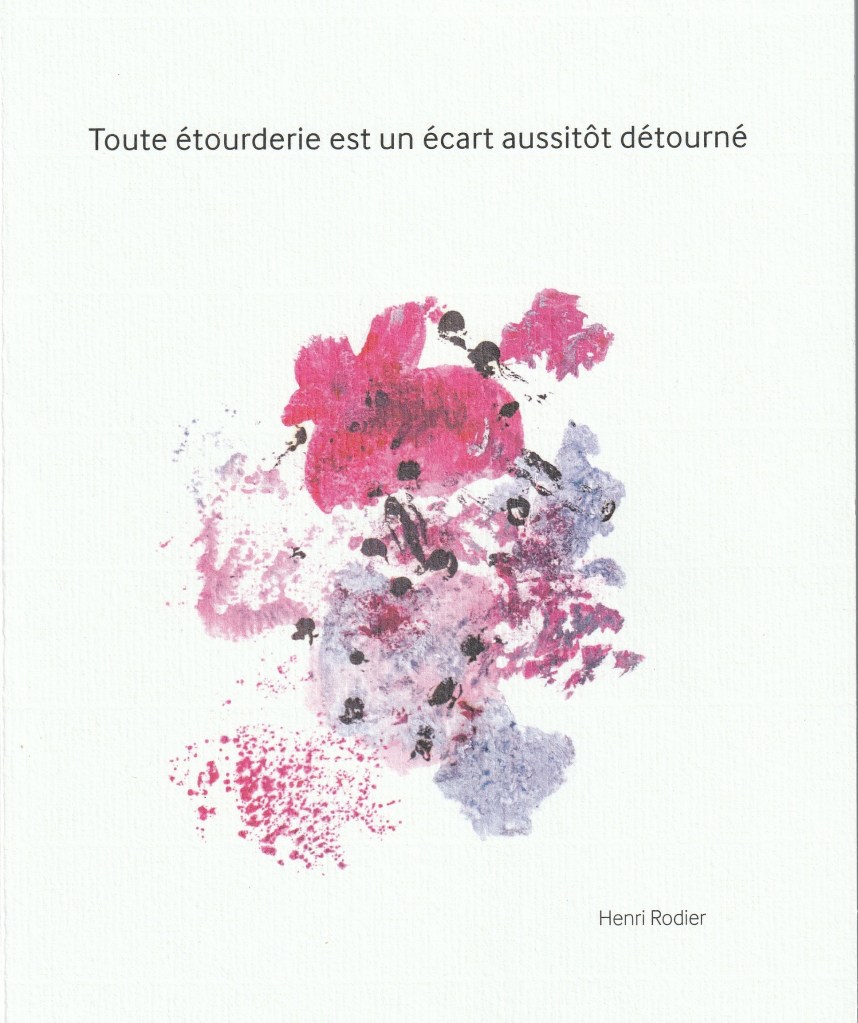Une chronique de marc Wetzel
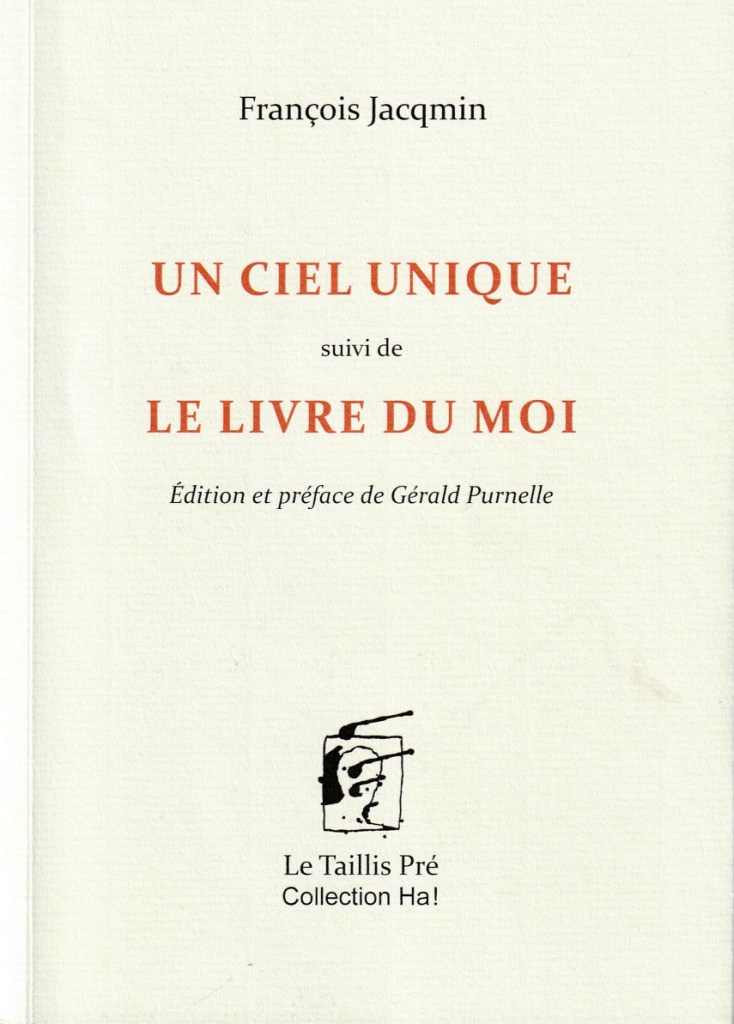
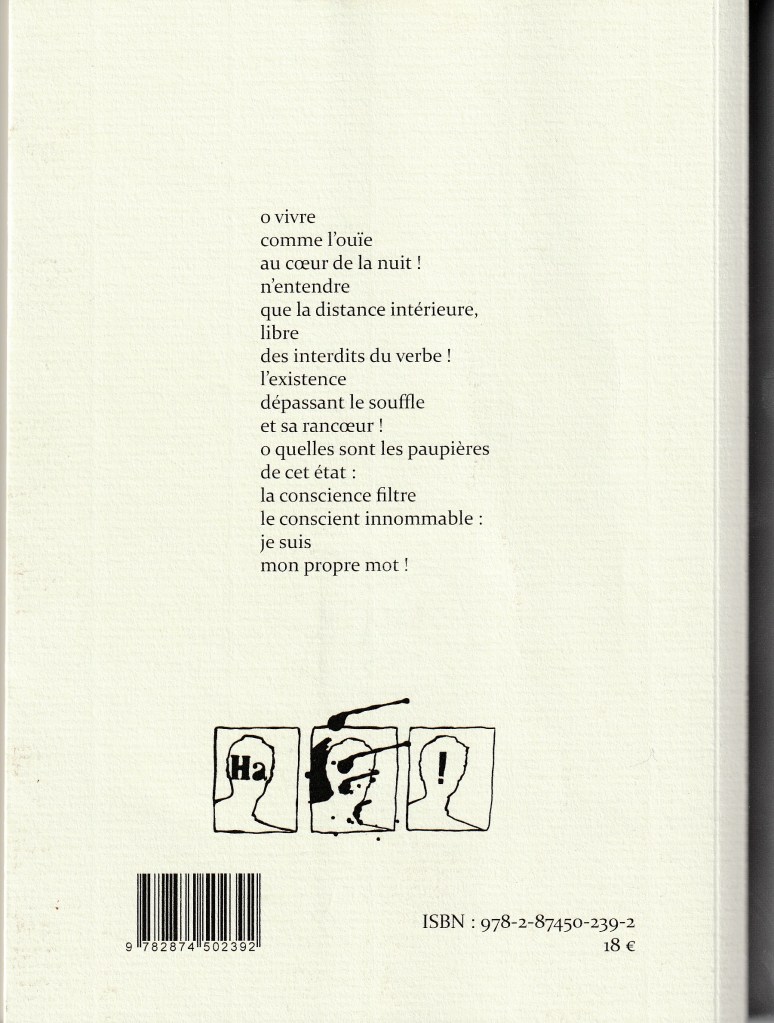
François JACQMIN, Le ciel unique, suivi de Le livre du moi, Édition et préface de Gérald Purnelle, Le Taillis Pré, 146 pages, mars 2025, 18€
Il y a dans ce titre de François Jacqmin (« Un ciel unique ») une manière de prière provocatrice, un mélange rare et terrible de colère et de nostalgie, qu’on peut résumer ainsi : sans ciel unique ( = sans vision unitaire rassemblant tous les mondes réels et possibles en un Univers saisi dans sa Totalité), aucune vie humaine ne peut valablement s’orienter et juger objectivement de sa propre importance : s’il n’y a, pour une existence, que des horizons épars, et des enveloppants locaux, alors cette existence ne pourra pleinement saisir ni son sens ni sa valeur. Mais voilà : par quels moyens peut-on saisir l’unicité du « Ciel » ? Par les seuls moyens humains du langage articulé et de la conscience (pour leurs capacités exclusives de formulation partageable des rapports et d’attention à la présence propre de leurs objets, sans lesquelles aucun Tout ne peut être objectivement présent); or ces « moyens » prestigieux sont (telle est l’intuition farouche et désespérée de l’auteur) falsifications mêmes du sens et de la valeur de ce à quoi ils font accéder. Le langage (le « verbe » chez Jacmin), qui croit pouvoir percer le mur de l’existant (p.48), n’est que « fou de sa misère » propre ! (p.52) : « Le mot est partout » écrit-il radicalement, mais « l’expression nulle part » (p.53); quant à la conscience humaine, elle est comme une curiosité maladroite et partiale, ne cessant de « s’affairer en d’insondables soins » (p.34), ignorant de quelle présence lui vient son expérience même de la présence (n’est-ce pas « une poussée d’être jusqu’ici inconnue » qui aura dressé le « mât de la conscience », et le « dépasse » donc toujours déjà ? p.39), conscience sublime et dérisoire comme le serait un trou de réalité prétendant en saisir la plénitude et complétude même !
Ainsi, tout ce que la pensée logique et consciente vise à pénétrer et réduire du « Ciel unique » des choses échouera sur un « visage clos de l’univers », qu’elle ne peut pas du tout « crever » (p.51). C’est que l’ordre qui « participe à la constitution des choses » est lui-même impensable (id.). L’homme n’y peut qu' »infecter » (douloureusement ou grotesquement) les facultés mêmes qu’il met en oeuvre pour y parvenir; Jacqmin le dit extraordinairement :
« o réel impensable
et intenable !
la lucidité
et l’ivresse même
sont des catastrophes
de l’être :
o rien
n’est censé être pensé :
lorsque la nuit
de l’inertie
s’abat sur l’homme,
une énorme infection
de toutes les facultés
guette
et s’empare de l’homme » (p.50)
C’est l’activité même de contemplation, de méditation de l’ordre universel, qui est ainsi faussée, empoisonnée, disqualifiée par principe : si « rien n’est » en vérité « censé être pensé » – comme dit si énergiquement l’auteur -, c’est d’abord que tout est pensé, à tort, être sensé ! C’est que, pour être animal parlant et réfléchi, un homme doit avoir d’abord existence – et l’existence est toujours, pour Jacqmin, énigmatique et particulière : elle est insondable (pour elle-même) comme un « infini privé » – « l’infini privé est la règle », écrit-il ! – et surtout l’existence est fragment fini et dépendant, simple rouage local et transitoire, enraciné dans le sol même qu’il prétend quitter, ou pas infinitésimal d’un grand Devenir qu’il prétend pourtant arpenter (alors que « la personne est intégrée au chemin » !!).
En termes philosophiques, une telle existence monadique (Leibniz : une substance particulière quelconque, qui dispose de sa propre force d’action et de perception au sein des choses, et pourrait miroiter, de son seul point de vue, l’unité du Tout du réel auquel elle appartient) est ici devant une alternative ruineuse : ou bien elle est microcosme réussi, reflet concentré (et expression représentative) de l’Univers, mais alors elle est aussi illisible que lui; ou bien elle n’est, dans ce même Univers, qu’une miette égarée, et elle ne pourra lire alors du Tout que l’absurdité propre qu’elle y projette. C’est le Charybde et Scylla de toute position d’un ciel unique, et la colère métaphysique ou l’agité désespoir de François Jacmin peut ainsi, peut-être, s’y fonder.
C’est que, pour lui, l’ordre universel – s’il y en a un – est muet et ne se dévoile ni se découvre (il ne s’offre pas aux êtres parlants) : qu’il puisse se « révéler » est l’espoir le plus illusoire. La vie pensante est donc toujours d’abord existence particulière, ne se détachant jamais assez du Tout qu’elle prétend surplomber : on ne peut pas devancer ce dans quoi se trouve notre origine même. Et, dit-il, le retard pris par l’existence logicienne et méditante de l’homme sur « l’huile insipide et lourde des choses » (p.54) est incomblable. Il faudrait pouvoir, dit son ironie amère, pas moins que « contourner l’univers » (p.32) pour saisir l’Unité dans son jus ! Et le moi humain n’est « pas instruit de sa mission » (une porte locale, de fait, née de gonds inconnus), comme la Mission (éventuelle) du Tout pour lui-même échappe au verbe humain (qui ne sait que dénuder ce qu’il prétend décrire, écorcher ce qu’il veut saisir) : « la race/ est pleine de cette absence / les mots/ ont enlevé la robe/ de matière/ qui faisait les choses » (p.27)
La seconde partie (« Le livre du moi ») de ce recueil paraît tirer la conséquence de cet échec métaphysique sans appel : comment conserver l’unité du moi humain malgré l’absence (ou le caractère illusoire) de l’unicité de son Ciel ? Quels affects authentiques peut-il encore y avoir pour un moi ainsi orphelin de l’Un ? C’est en quelque sorte le délabrement psycho-pathologique qui suit de la faillite cosmologique (le vocabulaire de Jacqmin est beaucoup plus libre, ironique et virtuose, mais il semble bien que c’est ça) : si l’idée d’Univers échoue (puisque sa formation en nous est impossible, ou contradictoire), quel monde valable reste-t-il à nos idées mêmes ? L’insistance exceptionnelle de Jaqmin sur le rôle et le statut de l’idée (les poètes se méfient ordinairement du terme, lui préférant image et sentiment, comme seuls états pertinents du rapport à soi) alerte : (« tout, dans le moi,/ est contraire à la source / l’instant est dénaturé, / réduit à la multitude / des idées / o quel hiver est semblable ! » (p.83). Sans l’idée du Monde, le moi perd ses propres lignes d’unité : allusions à la dépression (par glaciation de la puissance de figuration, p.63), à la paranoïa (par l’impression qu’une pensée observe Jacqmin pour le défaire, qu’il ne peut circonscrire ni parer, p.66), à la schizophrénie (il perd sa pensée comme Artaud, il la sent se diviser dans une indistincte neige d’idées, p.68, p.71) et la dépersonnalisation y semble proportionnelle à l’intensité des idées qui le traversent (« la pensée/ est le combat d’autrui/ la fêlure d’autrui !« , p.72). Voilà : l’homme n’a plus que ses idées pour se rebâtir un monde, mais l’idée n’est qu’un « refus du monde » (p.81). L’anodine et sympathique idée (qui se propose modestement en essai mental de rapprochement éclairant, et avançait en débrouilleuse fiable de rapports cachés) s’avère bien plutôt soudain « une altération du mal intense, une soif de l’improbable que le temps même avale sans joie ! » (p.81). La résolution des énigmes du monde par l’idée n’était donc qu’un piège. On passe alors de Leibniz à Plotin – mais un Plotin geignard et aux ailes coupées : l’unité sans substance tournait court, voici que la diversité sans maître tourne mal. Une chute dans le temps, dans le mal, dans le délire accompagne la « procession » indéfinie vers l’émiettement de la réalité. Aucun retour, aucune « conversion » vers l’Être et l’Un n’est plus possible, ni même souhaitable : rien dans l’univers ne peut plus protéger notre exploration même de lui :
« quelle est cette disposition
d’être,
ce mal qui évite
la protection de l’univers,
cette propension médiocre
pour le péril
et le secret :
l’infamie se développe
autour de ce feu :
l’aube d’hiver
lui ressemble … » (p.85)
Il faut lire ce livre : l’admirable travail de présentation et restitution de Gérald Purnelle nous met devant les yeux le parcours hors-normes d’une pensée utilement tragique.
—-
On rappelle ici le remarquable « Traité de la poussière », publié en 2017 par les éditions du Cadran ligné.