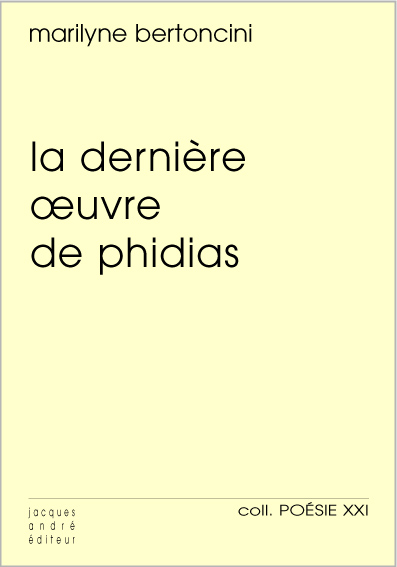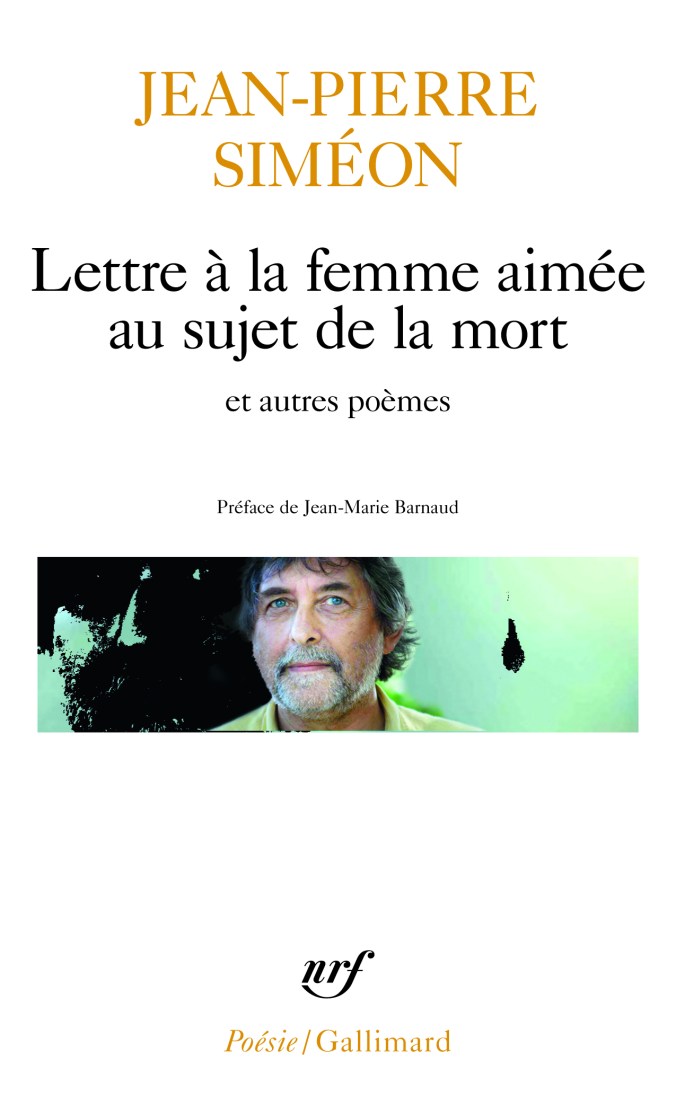Chronique de Xavier Bordes
Jean-Claude Pirotte – Ajoie précédé de Passage des ombres et de Cette âme perdue (Préf. De Sylvie Doizelet – Ed. NRF Poésie/Gallimard).
Malgré une sorte de nomadisme invétéré (« Je me transporte partout » sera le titre d’un prochain recueil posthume), forcé aussi bien que libre, malgré certains coups du sort tragiques (le suicide de sa fille aînée), Jean-Claude Pirotte, récemment disparu, nous laisse une somme impressionnante d’écrits, au premier rang desquels des poèmes, à laquelle il faut aussi ajouter de la peinture, des activités d’édition, d’épistolier, bref, les reflets d’un dynamisme et d’une énergie hors du commun : poèmes de toutes les sortes, sur tous les thèmes imaginables, rimés ou non, moins fantaisistes et riches d’invention verbale que ceux de son contemporain Jean-Pierre Verheggen, moins sérieux, mélancoliques et réalistes que ceux de son autre contemporain William Cliff, les poèmes de Jean-Claude Pirotte se tiennent en quelque sorte à équidistance entre ces deux représentants de la poésie wallonne. Ils sont capables de toutes les nuances, gaieté mêlée de mélancolie, humour secret ou ironique, attendrissements simples et qui ne se prennent pas à leur propre piège de nostalgie. On a l’impression que Pirotte a toute sa vie écrit en se tenant sur le fil de son existence (et sur la frontière intellectuelle entre la littérature française et la néerlandaise) comme un équilibriste de l’inattendu : un bout de sa perche touchant à de sombres nuages, l’autre bout à des cieux brillants, et lui au-milieu, avançant tantôt avec et tantôt contre un vent familier. Comme tout poète qui évolue dans la sphère d’un optimisme amer, ou d’une amertume humoristique, – sphère qui est typique de la culture d’une aire géographique que Breughel, Frans Hals, Ensor, Delmotte, Magritte, Delvaux (etc, etc…), ont illustrée en un temps qui ne se souciait guère de frontière linguistique -, Jean-Claude Pirotte écrit d’une plume à la fois simple et rouée, observatrice et lucide jusqu’au détail crucial, voire cruel, tout en étant pleine de coeur et de bienveillance, techniquement rompue à toutes les virtuosités, nourrie de l’histoire de la langue française et de ses racines gréco-latines en particulier.
Cette vision « latine », précise, dans son esprit fusionne avec l’arrière-plan plus germano-nordique : ce dont témoigne par exemple le côté « intérieur flamand avec objets nets », tel l’arrière-plan d’une peinture de Van Eyck ou de Vermeer, de ces régions du Nord dont Baudelaire disait : « là tout n’est qu’ordre et beauté… », qui apparaît dans un poème comme celui-ci (précisément tiré d’une section de Passage des ombres intitulée Natures mortes, p. 69) :
la tabatière d’écaille
on l’a posée sur le livre
à la reliure ancienne
mais du titre en lettres d’or
un mot se devine à peine
ce serait le mot enfance
il y a des fleurs séchées
dans une chope d’étain
à gauche l’appui de fenêtre
reçoit un trait de lumière
qui se réfracte à travers
les lunettes oubliées
peut-être par Jean Follain
Poème typique de Pirotte, de son rapport à la peinture (« Ut pictura poiesis »), l’oeil du peintre sous-jacent au regard du poète, tel l’oeil de Félix Valotton par rapport aux « papiers » de Charles-Albert Cingria, nomade plus ou moins forcé, comme lui. Le paysage a donc évidemment une importance capitale, dans une tradition qui remonterait, mettons, à Denis van Asloot, Bloemen ou De Cock :
les beaux pays les arpents clairs
la brume lumineuse l’air
suspendu parmi les saules
les mouettes aux longues ailes
et le miroir des canaux
la compagnie des corneilles
autour du clocher solitaire
et les bouquets artificiels
au pied des tombes oubliées
L’on sent bien que la beauté claire de ces paysages recèle en profondeur la nostalgie de « l’oublié » contre laquelle, par une forme de « persistance de la mémoire », lutte précisément un poème comme celui-là, (que j’invite le lecteur à lire en entier page 286 du volume Poésie/Gallimard.) Ce qui réjouit dans ce volume qui réunit trois parmi les derniers recueils de Jean-Claude Pirotte, c’est qu’on y lit un poète qui (à l’instar du romancier certes) s’est « carré » dans sa vie paradoxalement peu stable, et qui habite son monde avec une ardeur que n’entament pas la lucidité manifestée par des traits d’humour et une appréciation des choses distante et ironique (souvent par allusions cachées ou citations d’autres auteurs), encore que cette ironie soit souvent latente, imperceptible, et ajoute à la force émotive de son poème. Dans le poème que je viens de citer ainsi que dans le titre de la section, cet imperceptible est à l’oeuvre : de fait, rien de plus vivant que l’oeil qui nous découvre cette « nature (soi-disant) morte » en dévoilant au passage, dans une chute qui ouvre sur le rêve, avec l’habituel brin de secrète nostalgie correspondant, la présence du poète ami à travers des lunettes oubliées, qui au demeurant ne sont pas obligatoirement les siennes. Là est la souriante, mais aussi profonde – sans drame – intensité poétique de l’écriture de Pirotte, celle qui charme par son ton inimitable et ses trouvailles subites, son goût « charnel » pour les lieux, les objets, les gens. Lire Jean-Claude Pirotte, c’est s’initier à sa façon intense d’habiter poétiquement la Terre ; de se creuser, tout errant que l’on y soit et promis à la quitter, des sensations, des images, des gestes, des paroles, bref, une façon d’être « profondément enracinée [même si c’est] partout », en laquelle sont étroitement amalgamées une âme d’adulte pensif avec une âme d’enfant qui a résisté à tout jusqu’à la fin. Pirotte, c’est la vie poétique par l’exemple, qui lui survit à travers une œuvre dont on se demande comment il a pu, à travers sa vie chahutée et ses multiples activités, la réaliser tant elle est considérable…
(Mars 2018)