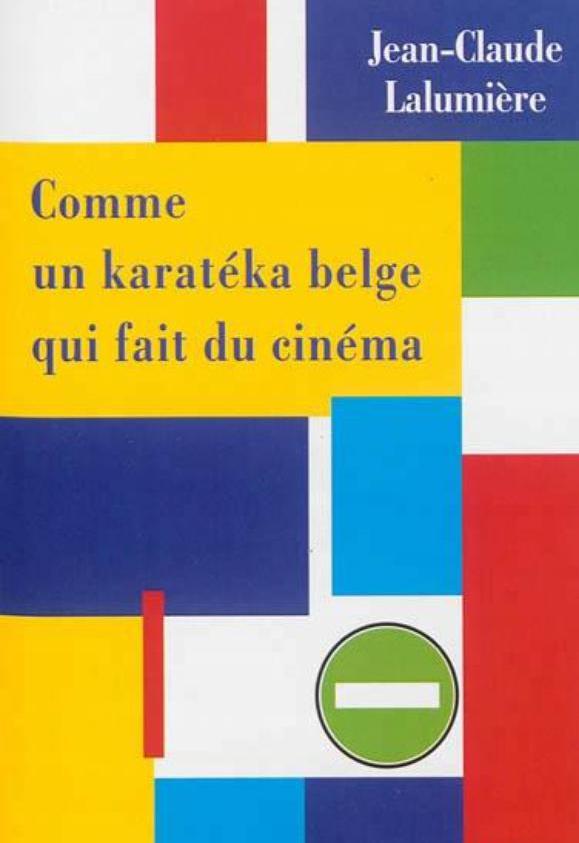RENTRÉE LITTÉRAIRE SEPTEMBRE 2014
Entretien avec Serge Joncour à l’occasion de la sortie de son roman:
L’écrivain national – Flammarion ( 400 pages – 21€)
Propos recueillis par Nadine Doyen
ND:Vous avez déclaré pour des romans précédents que le choix du titre s’avère souvent difficile. Qu’en a-t-il été pour celui-ci? S’est-il imposé d’emblée?
SJ: Oui, dès le départ. J’ai gardé le titre de travail.
ND: La Belgique a son poète national, l’Angleterre aussi, pensez-vous qu’un jour, en France, on puisse aussi avoir « Notre poète national ou écrivain national »?
SJ: Pour moi c’est et ça reste Victor Hugo. Mais à vrai dire l’appellation concerne tous les auteurs qui publient, aujourd’hui, chez un éditeur national…
ND: Le choix de l’illustration du bandeau fut-elle délicate?
C’est toujours délicat de choisir une image qui illustre son livre.
SJ: Je fais confiance à l’éditeur.
ND: Le lecteur ignore le travail en coulisses quant à la finition d’un manuscrit. Pour atteindre la perfection, pouvez-vous évaluer le temps consacré à la relecture et corrections?
SJ: Plus de deux mois. L’équipe Flammarion dirigée par Alix Penent l’éditrice, apporte un grand soin à ces dernières étapes d’un manuscrit devenant un livre. C’est à cette application et cette rigueur qu’on voit qu’un bon éditeur: c’est précieux.
ND: Horace Engdahl souligne le côté ingrat du métier d’écrivain qui « passe des heures et des heures à accoucher de quelques lignes » , bientôt « consommées par le lecteur en moins de deux ». N’est-ce pas le lot de l’écrivain « cette disproportion flagrante entre lecture et écriture, désir volatil et dur labeur »? Quelle fut la durée de la gestation de ce onzième roman?
SJ: L’image qui me vient souvent à propos de cette disproportion là, c’est un peu comme les bâtisseurs de route ou de voie ferrée… Des années à l’édifier, et on roule à 300 km/h ! Mais il y a un grand plaisir à tracer cette route, à tracer ce chemin où passera le regard et l’esprit du lecteur. Deux années pour celui là.
ND: Inversement, quand vous êtes lecteur, pensez-vous au travail de l’auteur?
Portez-vous une attention particulière à l’écriture ou laissez-vous emporter par le récit? Votre héroïne, Dora, affirme que « pour savoir qui sont vraiment les gens, il suffit de jeter un oeil aux dernières pages ». Pour un auteur, rien de plus sacrilège que de lire la fin. Qu’en pensez-vous?
SJ: Je suis très attentif à l’écriture, toujours, lire un livre c’est d’abord trouver un ton, une voix, qui vous parle plus ou moins. Puis il y a la sinuosité plus ou moins vaillante de l’histoire, de l’intrigue, mais parfois la voix à elle suffit, à convaincre de continuer la lecture… Un livre, c’est très ouvert, et chaque fois différent, chaque livre a son propre dosage, entre fiction et réaliste, entre intrigue et style, les combinaisons sont infinies et c’est bien pourquoi le roman est inépuisable, quelle que soit sa forme.
ND: Votre roman est une vaste réflexion sur la création. Le fait divers qui alimente le suspense de votre roman vient-il d’un article lu dans la presse? Ou est-il déformé? Votre héros se dit réfractaire à piller la vie des autres, soulignant le danger de « se couper d’eux ». Que pensez-vous de vos confrères qui s’emparent de ces sujets?
SJ: Le fait divers est un véritable combustible de la littérature, et de la fiction au sens large.
Ce livre est la combinaison de plein de faits réels, d’anecdotes personnelles, de souvenirs, de rencontres, de personnages réels, de sites réinventés ou géographiquement déplacés, un mélange aussi de souvenirs, de lectures aussi, il faut des matériaux de toute sorte pour bâtir ce roman…
Le fait divers, j’aime le retrouver sous la plume des autres, avec tout de même cette réserve, de ne pas aborder le fait divers à chaud, les vérités sont toujours longues à décanter.
ND: Au coeur de votre roman, on sent, tapie, une certaine violence, qui contraste avec la douceur, la tendresse qui dominaient dans L’ Amour sans le faire.
Il y a L’écrivain national, exaspéré d’être espionné ou soumis aux interrogatoires.
Les circonstances du meurtre et de l’achèvement de la victime.
Et cette machine broyeuse affolante, cette rage à noyer les jerrycans..
Sans oublier certaines scènes d’amour avec Dora, torrides, voire sauvages.
ND: Nos vies sont faites de ça, de périodes plus paisibles et bienfaisantes, et d’épisodes où l’on est beaucoup plus « secoué ».
Là j’avais envie de secouer mon personnage, le décor, la forêt. La forêt aux abords de l’hiver, appelle cela en quelque sorte. Je ne voulais pas une forêt idéale au calme profond. Il y a toute une vie dans une forêt, autonome, comme dans un monde à part.
Pareil pour la campagne, je voulais ce contraste entre ce que l’on peut projeter d’une campagne paisible et rassérénante, et ce que mon personnage va en fin de compte y trouver: des hommes, des femmes, des conflits d’intérêt et des enjeux de territoire… ça existe ça, dans la vie. Souvent on se bat pour de simples questions de territoire.
Et le bois, le travail du bois, c’est quelque chose de féroce, abattre un arbre c’est lutter contre les éléments, ça met en oeuvre des machines, des forces, des usines, qui dépassent l’homme….
d’où cette référence amusée à Milon de Crotone à la fin…. !
ND: Ce qui n’est pas sans bousculer le lecteur qui reçoit de plein fouet cette charge. Doit-on y voir la rumeur d’une société plus violente, de tout ce que les médias nous assènent?
SJ: Disons que le monde de la nature, de la campagne traditionnelle, n’est pas moins violent ou ombrageux que l’autre. Le citadin.
ND: Martin Melkonian déclare dans son recueil d’aphorismes , Traces de secours: « L’écriture- pour l’offrande. La lecture-pour la trace. La parole-pour le relais ».
Avez-vous l’impression d’ offrir un cadeau à votre lectorat à chaque nouveau livre?
Quelle trace souhaitez-vous que l’on garde de L’écrivain national?
SJ: Je veux que les lecteurs, si possible nombreux, s’y lancent, s’y baladent, puis s’y fassent peur, et que finalement ils soient rassurés par la présence des autres… tant ils seront nombreux ! Enfin, je rêve là. Mais toujours est-il que c’est un livre que j’ai écrit en pensant au lecteur, le fait de le sentir là, derrière mon épaule, faisait que je pouvais davantage l’emmener là ou là, sur de fausses pistes, élaborer l’intrigue.
ND: Pour vous, les années précédentes, cela semblait irréalisable de commettre un roman de format plus conséquent.
Vous êtes-vous lancé un défi avec L’écrivain national, qui compte 400 pages?
Avez-vous eu besoin d’écouter de la musique pendant la rédaction de votre roman?
SJ: J’écoute de la musique, si je n’arrive pas à susciter assez fortement une émotion, ou une image. La musique comme une béquille. Mais bon, c’est un peu comme l’alcool, ça peut brouiller les choses, ça peut exalter la réalité du texte, lui donner plus de vie qu’il n’en a vraiment. J’écoute par phases, assez peu. Pour celui là en tous cas.
400 Pages, il fallait de la place, du souffle, pour parler à la fois d’un auteur, d’un fait divers, d’une communauté entière aux prises avec ses enjeux et ses rivalités, parler aussi des décors, et de cette vie sociale de l’auteur, de l’écrivain, telle que je la vois aujourd’hui, retranscrire toutes ces rencontres en librairie, en collège, en bibliothèque, ces ateliers d’écriture…
Un écrivain ce n’est pas seulement un être qui écrit, c’est aussi, quelqu’un qui va vers les autres pour parler soit de ses livres, soit pour les faire parler d’eux; les autres… !
ND: Vous situez votre écrivain national en résidence. En ce qui vous concerne, avez -vous rédigé une partie de ce roman en résidence d’auteurs ou non?
Où était-ce? Comptez-vous en faire d’autres?
Parmi les missions que vous avez effectuées, lesquelles sont les plus gratifiantes?
SJ: Oui, j’en ai fait, des résidences plus ou moins longues, et des dizaines de rencontres en librairie, et beaucoup d’ateliers d’écriture aussi, un peu partout. Quelques rares fois à l’étranger.
ND: La nationalité hongroise de Dora vous a certainement été inspirée par vos séjours en Hongrie, je suppose. Parlez-vous quelques rudiments de cette « langue totalement incompréhensible, pas devinable »?
SJ: La nationalité de Dora est essentielle. Elle est un mélange de réelles personnes, rencontrées en Hongrie, et cet exotisme total de la langue, et d’une certaine façon, de leur regard sur le monde. C’est un pays fascinant, ou le passé insiste un peu, ou des peurs et des rêves cohabitent parfois douloureusement, toujours au bord d’un désenchantement.
ND: Votre « écrivain national » confie ne « jamais écrire dans les cafés ». Pouvez-vous écrire n’importe où?
SJ: Non !
ND: William Burroughs disait d’un écrivain, « c’est quelqu’un qui y est allé, sur le terrain ».
Avez-vous parcouru cette forêt de Marzy pour camper le décor de façon si réaliste?
Vous brossez la nature comme un peintre. Quel est votre rapport à l’art?
SJ: Oui, j’aime me balader en forêt. Mes grands parents en vivaient. La forêt dont je parle est en gros, celle du Morvan, avec une scierie que je connais, mais dans le sud-ouest, j’ai déplacé quelques maisons aussi pour les intégrer à mon décor.
C’est un travail de composition aussi, comme un peintre assemblerait plusieurs éléments de décor. J’avais aussi en tête des tableaux de Constable ou Rosa Bonheur. Je suis fasciné par les toiles de Rosa Bonheur, la vie qu’elle met dans les regards de ses boeufs !!! C’est un détail.
Et pourtant, ça vaut le coup d’aller à Orsay, y jeter un oeil…
ND: Vous évoquez la correspondance avec les lecteurs de votre protagoniste, dont certaines qu’il a dû couper. Quant à vous, les échanges avec vos lecteurs tiennent-ils, comme pour Amélie Nothomb, « une place énorme dans votre existence »?
Dans votre roman, L’écrivain national a tissé des relations privilégiées avec quelques lecteurs. On constate qu’elles peuvent être toxiques. Vous êtes-vous parfois retrouvé dépositaire de secrets, de confidences? Ou de devoir couper court à des échanges,comme Amélie Nothomb qui déclare avoir parmi ses admirateurs « des dingues, des furieux »?
SJ: Je ne gère rien, j’en ai bien peur. Pour le reste, bien venus sont ceux qui m’écrivent. C’est au moins le signe que le livre est en vie, quelque part, sous d’autres regards. Un livre c’est étrange. On l’écrit, puis il s’évapore sous forme d’exemplaires; devenu anonyme, mon propre livre devenu anonyme, échappé, parti… Alors qu’un musicien, un cinéaste, un peintre lors du vernissage, eux ils voient le regard que portent les autres, directement, sur leur travail. L’auteur lui ne voit rien. Il est bien rare de tomber sur quelqu’un dans la rue ou un train qui est en train de lire votre livre justement… Alors, le courrier, ça permet de juger de l’effet, c’est un signe de vie que vous envoie ce livre envolé !
ND: Philip Roth constatait en 2013 que « Le nombre des gens qui prennent la lecture au sérieux est en baisse », constatez-vous ce déclin lors de vos rencontres?
SJ: Non.
ND: Vous définissez « vos auditeurs providentiels », lors de vos rencontres, comme « un doux tribunal ». Votre héros sort déstabilisé de certaines rencontres, ce que l’on peut comprendre, vu le procès de ces « quatre zoïles vipérines ». Redoutez-vous les interviews ou les rencontres?
Comment réagissez-vous face à des lecteurs censeurs?
SJ: Non, je ne crains pas ça, au contraire, je le recherche. En général ça se passe bien, mais l’imprévu est toujours possible.
ND: Votre protagoniste multiplie des retards, pouvez-vous vous targuer d’être ponctuel? ( hors des problèmes de transport)
SJ: Je suis ponctuel.
ND: Vous arrive-t-il souvent, comme votre double, de trouver que vous n’êtes pas à votre place?
SJ: Souvent. Mais j’aime bien cette sensation.
ND: « Écrire, c’est se dénoncer », affirme votre héros. Pensez-vous que vos lecteurs seront capables de vous deviner, vous cerner, à la lecture de L’écrivain national?
SJ: C’est évident. Ce personnage m’a emprunté beaucoup, jusqu’à mes vêtements….
ND: Les auteurs ont souvent des objets fétiches. Philippe Jaenada ne voyage pas sans son sac matelot, Katherine Pancol dort avec un calepin et un crayon.
En avez-vous?
SJ: J’en ai tellement que je pars toujours avec une grosse valise. Et bien souvent, j’en trouve de nouveaux sur place…
ND: Vous êtes toujours en mouvement comme votre double qui déclare: « Bouger ouvre l’esprit », n’aspirez-vous pas à une pause? Comment s’annonce votre agenda 2014/2015?
SJ: Des rencontres j’espère, en librairie, et en salon du livre.
ND: A choisir, préféreriez-vous partager le thé avec Agatha Christie ou un whisky avec Alfred Hitchcock?
SJ: Je n’aime pas l’odeur du cigare…. !
Un incommensurable MERCI pour avoir accepté que je vous « grignote » de ce flot de questions, pour reprendre une de vos formules ( page110)?
Et souhaitons à votre roman la consécration qu’il mérite.
Ne manquez pas ce roman prometteur, et une fois découvert , savourez la remarque de Serge Joncour : « J’étais le vibrion septique sous le regard de Pasteur, L’ Amérique dans l’azimut de Colomb », « c’est dire que j’étais entré dans l’intimité studieuse de quelques-uns, que mes livres étaient passés de mon ombre à leur petite lampe, c’est vertigineux quand on y pense ».( page 47)
Pour conclure, Charles Dantzig voit la lecture comme un tatouage, et considère qu’un auteur est sauvé « si le lecteur en retient une, une seule ». Dans ce roman, c’est une pléthore de passages que l’on se surprend à surligner ou à recopier afin de les partager ( « Lire, c’est voir le monde par mille regards… ».
A votre tour de vous laisser hypnotiser par « L’ écrivain national », sauvé des eaux, de ce décor sous-marin, même si son Kangoo n’était pas amphibie.
(1): Lire aussi la chronique de Nadine Doyen sur :
L’écrivain national, Serge Joncour , Flammarion (400 pages – 21€)