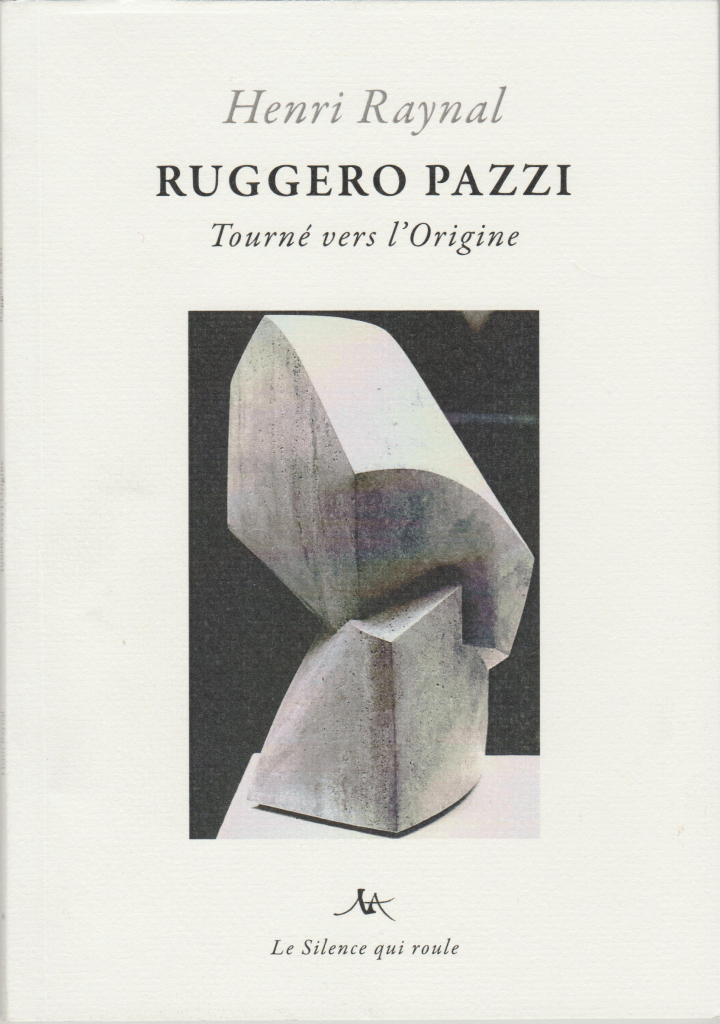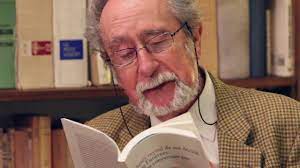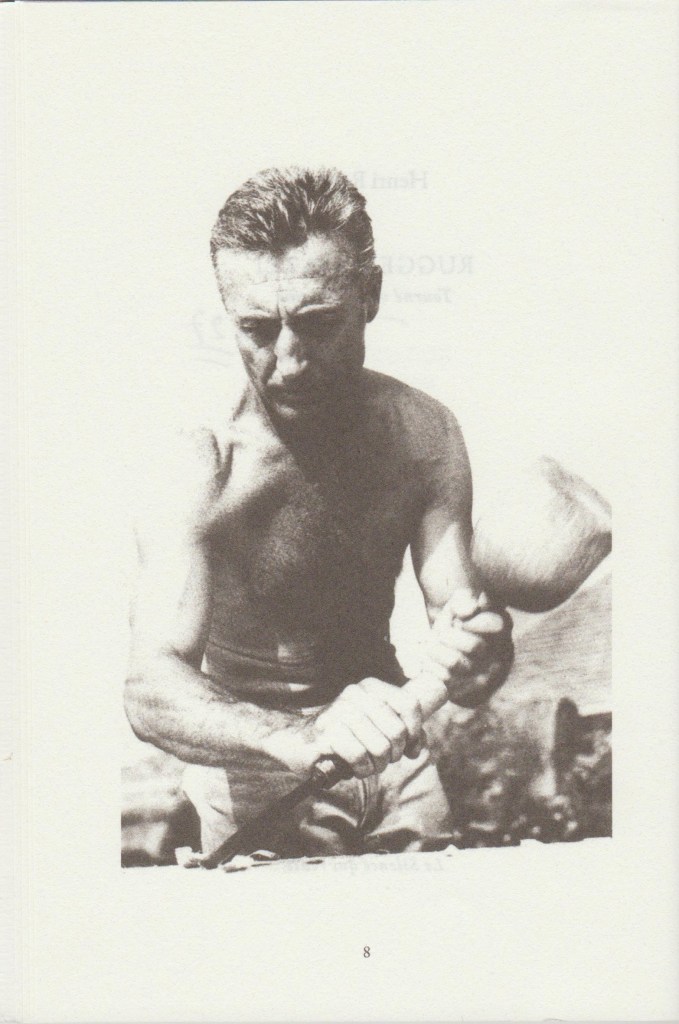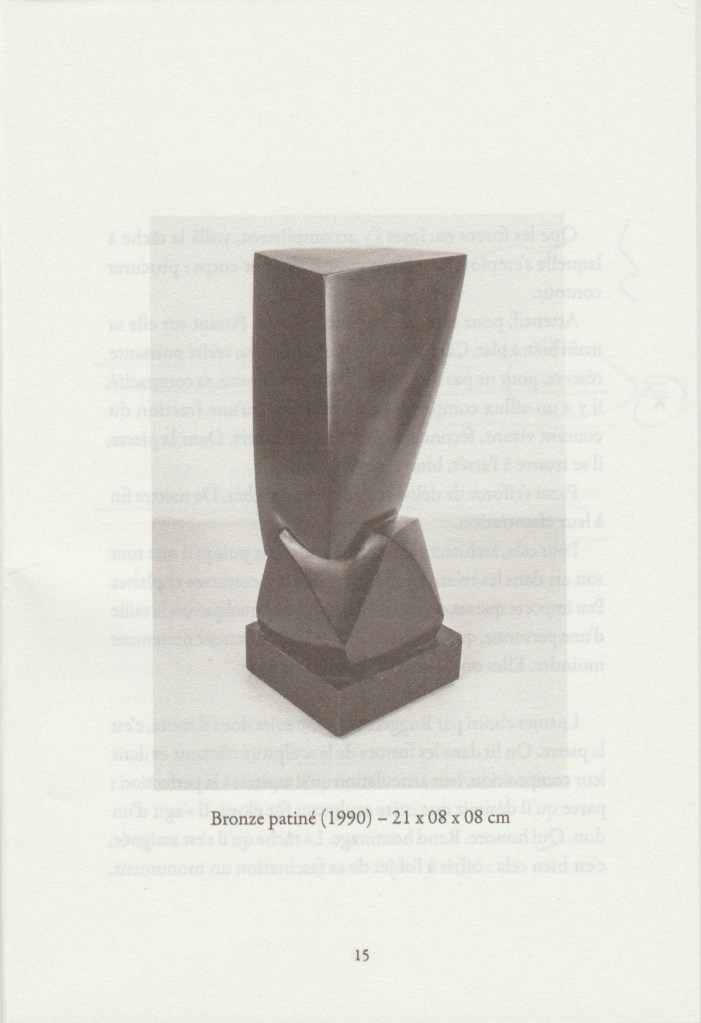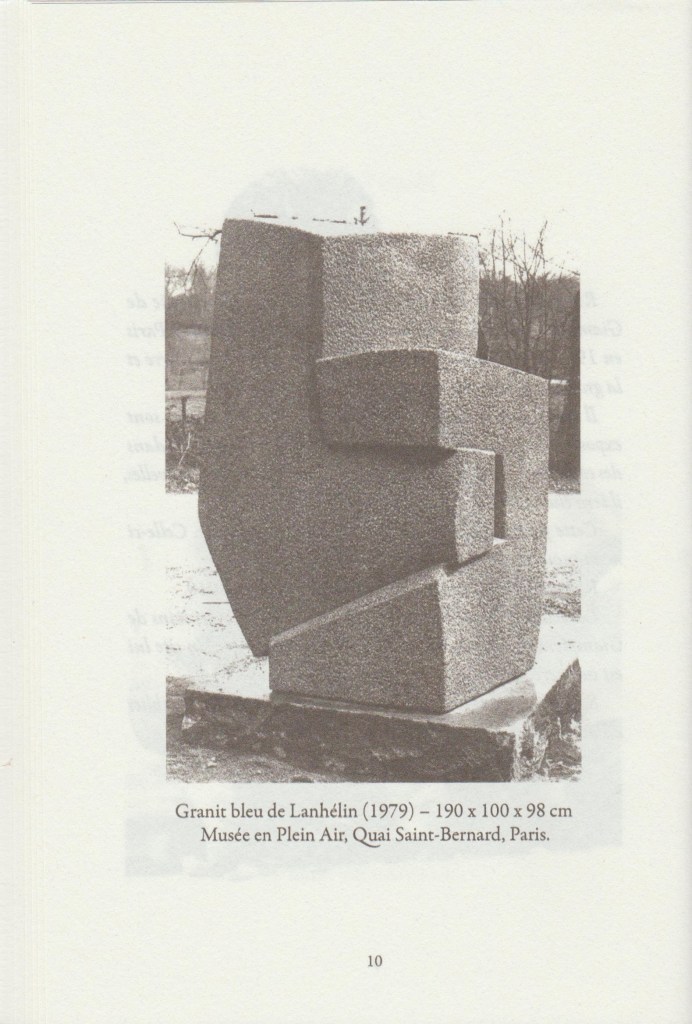Une chronique de Nadine Doyen
Juliette Nothomb, Éloge du cheval, Albin Michel, ( 14€- 199 pages), Septembre 2022
Juliette Nothomb revisite son enfance et son rapport aux animaux en particulier.
Même si toute jeune enfant, elle a connu les genoux des adultes chantant « à dada… », le coup de foudre de l’auteure avec les chevaux a lieu au Japon, à l’âge de huit ans. L’écrivaine en a certes croisé auparavant, lors des voyages avec sa famille au Canada, mais de loin. Précisons que son père, diplomate, a occupé plusieurs postes à l’étranger et que la famille a vécu aux quatre coins du monde et engrangé des valises de souvenirs.
Le cheval, quand on est enfant, on commence par le contempler en photos ou en vrai. D’où cette réflexion : « Dans la mémoire et le vécu de chacun d’entre nous, il y a au moins un événement, une histoire qui nous relient à cet animal exceptionnel ».
Les canassons qui ont d’abord fasciné l’enfançonne, sont ceux observés dans un manège. L’envie d’en monter ne tarde pas à se manifester. Un gène familial ?
Sa grand-mère maternelle, admiratrice des chevaux, l’encourage instantanément et voilà Juliette, gamine, le pied à l’étrier. C’est alors qu’elle ressent pour la première fois « une onde électrique » traversant son corps, « à l’unisson avec le frémissement et la chaleur de l’échine » et découvre le parfum équin. La fillette égocentrique devient emphatique et audacieuse au contact de son animal préféré.
Elle confie qu’enfant, il lui a fallu un doudou en peluche, un poney nommé Poly, également vénéré par sa sœur Amélie.
Mais durant son séjour en Chine, Juliette, petite fille, a connu la frustration. Plus de chevauchées fantastiques. En Chine, l’équitation est bannie, « jugée contre-révolutionnaire », « sport d’aristocrates ». Les seuls cavaliers croisés étaient des vieillards ou des enfants. Tentée d’explorer la campagne à vélo avec sa famille, elle souligne avec une pointe d’humour, que cette activité pratiquée uniquement par les ressortissants des pays capitalistes paraissait louche ! D’où la présence d’un pseudo-berger en faction.
Comme ersatz, les parents Nothomb offrent des livres équestres. Quant aux deux sœurs, Amélie et Juliette, elles ne manquent pas d’imagination pour s’inventer des destriers, à partir d’échasses. La connivence entre elles est déjà exceptionnelle dans leurs jeunes années. Est-ce pour cela qu’Augustin Trapenard ose parler de « livre- soeur » ? Les aficionados de la baronne belge vont d’ailleurs la retrouver ici en « chroniqueuse, journaliste sportive » !
La journaliste rappelle que l’agriculture chinoise était encore rudimentaire dans les années 1970. Le cheval ou autre bête de somme devaient aider le paysan au transport de marchandises au moyen de charrettes. Situation qui n’est pas sans rappeler les images du film « Le retour des hirondelles » de Li Ruijun montrant une Chine rurale.
Le départ ( en 1975) de la fratrie Nothomb pour les États-Unis s’avère donc un grand choc : passer de la dictature au monde ultralibéral! Juliette entre en sixième au lycée sélect de New-York et rêve d’endosser la tenue traditionnelle de cavalière : « jodhpurs, bottes et bombe à mentonnière en velours noir » !
Elle a connu le graal dans Central Park , grâce à l’invitation d’une amie.
Elle découvre l’engouement des Américains pour les parades.
Bonheur d’être au pays des cow-boys, des Indiens, de Lucky Luke et son cheval Jolly Jumper, prête pour la conquête de l’Ouest américain !
L’écrivaine n’élude pas le fait que le cheval est source de clivages sociaux, « symbole de richesse et de pouvoir ». Elle se souvient avoir été méprisée, tout comme sa sœur, deux « jeunes plouquettes belges » réduites à monter des chevaux de manège !
Dans ce livre, la philologue s’intéresse à l’étymologie du mot « cheval » : «equus », « caballus, « kaballes »… et décline maintes métaphores et expressions courantes : « faire cavalier seul », « œuf à cheval, « avoir une fièvre de cheval » …
L’art du dressage n’a plus de secret pour elle (dompter un cheval est une gageure). Elle passe en revue tout le vocable équin ( on apprend un autre sens du mot « pouliche »), elle détaille les façons de monter l’animal « à l’anglaise ou western, à cru », en amazone (comme sa grand-mère paternelle), les tenues vestimentaires.
Au Wyoming, on enfile les « chaps », culottes de cuir à franges.
La journaliste souligne le caractère ombrageux du cheval. Au contact de cet animal, elle éprouve « un sentiment débordant et paradoxal de soumission et de puissance », d’ivresse, de griserie et de liberté. Elle se remémore son histoire d’amour à 13 ans pour Charlie, « merveilleuse monture », avec qui elle a participé au Horse Show annuel du club. Avec humour, elle prévient que « faire du cheval » ne dote pas d’une silhouette de sylphide !
Elle émaille son récit d’anecdotes dont l’incroyable baignade avec Charlie dans un lac. Moment surprenant et déconcertant, avec cet « état proche de l’apesanteur », batifolages, jeux, « tous deux aussi légers que deux truites ». Après cette acmé, on comprend d’autant mieux son chagrin incommensurable quand il lui faut quitter le pays de son champion, Charlie, pour le Bangladesh, en 1970.
Dans cet essai, la cavalière aguerrie remonte très loin dans le temps, le cheval étant un être culturel. Elle énumère toutes les utilisations du quadrupède au cours des époques, son rôle dans les guerres. ( ce qui convoque le roman Chien-Loup de Serge Joncour). Et déplore le lourd « tribut de morts au combat au cours de l’Histoire », le cheval étant « sacrifié sur l’autel des conflits ». L’écrivaine n’élude pas la maltraitance et misères chevalines, consciente des travaux forcés auxquels sont condamnés les équins, esclaves malmenés pour les labeurs agricoles et industriels. Ainsi que du sort des chevaux de courses vieillissants.
Elle aborde maints sujets dont l’alimentation des chevaux , la façon de les monter, et la baisse de l’hippophagie (fermeture de la dernière boucherie à Bruxelles en 1980).
L’écuyère émérite évoque les grandes stars ( Ourasi, Jappeloup) qui se sont fait un nom dans le domaine de l’équitation et témoigne de sa reconnaissance envers les chevaux qui ont compté pour elle. Elle se souvient de randonnées au coeur de la forêt de Soignes ainsi que dans l’Ardenne belge. L’intrépide Juliette nous fait revivre une expérience périlleuse mais grisante, en mer, sur la croupe d’un cheval de race ibérique au Portugal ! Sa devise : « Cavalière un jour, cavalière toujours » !
La littérature, la peinture ( Georges Stubbs, Delvaux, Magritte) et le cinéma ( Hair, Ben-Hur., Crin-Blanc…) s’invitent copieusement dans ce livre. Passionnantes les pages consacrées à la peinture chevaline, à laquelle elle fut initiée par son grand-père maternel. Sont cités Marguerite Yourcenar, Dumas et « Les trois mousquetaires » ainsi qu’un des romans d’Amélie Nothomb : « Le sabotage amoureux » où « elle fantasme un vélo en cheval ». Parmi la pléthore de livres qui ont marqué et nourri la lectrice Juliette Nothomb, celui de George Orwell qui met en scène « Boxer, un solide cheval de labour », Don Quichotte de Cervantès, Homère et le cheval de Troie.
La musique, apprend-on, est venue combler ( au Japon) « le désert culturel ». Certains airs célèbres pouvant être associés aux pas du cheval ! Musique et équitation renvoient aux spectacles de Zingaro, aux ballets de l’École espagnole de Vienne, aux performances des écuyères dans les cirques. Ou au Cadre Noir de Saumur.
A New York, la télévision était remplacée par la danse, les chorégraphies modernes et les comédies musicales de Broadway ( West Side Story).
Dans le dernier chapitre, la journaliste culinaire prodigue divers conseils pour gratifier « son équin au bec sucré » : éviter le sucre, préférer une pomme, une carotte et livre une réflexion sur l’évolution de l’alimentation dans les centres équestres.
C’est avec émotion que l’on referme cet ouvrage (illustré par une photo touchante) dans lequel en filigrane apparaissent les parents bienveillants Nothomb ainsi que sa sœur cadette qui a aimé remplir l’album familial des rubans gagnés par son aînée.
Dans cet opus érudit, dense, l’écrivaine décline l’historique du cheval de façon très documentée, fouille son passé, ce qui apporte beaucoup d’intérêt au lecteur.
Juliette Nothomb y adjoint un côté plus intime où elle livre ses souvenirs de cavalière, perchée sur « la plus noble conquête de l’homme » , selon Buffon, et ceux de ses voyages en famille. Pèlerinage en Irlande, lié au prénom de son père, Patrick ! Randonnées en Inde, Birmanie, Népal, Jordanie, où « seul le cheval pouvait offrir l’extase ». Tout se déroule comme si le lecteur, de simple spectateur, devient partie prenante du récit, grâce à une écriture captivante, pétrie d’humour, enrichie de comparaisons inattendues et suggestives. Elle confie que le séjour pékinois l’a « fait grandir et lui a ouvert les yeux sur l’étrangeté et la diversité du monde ».
Avec générosité, elle partage son amour inconditionnel pour « cet animal singulier, multiple et si extraordinaire », qui impose le respect. La cavalière ne tarit pas d’éloge sur le cheval « doté d’une sensibilité et d’une intelligence hors du commun », « cet animal singulier multiple et si extraordinaire », « indispensable à l’humanité ». Un essai enrichissant, à la fois documentaire et autobiographique.
Alors , en selle pour une chevauchée inédite et instructive, sans danger !
Et décernons une « rosette » à celle qui nous a fait voyager autrement.
© Nadine Doyen