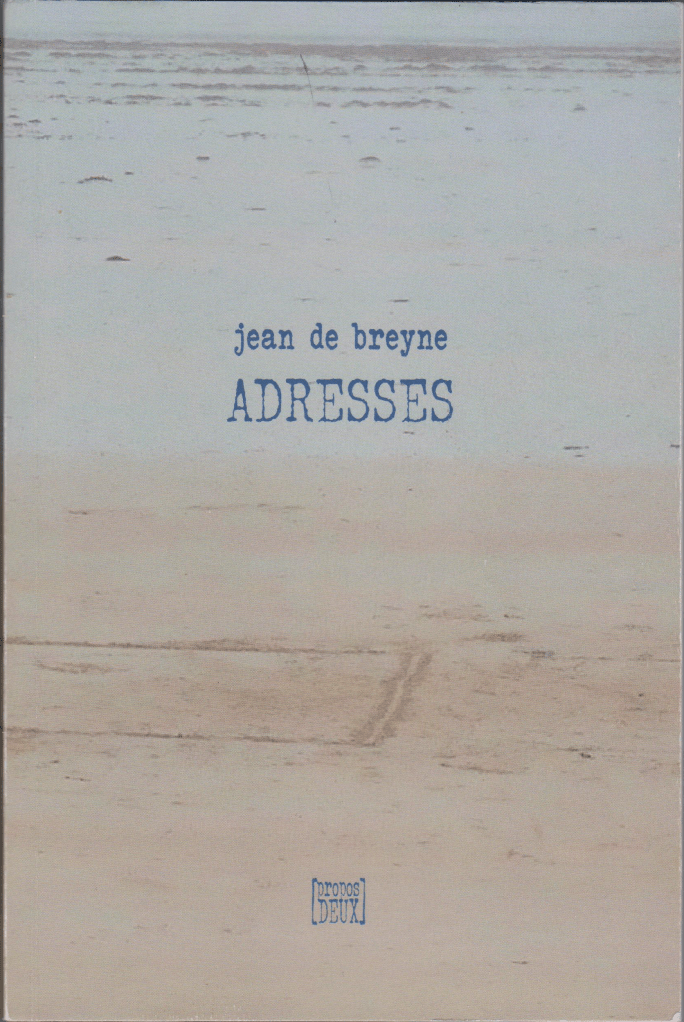Une chronique de Marc Wetzel

Joël-Claude MEFFRE – Ma vie animalière suivi de Homme-père/Homme de pluie et de Souvenir du feu – Propos Deux – mai 2023 – 90 pages, 14€
« Ma vie animalière », ce titre étrange veut dire, peut être : ma vie au double contact de l’animal hors de moi et de l’animal en moi. De « l’animal hors de moi » – oui, surtout dans la vie d’enfance de l’auteur, né à Séguret en 1951, entre les Dentelles de Montmirail et le Ventoux, dans le triangle Orange/Vaison-la-Romaine/Carpentras qui résumait à peu près l’histoire et la géographie françaises dans les années cinquante et soixante pour ses natifs; et de « l’animal en moi » – l’être en lui qui perçoit, se meut et désire – et se sent un peu engoncé ou à l’étroit dans l’humain plus large qu’il est, celui qui calcule, explique, choisit et juge. L’auteur a littéralement partagé là son enfance (son apprentissage du monde) avec alouettes, salamandres, hérons, couleuvres, loriots, et peut-être déjà loup; mais aussi avec un frère oiseleur (qui piégeait les grives, comme une sorte de circacien naturel, attirant, à la glu et au leurre, les unes par les autres, à mesure des prises, les « mauvis » dans leur final petit chapiteau de bois « aux barreaux de jonc ») – frère à la fois animal et humain (aux « lèvres gercées et doigts gourds » p.49) qui se lasse un jour (ou prend pitié ?) de son « petit orchestre de captives », et, les relâchant pour toujours, meurt à lui-même en enterrant sa propre « vie animalière ».
Ces divers récits (presque sûrement authentiques, même quand ils sont rêvés) ont la densité et la justesse des fables, comme celui-ci – où le petit Joël-Claude apprend la vie des réactions mêmes de son père à la bestiole (une salamandre) que son fils vient de lui apporter :
« Je me penche, je la distingue dans la sombreur, somnolente, au bord d’une flaque. Elle dort ? Probable.
Je l’ai saisie, l’ai mise au creux de ma main, doucement, et l’ai montrée à mon père, un matin.
Mais il craignait la force et le pouvoir de cette bête. Je ne savais pas. Il s’en est saisi et l’a jetée au loin en disant : « si elle y voyait autant qu’elle est aveugle, elle désarçonnerait un cavalier de son cheval ».
Fâcheux proverbe.
Ces choses de maléfices traînaient encore dans la tête de mon père, sournoisement. J’en ai tellement été surpris !
Il n’en reste pas moins que j’ai ramassé la salamandre et je l’ai ramenée dans son trou, bien à l’abri des regards, là où elle dormait si paisiblement » (p.23)
La salamandre n’a en effet besoin ni de bons yeux ni d’être en alerte pour vivre. Pourquoi ? Parce que sa livrée agressive (jaune ou rouge, et noire) qui prévient de son immangeabilité, éloigne assez ses prédateurs, et lui ôte tout souci de s’en défendre. Elle peut se permettre lenteur et insouciance, parce que sa coloration met assez les curieux en garde contre son goût nocif … sauf, justement, ceux qui (tel l’enfant J.-C. M.) sont curieux de son apparence, non du tout de sa chair, et de sa splendeur, non de ses protéines ! C’est ainsi que l’amphibienne aux éclats dissuasifs ne peut se protéger de la raison humaine (ludique, essentiellement intriguée). C’est là que le père de l’auteur proteste, rechigne : la salamandre, quasi-invulnérable dans la nature, doit être laissée (par l’ingéniosité humaine) au sombre et douloureux mystère qui lui assure sauvegarde. Il faut, semble réclamer le père, respecter cette peau tachée et nue qui, en quelque sorte voit pour la salamandre, et lui octroie saine et sauve visibilité. La raison ne doit ainsi pas faire effraction dans l’opacité salutaire de la vie : la légende est préférable. Quand elle raconte, par exemple, que la salamandre peut vivre dans le feu parce qu’elle tient la chaleur en respect, qu’elle peut éteindre un sachet de flammes à quelques millimètres de tout point de sa peau, il faut comprendre de quel « feu » elle se protège : celui de la théorie prométhéenne des hommes, de l’inquisition scientifique ou spéculative. La salamandre, qui sait survivre au feu de la vie, deviendrait aussitôt cendres dans celui de la Raison ! Rejetons-la donc , pour son bien, loin de notre savoir !
On se permettra trois courtes remarques sur cet étonnant et juste recueil (par ailleurs clairement, et utilement, préfacé par Marilyne Bertoncini). D’abord, souligner une évocation incisive, et énigmatique pourtant, de la figure paternelle. Dans « Homme-père/Homme de pluie », quelque chose des paysages mêmes paraît héréditaire, et plus précisément, quelque chose de la remontée vers les sources semble un élan issu de lignée paternelle : il y a quelque chose du mâle ombrageux et cinglé dans l’effort du père de l’auteur d’aller sans cesse s’enquérir de la source d’un cours d’eau. La femme (la mère) n’a pas, elle, à chercher une source qu’elle est; alors que l’homme ne peut habiter, au mieux, que les pluies qui la forment. Cette secrète source de l’Ouvèze – montagne de la Chamouse, dans les Baronnies – est l’horizon des « errances » d’un père qui « jamais ne se retourne sur lui-même » (p.70). Cette image du père en bredouille sourcier trempé est d’une rare justesse – avec son écrivain de fils lui donnant après-coup, prudemment, cette réflexivité que le premier se refusait.
Ensuite, cet auteur fin et pénétrant déploie une spiritualité forte, mais non-chrétienne : pas ici de bons sentiments, de sacrifice généreux, de partage gracieux. Mais un amour qui ne vient que par l’intelligence des situations, et l’intelligence semblant dépendre elle-même de la danse des êtres et des choses qu’elle saisit (et semble mimer, peut-être, par ses tournures et ses alinéas). Joël-Claude Meffre estime (mystiquement ?) que chacun dispose exactement de l’amont de lui-même que sa foi mérite. Et que cette foi d’amont, nous la devinons, au mieux, en autrui (p.72) sans l’entamer jamais.
Enfin, parmi tant de formules disant le tact (délicat, jamais infaillible pourtant) et le contact que les destins humains obtiennent les uns des autres (alors que l’animal n’a aucun accès à la manière dont un congénère se damne ou se sauve – on ne devinera rien de ce qui ne peut se dire à soi-même quoi que ce soit !), il y a, dans ce livre exigeant mais familier, une leçon de fraternité réelle. Dans le récit « La taupe et l’hirondelle » (p.19, à partir de Brodsky), une hirondelle, comme vaincue par la tempête et le gel, se résigne à faire misérablement halte dans un trou de taupe. La taupe, alors, se contente, pour l’accueillir, de s’enfoncer un peu plus bas. Cette solidarité sans contact, respectueuse comme par défaut, bienveillante seulement par entre-évitement, dit à la fois la communauté des sorts, et leur stricte incommensurabilité. De même, semble indiquer cet admirable auteur, les respectives « vies animalières » des humains à la fois se devinent infiniment les unes les autres, et chantent l’une pour l’autre, pourtant, leur parfaite incommunicabilité. « Et toi, quel animal auras-tu donc été pour toi-même ? », semble murmurer l’auteur à son lecteur, à son tour d’être un jour, sarment ambigu, jeté au feu :
« Le chariot de tôle avançait,
bringuebalant de par la plaine,
sur deux roues grinçantes.
Il allait droit devant dans les rangées de vigne,
emmenant avec lui un feu,
un feu de hautes flammes jaunes et rouges.
C’était dans le mois de janvier.
On jetait dans ce feu nos fourchées de sarments (…)
Le chariot chauffé à blanc,
était laissé au bord d’un champ.
Il refroidissait
sur ses roues disjointes
et puis, avec le temps, il était oublié
parmi les hautes herbes » (p.75-79)