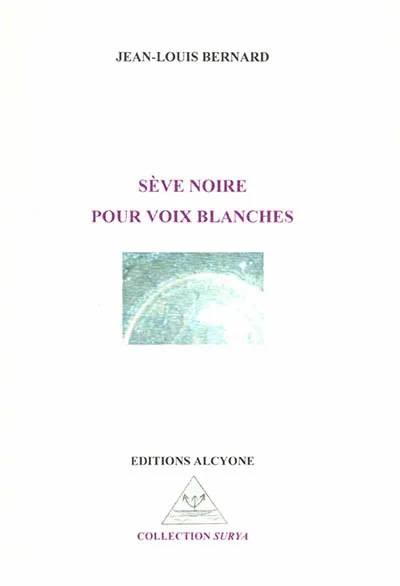Une note de lecture de Pierre Schroven
Jean-Louis Bernard, Sève noire pour voix blanches ; Editions Alcyone, 2021 ; Collection Surya
Dans ce livre, le poète érige l’errance en apprentissage de la vie et de la poésie ; mieux, dans ce livre, le poète explore les contraires, tente de rendre la sensation d’un monde qui se révèle toujours autre qu’on le croyait, s’emploie à capter les étincelles du vivant et à traduire toute la subtilité du présent. Soucieux d’échapper au vide existentiel qu’il appréhende quotidiennement et de redonner son rythme et ses pulsations à notre existence, Jean-Louis Bernard nous met ici en présence d’une poésie dans laquelle on perçoit un cri pour retrouver une innocence, un amour et un absolu venu d’un ailleurs inconnu. Ici, le poète ouvre un temps qui n’est pas encore, célèbre la terrestre sensualité, interroge, écoute et accueille la nature afin de se connaitre, se révéler à lui-même voire s’habiller du corps d’une liberté s’écoulant comme une rivière dans l’infini du monde ; ici, enfin, le poète en appelle à renouer des liens avec le réel fulgurant et à faire du silence un moyen de recueillir l’instant(le silence, c’est le vase à recueillir l’instant/Guillevic). En bref, à travers ce livre, Jean-Louis Bernard cherche à rendre la sensation du monde, à combattre la mort vivante qui se représente à nous quotidiennement, à faire un pas vers la lumière du mystère qui nous traverse et enfin, à dépasser le visible pour en donner lecture selon le mystère oublié de son surgissement continuel.
Recherche d’un souffle
qui ferait monde
sous sa dictée
un nom égaré
derrière la flamme obscure
des confins
et puis un autre
perdu dans les faubourgs
du songe
voici que se profile
le dit des lisières
et la liturgie revenante
de l’éclair
affiché
sur les ruines du silence
le dessin d’un souffle