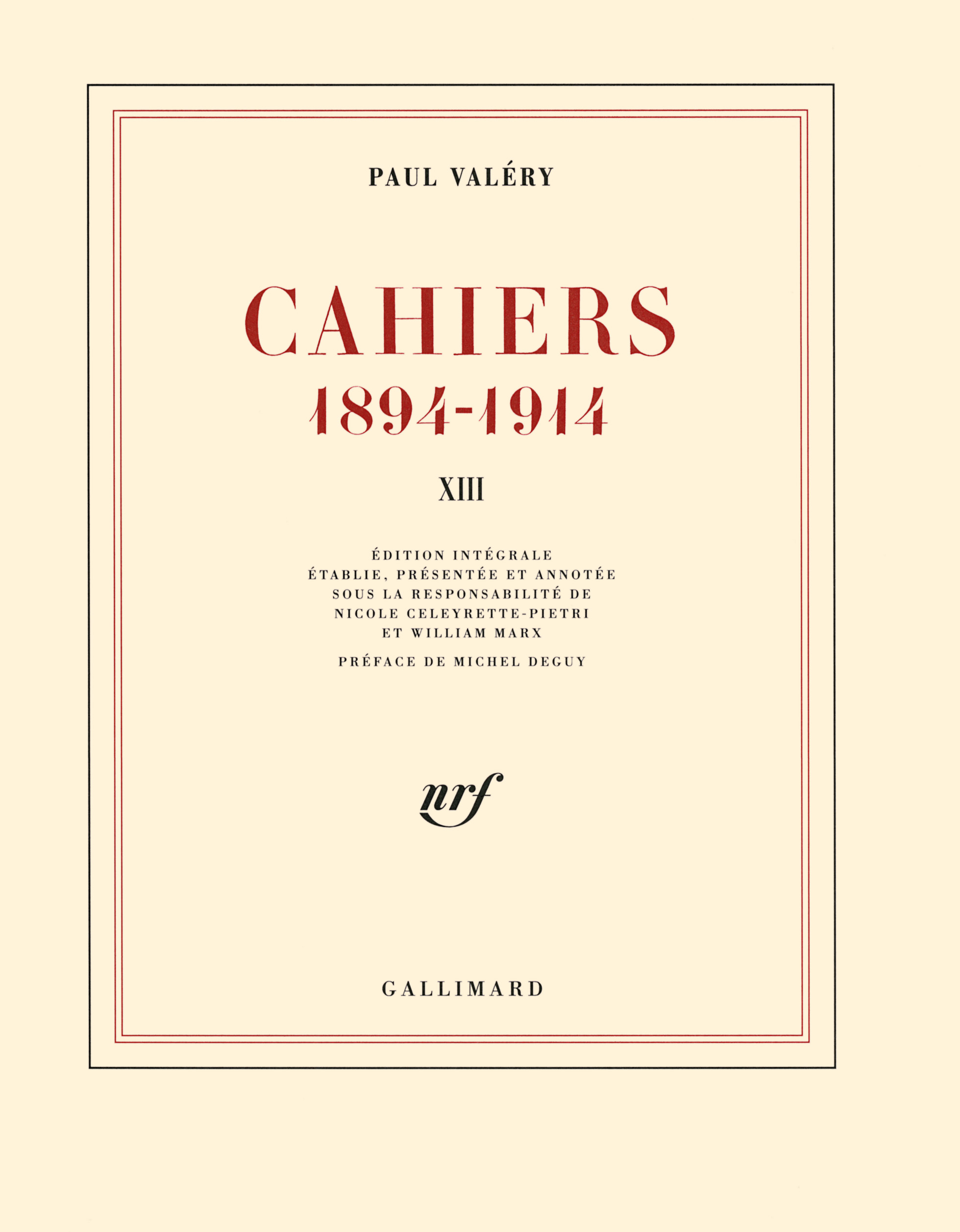Un diptyque
Par Daniel ILEA
Philippe SOLLERS, La Deuxième Vie, roman, avec une postface de Julia KRISTEVA, NRF Gallimard, mars 2024.
« Voici le dernier livre de Philippe Sollers, écrit jusqu’au bout d’une main claire », note Yannick Haenel sur la quatrième de couverture de La Deuxième Vie.
C’est exact, c’est fort, et c’est beau, même quand cette main claire tremble…
Mais on a comme une envie d’ajouter que, de la part de Sollers (Ulysse des lettres françaises), on peut s’attendre à tout… même à un livre post-mortem : écrit, ce coup-ci, par son (non-)être, en ses mutations infinies, sorte d’Yi king, hélas, pour nous, intraduisible, donc impubliable en français – en cette langue qui l’a fait naître, et renaître, à chaque nouveau livre, c’est-à-dire pratiquement une centaine de fois !
On peut s’attendre à tout, j’insiste : car, chez lui, ce lien entre écriture et amour, ou amour et écriture, ce nœud gordien, fut si serré qu’au moment de son départ, d’instinct, « Philippe se tourne vers le cahier » (p.72)…
Je tenterai de concentrer ce livre-aphorisme, ou ce poème, en quelques lignes-citations :
« Malheur à celui ou à celle qui n’a pas célébré sa vie de son vivant », nous dit Sollers (p.16), et on comprend tout de suite que les susnommés n’auront pas, non plus, le droit de célébrer leur « Deuxième Vie », dans sa « vivacité », ce « caractère le plus inattendu de l’éternité », où « c’est d’un vif mouvement que la mer se mêle au soleil » (bien entendu, « les éléments négatifs [en] sont éliminés ») : c’est comme si « chaque moment est perçu instantanément pour la deuxième fois » (p. 19). On dirait une Reprise kierkegaardienne immédiate !
« Chez certains écrivains, la Deuxième Vie est toujours en vue dans la première, mais peu en ont conscience, à moins d’une initiation » (p. 21).
Et, si « la première vie est contradictoire » (p. 20), « la Deuxième Vie se tait, elle a appris que la pensée est un acte » (p. 21).
Or, découverte essentielle, la « Deuxième Vie » ne se conjugue pas au singulier : des atomes crochus (disons) permettent « des relations solides avec d’autres Deuxièmes Vies » ; par exemple, « l’entente avec Eva était immédiate, pas sexuelle, sauf une fois, pour vérifier que la question n’était pas là » (p. 21).
Dans sa postface (en fait, la continuation, le complément du livre, mais comme simultané, car, rappelons-le, ici aussi, « chaque moment est perçu instantanément pour la deuxième fois » dans cette dialectique entre l’existence et l’écriture, la lettre et l’être), Julia Kristeva écrit : « Reste Eva, figure composite des femmes du Migrant, ‘de plain-pied avec la Deuxième Vie’, par ‘intensité de concentration’ » (p.71). Je vote pour cette Eva-là, que je ne vois pas, moi, juste comme une « figure composite des femmes du Migrant », mais, à la fois, comme une incarnation individuelle, unique – qui a été, qui est « de plain-pied » avec sa première et sa « Deuxième Vie », et qui ne peut être autre que (Krist)Eva, donc Julia !
En vérité, une part d’Eva/Julia est bien « partie », et désormais « se voyage » avec Philippe, comme en un « hymne à ‘l’Amour qui meut le soleil et les autres étoiles’ » (voir le chant XXXIII du Paradis de Dante ; ici, pp. 72-73).
Tout cela m’envoie à ce dialogue (in Julia Kristeva, Philippe Sollers, Du mariage considéré comme un des beaux-arts, Fayard, 2015) :
« Ph. S. – La rencontre d’amour entre deux personnes, c’est l’entente entre deux enfances. Sans quoi, ce n’est pas grand-chose (p. 41).
« J. K. – Tu as raison de commencer par l’enfance, car les nôtres sont si différentes, et pourtant nous les avons accordées (p. 41). […] Bien sûr, je resterai toujours une étrangère plus ou moins intégrée. Cependant, dans l’amour qui ravive nos enfances échangées, et seulement là, je cesse d’être étrangère (p. 44). »
Ce qui me rappelle Nietzsche : « Dans l’homme véritable est caché un enfant qui veut jouer. Allons, les femmes, découvrez-le cet enfant dans l’homme ! » (Ainsi parlait Zarathoustra, Première partie, « Des petites vieilles et des petites jeunes », trad. de G.A. Goldschmidt, Le Livre de Poche, 1995, p. 85).
Mais, certes – nous dira Sollers –, la réciproque aussi s’impose de soi : « Une des plus belles photos que j’ai vues de Julia, c’est elle en bébé (rires). Il faut aller trouver parfois la petite fille chez une femme. C’est beaucoup plus compliqué qu’on ne croit, puisqu’il s’agit en réalité de la voler à sa mère. Le Cantique des cantiques dit que l’amour est fort comme la mort. Ça m’impressionne beaucoup : si j’aime, je vais peut-être être aussi fort que la mort, ou vaincre la mort ? Stendhal écrit une phrase absolument étonnante, comme ça, très vite : ‘L’amour a toujours été pour moi la plus grande des affaires de ma vie, ou plutôt la seule.’ Vous connaissez son épitaphe rédigée par lui en italien : ‘Il vécut, écrivit, aima’ » (in Du mariage…, p. 145).
Pour moi, c’est prouvé : La Deuxième Vie ne peut que faire suite à Du mariage considéré comme un des beaux-arts !

(Ce titre même nous rappelle la kierkegaardienne « Légitimité esthétique du mariage » d’Ou bien… Ou bien2… : « Lorsque l’être, avec lequel je vis dans l’union la plus tendre de la vie terrestre, m’est aussi proche au point de vue spirituel, c’est alors seulement que mon mariage est éthique et, par conséquent, esthétiquement beau » ; et : « L’amour romantique se laisse excellemment bien représenter dans l’instant, mais non pas l’amour conjugal ; car un époux idéalisé n’est pas quelqu’un qui l’est une fois dans la vie, mais quelqu’un qui l’est tous les jours » ; c’est qu’il vainc « l’ennemi le plus dangereux : le temps » – puisqu’il « a eu l’éternité dans le temps et l’a conservé dans le temps ».)
Conclusion logique : il faudrait les republier en un diptyque.
©Daniel Ilea,
Avril 2024.
1. Cf. Philippe SOLLERS, La Deuxième Vie, roman, avec une postface de Julia KRISTEVA, NRF Gallimard, mars 2024.
2. Cf. Søren KIERKEGAARD, Ou bien… Ou bien…, trad. du danois par F. et O. PRIOR et M. H. GUIGNOT, Tel Gallimard, 1995, pp. 433, 447 et 449.