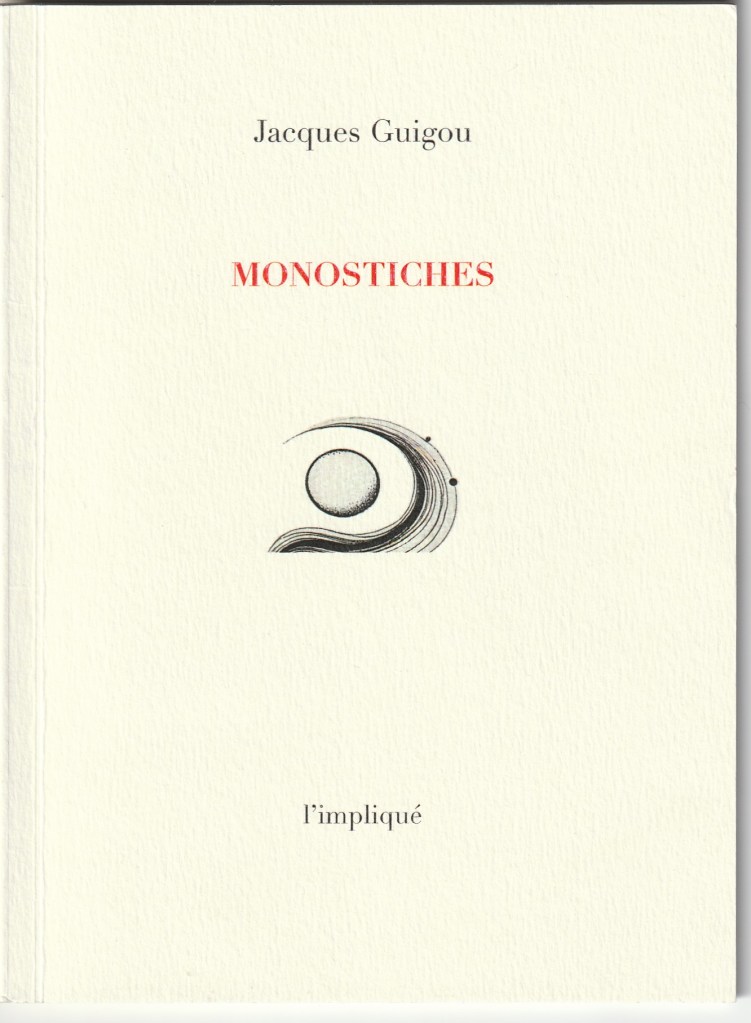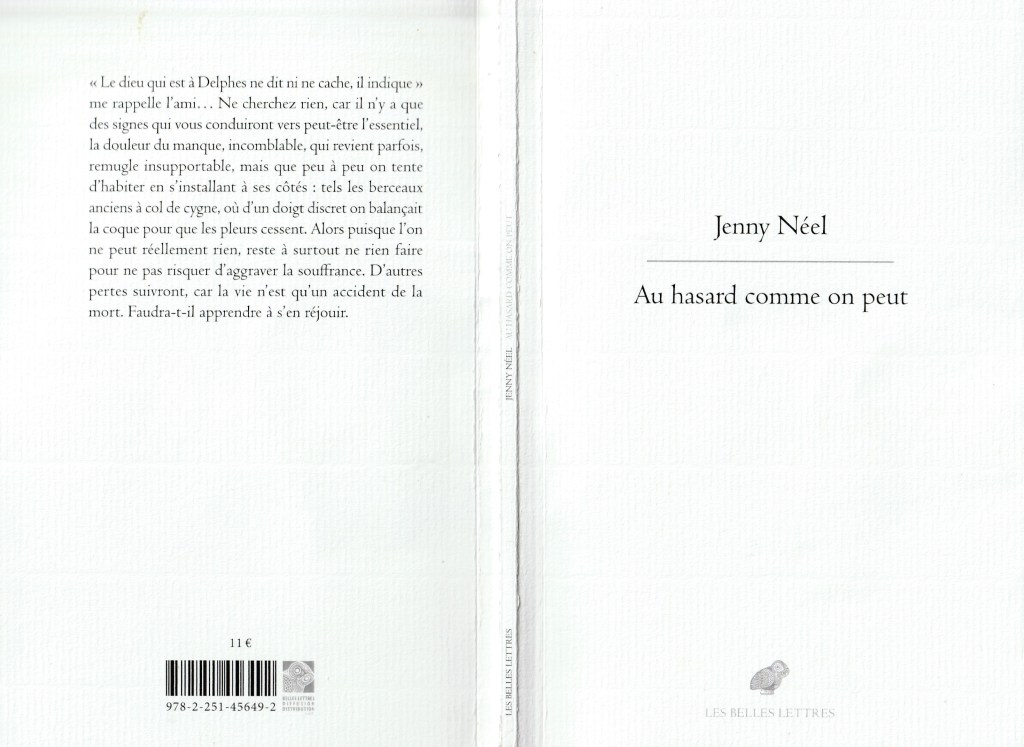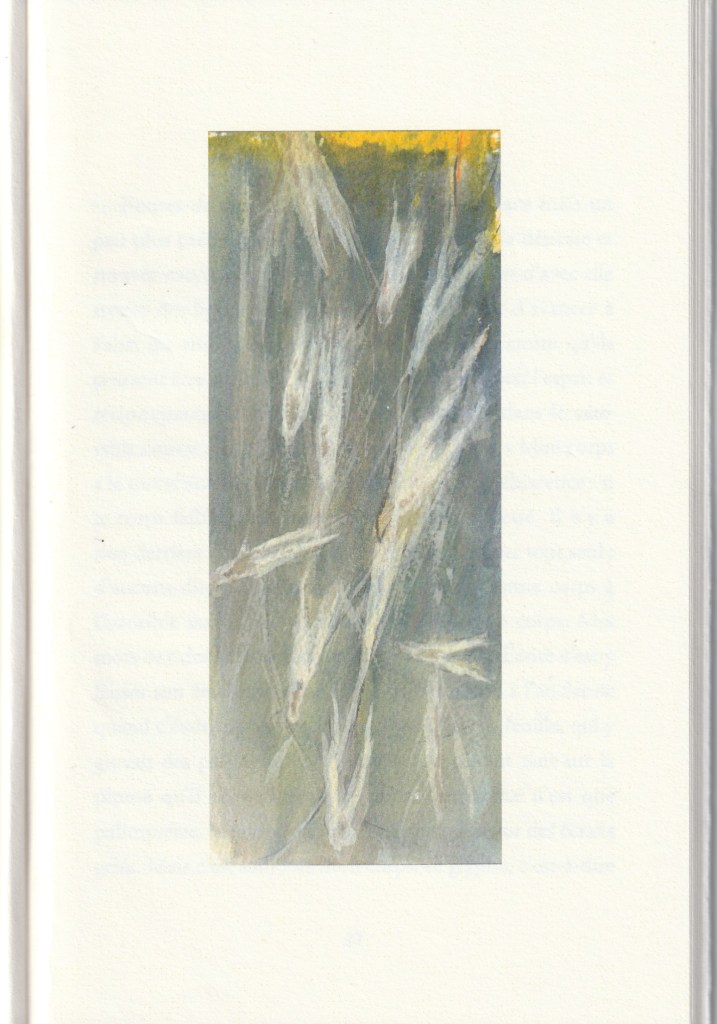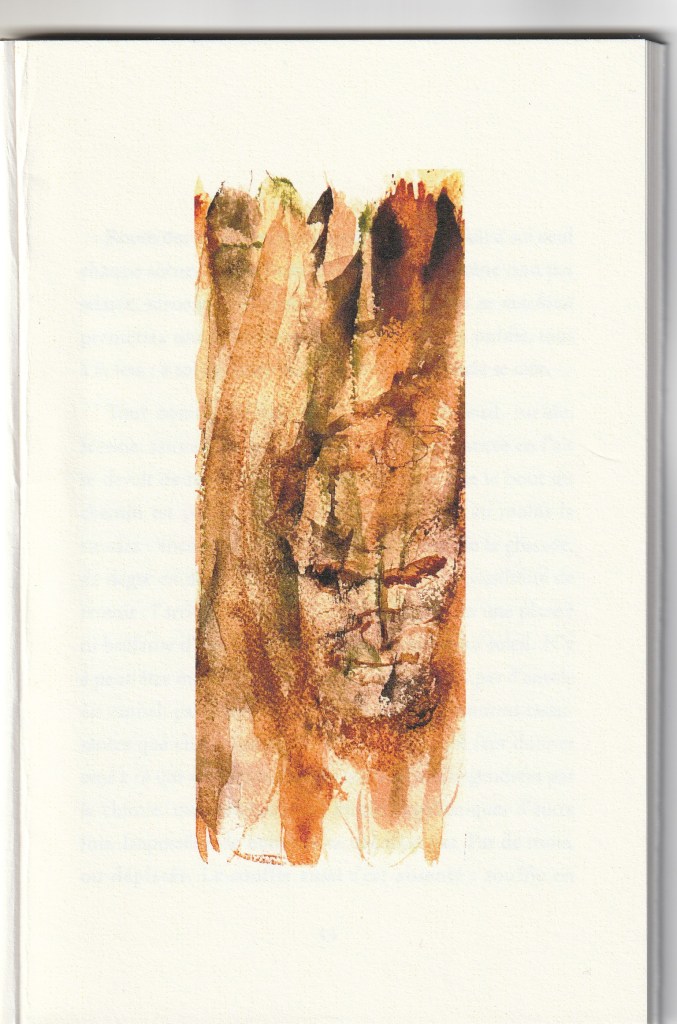Une chronique de Marc Wetzel
Jacques GUIGOU, Monostiches, l’impliqué, décembre 2024, 28 pages, 20€
« Iode est là et mémoire monte (…)
Astres sur littoral les rochers de la jetée
taisent leur finitude » (p.10 et 12)
Trois de ces « monostiches » (de courtes formules, semblant se découper d’elles-mêmes, des vers qui s’isolent à leur tour comme des véhicules de mots qui viennent se ranger ou se garer là où la pensée le leur indique, alors qu’elle-même continue sa route) sur la grosse soixantaine du recueil, se ressemblent assez pour qu’un petit commentaire veuille les rassembler :
« Soudain sur le quai
le coup de patte de ce qui n’apparaît pas » (p.3)
On est sur un quai pour attendre, ou observer, un départ ou une arrivée; d’un autre ou de soi. Quand on voit apparaître le moyen de transport, ou son voyageur, le quai comme tel disparaît. On ne l’aménage que pour accéder au transitoire, et passer à autre chose. L’accostage, l’embarquement, l’adieu faits, le quai se quitte, s’efface, s’oublie (jusqu’au prochain rendez-vous). Mais l’inapparent aussi, suggère Jacques Guigou, a son quai – et son défaut de présence, lui, déménage ! La déception a une rude manière d’arriver, qui renverse ses aveugles.
« Le devin du rivage s’avance vers ce qui
n’a pas été dit » (p.8)
Un devin « avance » ce qu’il devine. Il propose l’avenir qu’il sait, lui. D’où parle-t-il ? Du « rivage » d’un présent, toujours, qu’il partage, de moment en moment, avec les non-devins (les rivés au temps, les aveugles à ce qui se forme). Les non-devins, eux, sont sérieux, ternes, prudents : ils avancent vers ce qui a été dit ! Ils témoignent du formulable, ils attestent de l’exprimé, ils commentent la simple affaire (en cours) de vivre. Le devin, au contraire, c’est un peu le locuteur invisible qui double (on ne sait trop quand ni à quels rangs) la cohorte des bavards. Les bavards, qui n’en ont rien su, comprennent qu’on les aura insensiblement bougés de place : un vent blanc aura sans doute slalomé entre leurs dégaines – et, le devin ayant changé l’issue, personne ne saura plus qui gagne !
« Sur ce rivage un jour viendra porteur de
ce qui n’a jamais commencé » (p.11)
La part de ce qui n’a jamais commencé dans ce qui est là est difficilement déterminable, est trompeuse. Si chacun sent bien que sa crampe, sa quinte de toux, sa fièvre ou l’averse du soir ont (il y a peu) « commencé », pour son propre corps ou pour l’atmosphère dehors, c’est moins patent : qu‘on se soit un jour devenu apparaît peu. Et si la marée, le brûlis, l’éclipse se savent datés, la mer, la forêt et la Voie Lactée font moins facilement leur âge exact. Il y a très peu de candidats naturels à l’éternité : l’énergie, la lumière seule peut-être (le pouvoir de faire jour). Mais ce qui donne le jour à l’éternel même (qui n’a rien de forcément sacré, qui est le simple perpétuel tissu de la présence, la litanie d’être), cela, seule une rare vaillance poétique sait en épier le signal. Pour décharger l’éternel, peu de dockers partants, disponibles!
On a, comme on voit, retenu ces trois monostiches (un peu commentés) pour la commune « négation » qu’ils contiennent (qu’ils arborent, qu’ils assument) : « ce qui n’apparaît pas« , « ce qui n’a pas été dit« , « ce qui n’a jamais commencé » – et la question est : pourquoi convoquer ainsi ces états privatifs, ces sortes d’absences militantes ? Pourquoi une telle attention, chez notre poète, à ce qui manque de présence, de sens ou d’origine ? Quelques pistes :
D’abord on est un vieil homme (l’auteur est né en 1941), on sait qu’on a longtemps vécu, et on le sent moins à la fatigue ou à l’oubli qu’au rapprochement accéléré de tous nos moments de vie entre eux. Notre vie, de mieux en mieux saisissable comme ce que nous aurons bientôt été, confond, devant la fin qui vient, les présents (notables) qui l’ont constituée. Toutes les périodes de ce qui a été se mêlant, s’indistinguant peu à peu, nous hante d’autant, par contraste, ce qui n’a pas été. Comme dans une fête, une réunion de famille : plus tout le monde est là, plus les absents se voient. Ce qu’une existence ne fut pas éclate au moment de n’être bientôt plus. Adossé à l’immense caravane des événements d’une vie, ce qui n’a pas été, qui en ferme la marche, prend toute la place. « Avec le temps tous ses présents se rapprochaient » (p.25), et, isolé, comme seul survivant de l’élan épuisé de vie, « le désêtre a passé son trench-coat » (p.15)
Ensuite, on a, depuis presque toujours, parlé et pensé. L’homme est un être qui peut et veut savoir ce qui le conditionne, et qui conditionne à ce savoir ce qu’il fait de lui-même. Il se parle pour pouvoir agir sur sa pensée, et parle aux autres pour changer la leur. Ses buts – qui par principe ne sont pas encore – agissent en lui, et, parce qu’il parle et pense, il est le seul animal à agir sur ses buts, et à pouvoir changer ainsi ce qui n’est pas encore. Accédant aux conditions de ce qui est présent, l’homme est l’être hanté par ce qui ne l’est pas. Il a ainsi prise sur ce qui n’est pas – et en tout cas, par l’imagination, sur ce qui n’apparaît pas; par l’invention verbale, sur ce qui n’est pas dit; par la mémoire il remonte en amont de tout ce qui a déjà commencé. « J’oriente le temps vers une durée sans prélèvement » (p.15) : la formule est très énigmatique, mais l’énigme, justement, est, par cela même, formulable. Et un poète est quelqu’un qui devine, dans la présence même des choses (ici, celle de la mer), ce qui est plus vieux que son esprit même : il chante, non l’âge de son esprit, mais ce qui devait ne pas avoir commencé pour le permettre. C’est dit ici comme un oracle sobre, familier, comme le constat content qu’on aura été pensant de justesse, et qu’on rend volontiers son tablier de mots (puisqu’on l’avait emprunté à l’intendance intemporelle) : « La mer annonce maintenant cette agonie du temps qui précède le poème » (p.13)
Enfin, le réalisme foncier de l’auteur (il croit absolument que les choses sont là par et pour elles-mêmes, qu’on y chante ou les arpente ou pas) est chez lui un souci de justice (et un pari de réparation !). Les idéalistes s’imaginent que leur moi est hors des choses et ne leur doit rien. Jacques Guigou sent, à l’inverse, que les choses sont, toujours déjà, à leur insu, leurs propres sujets mutuels : oui, les éléments (« les entrées maritimes », « les rochers de la jetée », « les vols des étourneaux », « les vents de mars », »le sec et le salé s’obstinant sur le sol », « les platanes de la place », « les graves chorégraphies des crabes », « le jazz de la vague qui déroule son phrasé » …) ont affaire les uns aux autres, et les êtres qui sont faits d’eux ont pour tâche de s’en arranger, pour défi de « faire l’affaire », pour mérite de développer ce à quoi ils se doivent, et de se vouloir bien relais de ce qu’ils ignorent à jamais. Les choses ignorent être au service du monde, et constituent ce qui pourtant ne leur apparaît pas, ne leur est pas dit, est au-delà, toujours, de ce qui les fit commencer. Le poète fait parler les choses pour penser ce qui n’a pas besoin de leur apparaître, de leur être dit, de dépendre d’elles … pour exister, pour être puissance de présence, pour suivre de loin, comme une voiture-balai infinie, tout ce qui, hôte d’univers, dispose du peu de soi-même.
Cette insistance éternelle (qui fait de tout existant, avant tout, le simple effort de s’obtenir suivi de la grâce de s’effacer) exclusivement et magnifiquement chantée par ce poète est, bien sûr, sans Ciel vivant, sans voeu de vaine survie, sans désir de résurrection (une vie de l’au-delà serait plutôt saisie, comme en Extrême-Orient, comme une insupportable punition. D’une fâcheuse réincarnation, à contre-nirvana, « qui dira le regard de l’évadé repris » …, p.15 ?), mais l’espérance poétique (nette, claire, partageable) est là, comme une attention de la parole à ce qu’elle ouvre, permet et sauve. « Nos pas à jeun d’une espérance » (p.21) trouvent de quoi formuler leur nourriture et nourrir l’enfance perpétuelle du Tout :
« Espère l’arrivée du mot
qui contient tout » (p.22)
« Prends ce qu’il te faut d’espoir
aux lèvres avides du nourrisson » (p.16)
Et, ainsi :
« Aime ce littoral vierge de sacrifice » (p.27)
© Marc Wetzel
Essayiste et sociologue, Jacques Guigou (1941) a une oeuvre poétique importante et originale. On la découvrira sur son site. On signale ici, parmi ses dernières publications, Sans mal littoral (L’Harmattan, 2022) et Petite Camargue (Encres Vives, 2024).