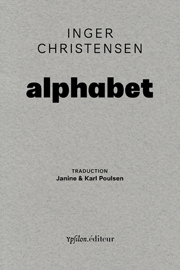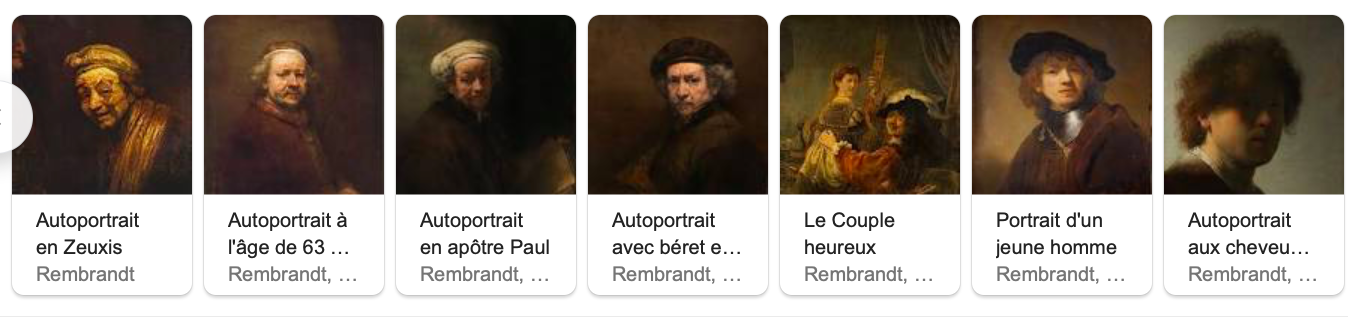Chronique de Lieven Callant

Philippe Jaffeux, Mots, Éditions Lanskine, 2019, 172 pages.
Avec ce livre, Philippe Jaffeux revient sur les mots importants qui jalonnent son oeuvre.
On redécouvre les principes chers à l’auteur qui sont de confier aux textes différents rôles: l’un purement esthétique se basant sur des aspects visuels et sensoriels. « Mes textes éprouvent le besoin d’être vus autant que lus » P79. Les textes ne comportent aucun paragraphe et remplissent les pages à la manière d’une couleur qui remplirait la toile de fond d’un tableau. L’autre fonction du texte, plus voilée ne doit rien à l’apparence visuelle mais nous invite à découvrir les profondeurs, à établir la genèse, à renouer avec les bases essentielles de l’écriture. Écrire n’est pas que transmettre un message, faire passer des sensations. Pour Jaffeux, il importe aussi de circonscrire des étendues plus vastes et presque impossibles à mesurer ou à décrire avec de simples mots: l’intime valeur des choses et des concepts.
Le texte est à la fois matière « vivante », charpente qui se dévoile dans sa forme la plus visible mais il est aussi ce coffre-fort difficile à ouvrir et qui nous donne ce qu’il a de plus essentiel et qui naturellement ne dépend d’aucun standard artistique. On peut regarder le texte s’étendre de page en page mais si l’on veut percer ses mystères, il faut le lire. Il faut se confronter à tous les textes présents en lui.
Le lecteur a donc un rôle crucial à jouer dans les textes de Jaffeux. Une fois de plus, il est invité activement à s’interroger avec l’auteur sur la gestation d’un texte. Mots, lettres, interstices, ponctuations et rythmes, souffles et essoufflements de l’être mi-robot-machine, mi-humain-faillible. Si la question essentielle se porte sur les choix des mots, sur les mots eux-mêmes et les concepts qu’ils portent, elle ne va pas jusqu’à retirer à l’humain ce qu’il a de plus fondamental, au contraire.
L’alphabet est la graine, le mot, la feuille, la phrase, la fleur, le texte la plante. La terre, le support c’est l’homme. Ce qui met en jeu l’écriture, comme un cycle de vie, c’est l’idée guidée par le jeu, vouée aux hasarts*, acceptant ou défaisant les lois et les règles. L’idée ou l’absence d’idée car on revient sans cesse sur ses propres pas dès qu’on imagine, dès qu’on rêve. On redevient l’enfant ou on le reste si l’on touche à l’écriture. Lire c’est aussi jouer.
Une fois de plus Philipe Jaffeux obtient un texte qui défie les genres, ce n’est pas un essai où se déploie en toute logique une vision de l’écriture et de ses éc-arts. C’est un texte qui explore aussi sa propre disparition. C’est sans doute cet aspect qui m’interpelle le plus en me confrontant à ma propre disparition et aux rôles joués par un auteur/acteur.
Les textes sont ouverts à tous les possibles. L’égo réussit à s’effacer et à être dépassé. Bien évidemment, le texte ou peut-être plus justement les textes de Jaffeux font références à d’autres oeuvres littéraires, musicales cinématographiques ou à des courants de pensées comme le Tao si bien qu’en de nombreux endroits, le lecteur est comme prisonnier d’une galerie de miroirs. Dans un labyrinthe d’échos et de reflets, il se produit une mise en abîme enivrante, presque infernale et malade des oeuvres.
Philippe Jaffeux invoque les mots et son écriture participe à une sorte d’étourdissement, un étourdissement salutaire car au final en explorant l’infini il détermine nos limites singulières.
À la page 75, l’auteur s’interroge, cette question m’a semblé définir à elle seule les défis que se lance Philippe Jaffeux à lui-même et par l’intermédiaire de ses textes à nous tous : « Comment écrire sans écrire; sans intervenir afin de laisser vivre une langue, en contact avec ses propres limites, qui s’ouvre sur une complexité du réel? » Comment vivre sans vivre, comme se retirer de ce que nous avons commencé d’écrire sans y mettre fin? La complexité du réel est ce à quoi nous confronte la vie jusqu’à sa limite humaine ultime.
citations
La fabrication d’un texte situe le lieu où le visible et l’invisible se confondent. L’acte d’écrire se rapproche-t-il d’une forme de méditation; est-il un outil qui peut nous éveiller aux potentialités inexpliquées du sommeil? p33
L’acte d’écrire est un sport sorcier, comparable au zen: une modeste discipline spirituelle qui fortifie la puissance incantatoire de notre silence. P37
Le hasart*, véritable auteur de mes textes p46
A ce propos ces « Mots » ont été écrits avec l’intention de ne plus faire de distinction entre la théorie et la pratique; entre le texte d’argumentation et celui de la création. P49
Mes textes ont été écrits pour tenter de traduire des musiques qui, elles-mêmes, sont peut-être les seules à pouvoir interpréter mon écriture. Les mots trouvent un sens neuf, un déséquilibre opportun, lorsque des phrases s’imprègnent d’une alchimie ou d’une structure musicale.P69
L’acte d’écrire s’apparente parfois au rêve ou au somnambulisme; à des états de conscience modifiés, à des hallucinations, voire à de la transe ou à l’extase.P77
Les lecteurs-regardeurs se perdent dans un labyrinthe de mots et de pensées chaotiques.
© Lieven Callant
Hasart* est un mot volontairement mal orthographié par Philippe Jaffeux et régulièrement utilisé dans ses textes. Comme si au hasard, l’auteur confiait une faculté artistique.