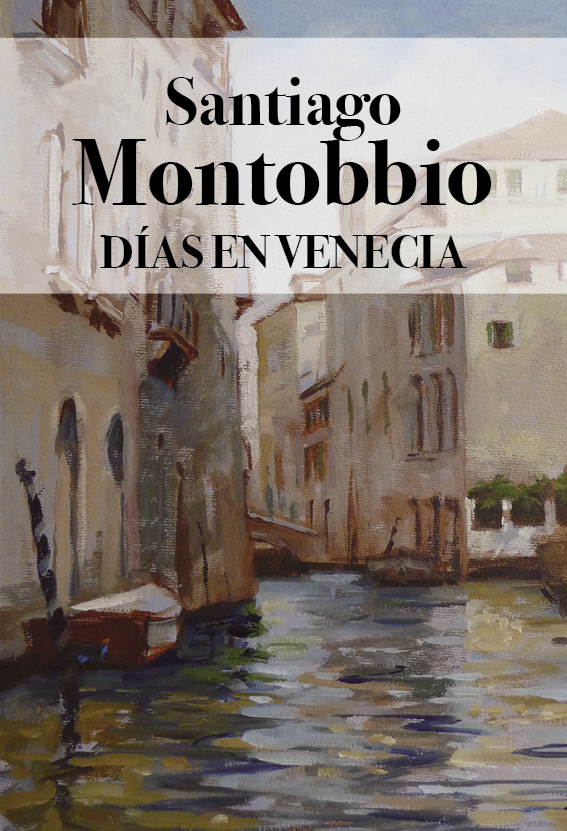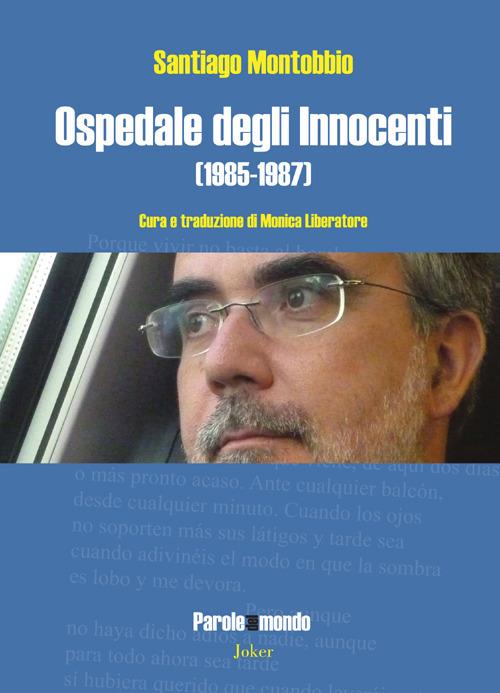Une chronique de Jean-Luc Breton
Santiago Montobbio, La libertad de la poesía, Onix Editor, Colección:Nueva Bilblioteca Intima, Barcelona, 728p, €24.00.
Dans un des premiers textes de ce nouveau recueil de Santiago Montobbio, il dit « Ceci n’est pas un poème, je le sais / ceci, je ne sais pas ce que c’est ». Et, de fait, dans le domaine de la poésie, l’édition d’un volume de plus de 700 pages est un phénomène suffisamment exceptionnel pour que se pose la question de sa nature. Quand on relit les poèmes de la première période de l’écriture de Santiago Montobbio, comme Hospital de Inocentes, son premier, fulgurant, recueil, de 1989, on se rend compte du chemin parcouru depuis cette explosion de rythmes, de sons, d’images, associant dans un subtil équilibre humour juvénile, érudition littéraire et interrogations métaphysiques. La libertad de la poesía n’est en effet sans doute pas un recueil de poèmes, au premier chef peut-être parce que le point de vue n’est en rien distancé. Santiago Montobbio nous parle de Santiago Montobbio et nous fait pénétrer dans son environnement naturel, d’une part, avec quelques lieux emblématiques de son existence dans les quinze mois qui séparent le premier du dernier des textes du recueil (juillet 2021-octobre 2022), et littéraire d’autre part, souvent avec des textes en prose portant sur ses lectures et relectures. La libertad de la poesía n’est pas pour autant un journal intime, parce que l’auteur, bien qu’omniprésent, n’est jamais trivial ou anecdotique et ses textes sont plus des micro-épiphanies que des chroniques du quotidien.
Environnement naturel et environnement littéraire sont liés : Santiago Montobbio dit que « la campagne […] est aussi un livre. Libre et livre. Libre comme un livre ». Le recueil est donc à la fois une communion, une libération et une célébration. Ce qui a changé aussi depuis les premiers recueils de Santiago Montobbio, c’est que La libertad de la poesía est tout entier empreint de joie de vivre. C’est une ode aux bonheurs de la nature (les arbres, les oiseaux, la lune) et de la littérature (les poèmes, les livres, les bibliothèques, les librairies). Toutefois, si on ne peut se résoudre aisément à amalgamer poésie et noirceur d’âme, il est difficile pour autant qu’un recueil de plusieurs milliers de poèmes puisse n’être qu’une célébration de la vie.
Il y a dans La libertad de la poesía, au-delà de l’évocation, une dimension panthéiste. Si le poète évoque tellement les petits bonheurs de la contemplation du monde, c’est qu’il veut être « l’air, les champs », même « le bruit de l’air entre les arbres », comme si cette communion épiphanique quotidienne était un moyen, voire le moyen, de se prouver qu’il vit. Celui qui, dans Hospital de inocentes, cherchait à « passer […] du silence à l’oubli » ou qui se fabriquait « chaque jour / quelques peu vraisemblables stratagèmes qui m’aident / à feindre demain encore que je suis vivant », chante désormais « la belle lune pâle » qui « se montre le soir / sur le mur et entre les pins. Je la vois et je sens / qu’elle réclame un poème. Qui dise et certifie / que je suis vivant ». On trouve ailleurs le cri « Poésie, ne m’abandonne pas dans la tristesse et la fin ». Et ce cri ne peut qu’éveiller en chacun les angoisses bien naturelles devant le temps qui s’écoule et s’approche inexorablement de son terme. D’où la récurrence des évocations de l’air, de l’ouverture, d’où aussi l’importance donnée à l’écriture, même au sens premier du terme : « Un / poème commence, commence toujours, il ne s’arrête jamais ». De même, les écrivains qu’on lit avec plaisir sont tout aussi vivants que nous, puisqu’ils sont en nous. On pourra reprendre un exemple du recueil : Homère a nourri Joyce, Homère et Joyce ont nourri Sabato, Homère, Joyce et Sabato nourrissent Montobbio.
L’une des nombreuses références citées par Santiago Montobbio est le roman Fortune de Joseph Conrad. Un critique ayant reproché à l’écrivain l’excessive longueur de son roman, Conrad avait répondu que tout roman peut tenir en trois termes, « ils sont nés, ils ont souffert, ils sont morts » et que le travail d’écriture était justement de créer, à partir de ce schéma narratif de base, un univers propre, grâce à détails et ornements. Et c’est justement dans ce hiatus entre trame et roman accompli que se situe la littérature. Si La libertad de la poesía a, comme recueil de poèmes, la singularité de sa longueur, c’est un témoignage important sur le retour heureux et simple à une vie « normale » après le confinement de 2020, sur la célébration de la beauté de la vie dans les villages de Catalogne, les villes de villégiature balnéaire et Barcelone, dont la présence est dans ce recueil plus prégnante que jamais peut-être (les rues, les jardins, les immeubles de Gaudí), ainsi que sur le paysage culturel intime d’un poète grand lecteur.