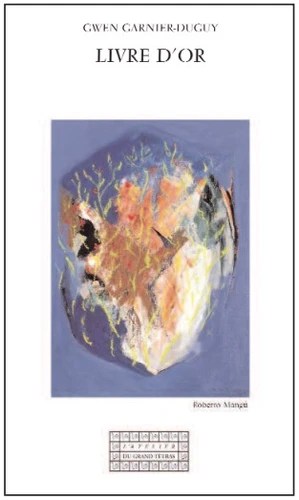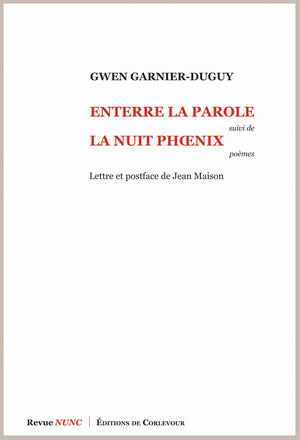Une chronique de Gwen Garnier-Duguy
Jean Maison, Un chemin de croire, éditions Ad Solem, 124 pages, 2023, 17 euros.
Par le jeu de mot choisi par Jean Maison dans le titre de son dernier livre, Un chemin de croire, le poète inscrit ses pas dans ceux d’une foi exemplaire à la suite du Christ de son enfance : « Son écriture sur le sable et son effacement m’éveillent plus qu’autre chose à la fondation du Verbe. » Il énonce avec une clairvoyance bienfaitrice des vérités – bien qu’il dise n’en avoir aucune – que la confusion ambiante entretenue par un monde sans lumière empêche de voir. Ainsi parle-t-il par exemple « d’instinct spirituel », évidence de notre complexion animale désormais enfouie avec l’anéantissement délibéré de l’intelligence. Cette exhumation, dite avec une telle économie de moyens, possède la vertu de nous remettre sur les rails de ce qui a fondé notre humanité. Car Jean Maison le sait puisqu’il s’en revendique : l’eau du baptême est celle qui nous abreuve dans le désert moderniste d’une autre apocalypse : « dans le ciel renouvelé un prodige semble advenir. »
La première partie de ce livre, Fresques, consiste en des poèmes lapidaires comme déchiffrés sur des murs anciens. Et c’est l’évocation de Judas qui inaugure cette parole où sans l’agissement du traître, nul livre n’aurait pu annoncer aucune bonne nouvelle. Le « croire » commence ici, par la figure d’un homme, qu’on le veuille ou non, de foi. Un dialogue avec la vie est alors possible, au gré de nos existences laborieuses, en regard de cette fidélité qu’une traîtrise dont nous sommes capables, voire acteurs, au fil de nos complicités quotidiennes avec le mal, ouvre sur le ruisselet de la parole. Le poète, dans un poème adressé à son père par exemple, chante ces mots : « La foret rescapée du carnage/A gardé le secret de tes mains/Ton absence a rejoint dans une goutte d’eau/L’arborescence des signes ». Ou lorsqu’il évoque Marie : « Marie aux mains jointes/Partage le pastel de sa tunique/Avec l’arche intime du cloître/Et sa voûte céleste ». Ou encore, peut-être, au Messie dans ce poème bouleversant :
« La noblesse/De cet homme au travail/Ajuste la tonalité de la terre/A l’oraison du jour//L’indicible commencement/Avec sa provision de branchages/Ne voit ni le feu/Ni la cendre ».
Depuis les images des Fresques montent, deuxième partie, un Agnus Dei se confrontant au Mal du monde. Cette lecture par le poète des 14 stations du chemin de Croix se peuple d’échos miraculeux que sa voix recueille dans une dialectique avec le Mystère :
« Il faut désormais additionner l’ombre et l’homme » ; « Il s’effondre de nouveau/Arbre et ciel » ; « C’est le jardinier de la résurrection/Que Marie Madeleine reconnaît à la voix ».
La troisième partie, Un chemin de croire, prolonge avec ses 14 poèmes les stations de la partie précédente, là encore comme en écho : « L’âme n’a pas de centre/Ni ombre ni nombre ». C’est un chemin de joie pleine et entière que le poète vit et offre à partager par la grâce de la langue commune : « La gratitude/Levain de l’âme/Ne néglige pas le corps/Elle l’enchante ». Il parle au Christ, dans une humble intimité d’amour : « Seigneur ne me disperse pas au vent/Sous la tempête que je reste clos/Conduisant ma charrette/A travers le pays ».
La dernière partie consiste en une Prière pour un jour neuf , s’étendant sur un ensemble de 41 poèmes formant cette prière entière. Elle commence par une confidence, celle du poète voyant un petit garçon en pleurs dérivant à la surface des eaux : « J’ai engagé ma vie pour le sauver ». Et le poète se reconnaît dans le visage de cet enfant : « Je n’ai plus que vous Seigneur à cet instant ». C’est une prière qui rassemble les souvenirs d’enfance depuis l’adulte devenu. Une prière qui étreint du regard le monde tel qu’il ne va pas, ajustant la hausse de combat ontologique à la taille de la société toute entière. D’ici, les illusions sont démasquées et font pâle figure. C’est une prière d’une poésie grandiose, convoquant la beauté de la nature en ses leçons discrètes pour une respiration neuve : « D’aussi loin que l’on porte le regard, la terre accordée se mesure à la lumière . » Car il s’agit, par la prière, de retrouver la dimension d’homme, celle lisible dans la déconstruction revendiquée, dans la détresse commune, à travers l’ignominie de certains : « Il faut prier pour sauver les mots outragés. »
Qu’un tel livre voie le jour aujourd’hui, voilà qui ne peut laisser d’émerveiller les adeptes de la poésie et devrait émouvoir le monde. La forme secrète de ce livre, pour qui s’efforce de croire, intime le respect. Quatre parties, car le poète fait l’expérience du monde, avec le Christ d’enfance comme épicentre. C’est le cercle dans le carré, c’est-à-dire l’esprit dans la matière, les êtres humains fraternisés conjurant l’inaccomplissement de ce temps et de l’espèce. Nul combat contre la Nature, mais épousailles avec elle par la possible transfiguration du Verbe.
Car « La vie surgira de la parole ».
Ce Chemin de croire se propose ainsi comme un étincelant compagnon de route dans la terreur en cours.