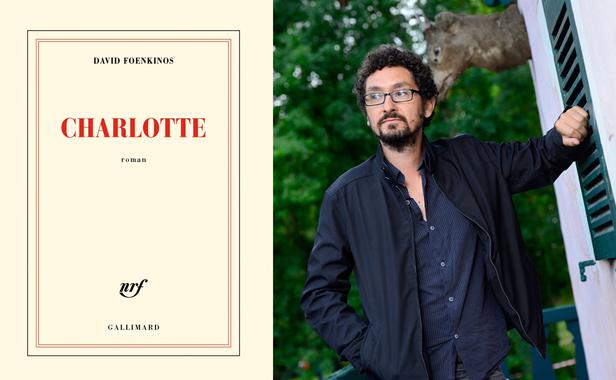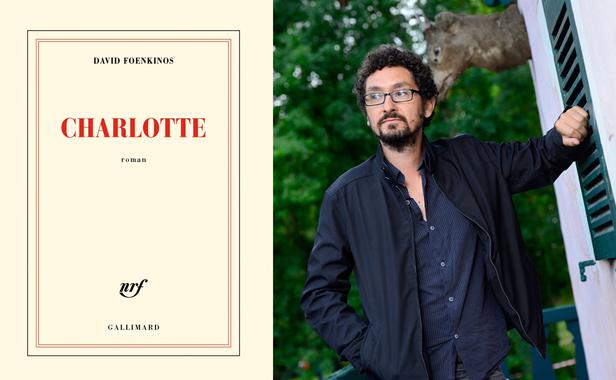
RENTRÉE LITTÉRAIRE SEPTEMBRE 2014
Un rappel pour les retardataires, d’autant que son auteur David Foenkinos décroche à la fois Le Renaudot et Le Goncourt des lycéens 2014. Félicitations.
A noter que c’est la première fois qu’ un auteur réussit ce doublé.
Que de chemin parcouru depuis le no 57 de Traversées (Hiver 2009- 2010).
Relisez ses nouvelles dans le no 72, juin 2014 et laissez-vous « charlottiser ».
Les prénoms semblent inspirer David Foenkinos. Après Bernard, voici Charlotte.
Mais qui est cette héroïne qui a hanté l’auteur pendant des années, au point de marcher sur ses pas, avant de coucher son destin sur papier ?
Comment et où a t’il débusqué cette graine d’artiste, considérée « un génie » ?
Au fil des pages, David Foenkinos fait des incursions pour nous révéler la genèse de ce roman, qui mit du temps à germer, travail de longue haleine. Il s’était d’abord intéressé à Aby Walburg et sa « bibliothèque mythique », conservée à Londres.
C’est en 2006 qu’il fit cette rencontre providentielle avec Charlotte Salomon au musée d’art et d’histoire du judaïsme. Il nous livre ses interrogations, ses doutes, sa quête du Graal pour s’imprégner des lieux où elle a vécu (son école, son appartement à Berlin, son quartier Charlottenburg, la maison de la riche américaine à Villefranche, le cabinet du docteur Moridis (son protecteur), l’hôtel de Saint-Jean-Cap-Ferrat, La belle Aurore). Il relate ses difficultés, essuyant parfois des refus ou découvrant que l’accès au jardin de L’Ermitage, autrefois « si accueillant », « à l’allure de paradis », dans lequel Charlotte a communié avec la nature, est « impossible ».
Les photos restent les liens de la mémoire, tout comme les lieux, les murs sont « les témoins immatériels du génie ».
Cet éblouissement, ce foudroiement que David Foenkinos a perçu en découvrant l’explosion des couleurs chaudes, vives, des tableaux de Charlotte, il lui « fallait l’écrire ». On ne peut que le remercier, à juste titre, de ce partage.
Un choc tel que celui de Guy Goffette devant Bonnard.
Le lecteur est cueilli à froid par une ligne du prologue : « Une peintre allemande assassinée à 26 ans, alors qu’elle est enceinte », puis par ces phrases taillées au couteau, ne dépassant pas 73 signes qui déroulent sa vie chaotique, d’errance.
Cela donne un caractère abrupt qui lacère le lecteur, mais lui permet cette respiration indispensable, comme le confie David Foenkinos : « Je n’arrivais pas à écrire deux phrases de suite », tant c’était oppressant. Il a donc beaucoup tâtonné avant d’aboutir à ce style admirable et inoubliable. En un mot : somptueux.
L’auteur remonte le passé de son héroïne (ses grands-parents), évoque la rencontre de ses parents, puis son enfance, bercée par la voix de sa mère (« une caresse »), baignée dans le culte du souvenir avec ces visites au cimetière. La mort, elle y est donc confrontée très jeune. N’a -t-elle pas appris à lire son prénom sur la tombe de sa tante ?
Orpheline, très jeune, un père accaparé par son travail, elle se retrouve chez ses grands-parents en France. C’est une cohorte d’épreuves que Charlotte va traverser : ostracisme, exil, perte de sa grand- mère avec qui elle avait tissé un lien fusionnel, camp de Gurs, humiliation, vie en huis clos, se terrant avec son mari, dénonciation…). Déchirante, cette scène d’adieu, sur un quai de gare, quittant son enfance, son père, et surtout Alfred, « son premier amour », le professeur de chant de sa belle-mère. Toutefois, des parenthèses romantiques ont illuminé sa vie : la promenade en barque sur le lac, « un endroit magique de Berlin » et la musique (Bach, Mahler, Schubert).
Son don pour le dessin devient une évidence, reconnu par un professeur. Elle suit des cours aux Beaux-arts, mais le climat antisémite l’oblige vite à se terrer.
Son talent, le docteur Moridis l’avait pressenti, d’où son injonction : « Charlotte, tu dois peindre ». Dessiner devient son exutoire, « nécessaire à la cicatrisation d’une vie abîmée ». Peindre pour ne pas sombrer dans la folie. Emportée par une fureur créatrice, extatique, comme Frida Kahlo, elle se raconte dans ses gouaches.
Elle ajoute « le mode d’emploi de son œuvre », sous forme de notes explicatives.
Quand le grand-père jette à la figure de Charlotte le secret familial et décline la litanie des suicidés de sa famille, on imagine la gifle que Charlotte prend au point de songer à ajouter son nom à cette liste. Séisme d’autant plus violent qu’elle découvre qu’on lui a menti. Sa vie n’était donc que mensonge, « cette histoire d’ange » un leurre.
On devine l’intention consciente de l’auteur de frapper l’esprit du lecteur.
A travers le destin de cette artiste, David Foenkinos balaye les heures sombres de l’Histoire depuis la première guerre (« une boucherie des tranchées ») à « La nuit de Cristal ». Il rappelle qu’ « une meute assoiffée de violence dirige le pays. », en Allemagne, des barbares qui expédient les juifs à Drancy, puis à Auschwitz.
Des phrases phares ponctuent le récit : « Charlotte doit vivre », « La haine accède au pouvoir » ou cette phrase talisman : « La véritable mesure de la vie est le souvenir ».
Malgré la noirceur du sujet, cette biographie romancée de Charlotte Salomon reste
paradoxalement belle tant le regard de l’auteur est poétique, tendre, en empathie.
L’élégance du style impressionne, beaucoup d’implicite, surtout quand Charlotte nous quitte. Une porte se referme, la silhouette de Charlotte s’efface. L’auteur, avec délicatesse, respect, laisse place au non-dit. La littérature est là où le silence, l’indicible l’appellent. Mais on devine la révolte intérieure devant l’inéluctable.
Dans l’épilogue, on retrouve Paula et Albert, dévastés par la tragédie, détenteurs d’un bien précieux : les dessins de Charlotte, qui ont fait l’objet d’une exposition avant d’être légués au Musée juif d’Amsterdam.
Si « une œuvre doit révéler son auteur », dans ce roman on retrouve ce qui fait la touche, le charme, la somptuosité de l’écriture de David Foenkinos : la délicatesse , la pudeur des sentiments, même « Le dictionnaire est parfois pudique », les formules originales (« Il serait capable de se cacher entre les virgules », voire animistes : « On dirait qu’il est lui aussi en deuil » en parlant du sapin sombre), les éléments récurrents, à savoir les cheveux ( Alfred y plongeant son visage, tel un tableau de Munch) et les oreilles : « parfaits puits à confidences ».
David Foenkinos a su rendre attachante son héroïne, nous émouvoir et nous faire partager son émerveillement devant ses tableaux aux couleurs si éclatantes qui représentent, comme le confie Charlotte, toute sa vie. Le roman s’achève sur un gros plan de « Vie ? ou Théâtre ? », pétri de signes.(Souffrance, douleur, aussi espoir.)
David Foenkinos ressuscite son héroïne en lui offrant un tombeau de papier d’une beauté rare, servi par une écriture éblouissante. « La mémoire est la seule revanche sur la mort », confie Martin Suter. Ce roman appartient à la catégorie de ces livres qui agissent même quand ils sont fermés et fait du lecteur « un pays occupé ». Charlotte, un prénom sauvé de l’oubli qui fédère déjà un actif réseau d’adeptes.
David Foenkinos signe un roman intense, émouvant, qui met en lumière le talent de cette artiste allemande trop méconnue. Un challenge audacieux, incontestablement réussi, marquant une rupture avec les romans précédents, bien qu’entre les lignes cet opus couvait. A lire avec en fond sonore la musique de Schubert ou celle de Sophie Hunger, comme le préconise la talentueux David Foenkinos.
©Nadine DOYEN