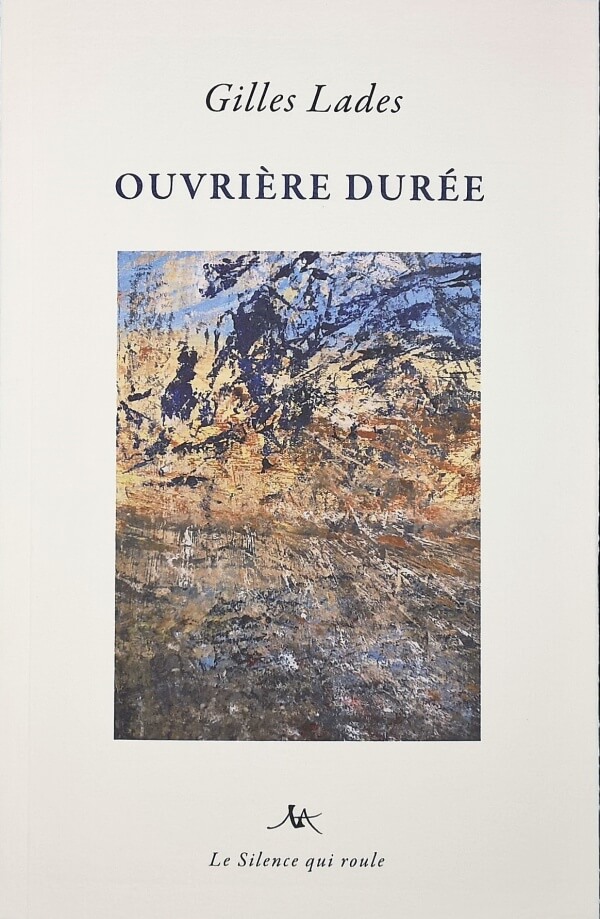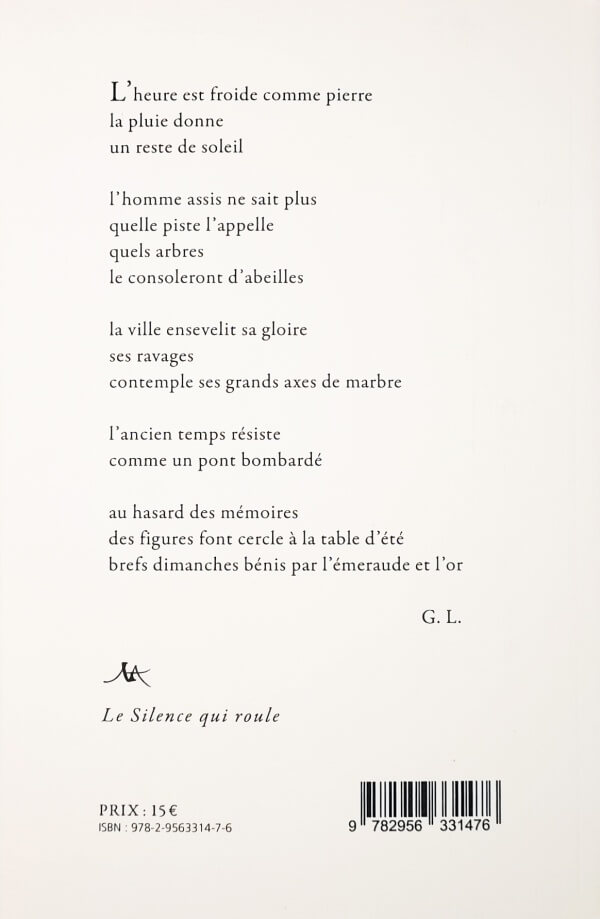Une chronique de Marie-Hélène Prouteau
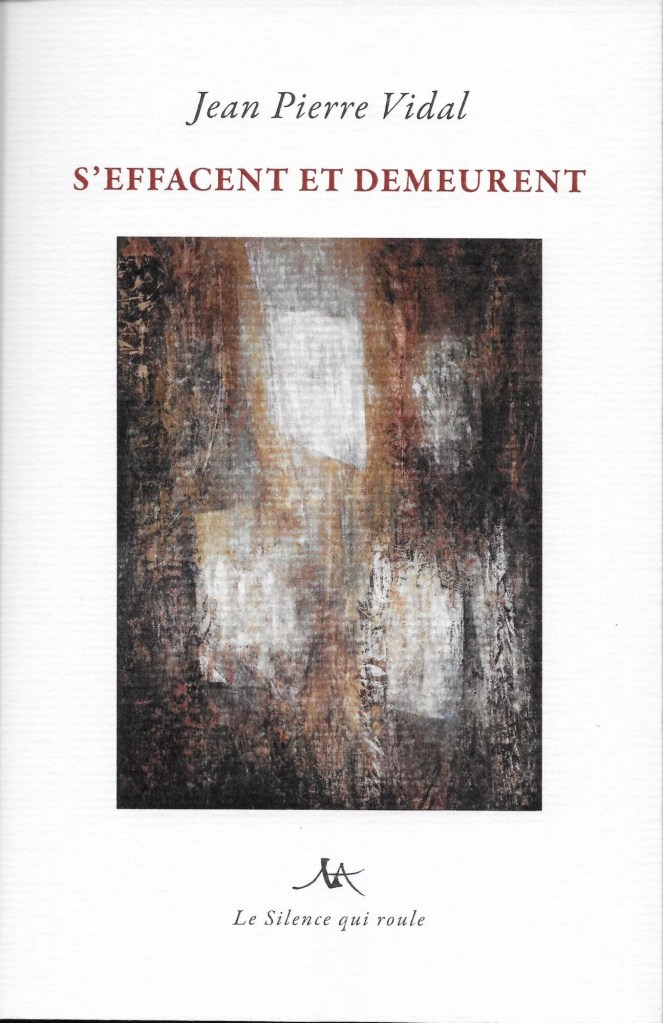
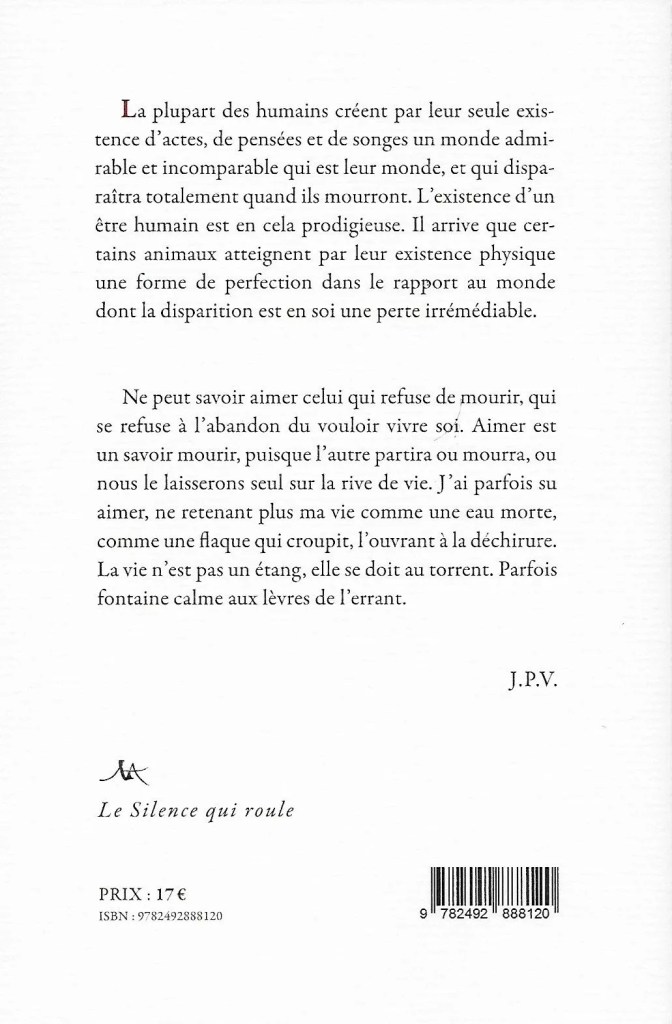
Jean Pierre Vidal, S’effacent et demeurent, éditions Le Silence qui roule, 2025.175 pages.
Ce recueil de Jean Pierre Vidal, tissé de fragments, de présences – en particulier celles de son père et de sa mère morts – livre une méditation profonde sur ce qui demeure du passage du temps.
Le poète se parle à lui-même, il s’interroge, il se souvient. Il nous parle de nous.
S’effacent et demeurent rassemble des noeuds de vie – moments précieux pour le poète vécus avec ses êtres aimés. Traversés par des voix, des phrases fortes qui se détachent, sorties des ténèbres. Comme celle de sa mère : « Tu veux donc que je meure tout-à-fait, pour toujours ? Elle supposait à tort mon athéisme devant mon abandon de l’Église, comme si l’espoir de la vie éternelle lui était ôté d’un coup, avec la possibilité de m’y retrouver pour toujours ».
Le recueil se compose de dix chapitres, qui, pour le bonheur du lecteur, mêlent des formes extrêmement variées. Tels les fragments notés dans le « Train Lyon-Vierzon, à la fin novembre » dignes d’un mémorialiste classique. Un sous-chapitre du livre est d’ailleurs consacré à La Rochefoucauld. Ou bien encore une réflexion sur les exercices spirituels selon Pierre Hadot et Goethe et, plus largement, sur des concepts de la philosophie grecque antique, Ananké, le destin, Tyché, le hasard, Elpis, l’espérance. Ou encore dans le train Vierzon -Pétersbourg, la rencontre d’une bande de jeunes filles voyageuses nourrie de la finesse d’observation du poète.
Ce qui frappe au fil du livre, c’est le déploiement de la métaphore ferroviaire, véritable matrice qui travaille ces pages. À un double titre. Celui du déplacement qui relie divers lieux essentiels pour le poète. Il y a « la chambre de solitude » du père, la « chambre de l’amour et l’atelier », la « chambre de mort ». D’une autre façon, l’évocation du prince Mychkine dans son train […] Tolstoï dans sa dernière échappée belle » associe des allusions à la modernité comme la vitesse de la machine, le ballast et « l’habitacle hors du temps » qu’est le wagon.
De plus, dans ce déroulé temporel du voyage en train, le poète se trouve en compagnie de Reverdy, de Simone Weil, de Novalis, de Philippe Jaccottet dont il a commenté l’œuvre. Ou de Maître Eckhart très présent dans le recueil. Le regard des mystiques révèle la connivence secrète du poète. Ce double mouvement de translation entre le monde visible et le monde intérieur mène à la dépossession et au dénuement déjà présents dans le double vocable du titre : « Acceptant de me fondre en tous ces êtres et choses de hasard, tous ces « êtres » sans nom, je suis devenu moi-même personne et j’ai joui d’exister sans nom ».
Jean Pierre Vidal inscrit plus largement le train comme métaphore de l’existence et de ses tribulations. Image de ce voyage sans retour qu’est la vie. Ce qu’il appelle « la traversée du pays du deuil ». C’est là que se déroule le combat d’ordre spirituel. La vie continue. Même si le temps commence à manquer. Il y ainsi des passages touchants dans le chapitre « Semence et blé vert » qui évoquent la constellation de plusieurs figures aimées. Sa mère, sa marraine, sa fille, son petit-fils à travers l’image végétale symbolisant la vie relancée.
Combien de vies portons-nous en nous ? Jean Pierre Vidal nous invite à le méditer.
Il faut bien reconnaître qu’il y a de la joie à cet exercice spirituel qui suit la séparation brutale de son pays natal et s’interroge aussi bien sur le divin, sur le sens de la foi. « Je suis riche de mes pertes. Avant ma naissance, j’avais déjà perdu la Lozère, la Suisse, la France même ; toute paix à Verdun ou à Sétif ; la foi dans la Tradition avec un père épicurien et moderniste ».
Jean Pierre Vidal nous offre ici un intense chant de lucidité, de solennité et aussi de tendresse. Un recueil qui se déploie, selon la belle formule de Stendhal, tel un miroir le long du chemin, le chemin de l’humain.