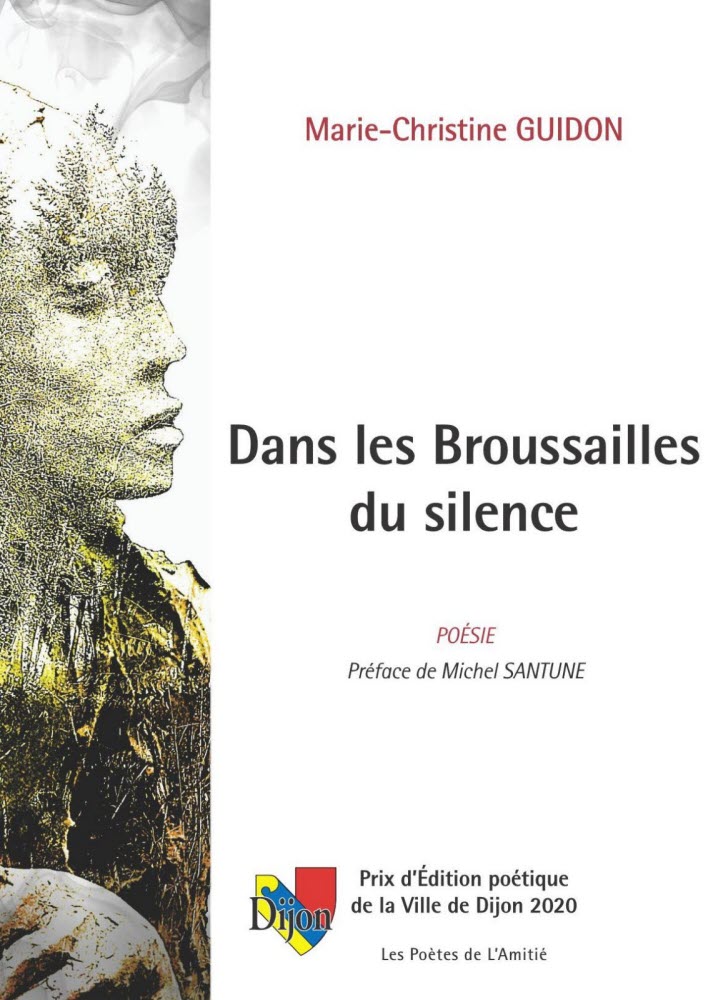Une chronique de Claude Luezior
Xavier Bordes, L’Astragalizonte & autres poèmes, Éditions Traversées, collection Poésie, 213 p. Introduction de Lieven Callant –ISBN : 978-2-96-016582-1

À première vue, le titre peut sembler énigmatique. L’Astragalizonte, statuette d’une joueuse d’osselets (ancêtres des dés; l’astragale est un des os du tarse, à savoir du pied ou de la patte du mouton), est attribuée au sculpteur grec Polyclète et fascine l’auteur de ce livre. L’Astragalizonte, nous précise Xavier Bordes, est une figure de la poésie, d’Aïleen, du coup de dés qui n’abolira jamais le hasard. La poésie étant elle-même liée au Nombre (…) Nous voici dans le monde d’un helléniste de renom, de surcroît musicien, musicologue et poète de haut vol. Mais ne vous découragez pas : jouons aux dés, entrons dans cet univers fascinant, malgré l’aspect imposant de cet ouvrage…
L’introduction magistrale de Lieven Callant nous éclaire. Elle nous explique d’abord qu’Aïleen, mystique et mystérieuse, mère, sœur et épouse, femme et déesse occupe une place centrale dans l’écriture de Xavier Bordes (…) L’inspiration, énergie noire, dicte à l’homme ce qui souvent le dépasse (…) La poésie devient oracle, elle répond aux questions que l’homme se pose, selon des rites et en suivant des règles précises et spécifiques. Le poète se fait l’instrument de la poésie.
Cela dit, et contrairement à ce que s’imaginent certains, le poète est le plus terre à terre des humains… nous dit Bordes lui-même. Le poème est un rapport à ce qu’on appelle l’univers… la recherche au travers du langage d’une adéquation au monde. Il est construit avec ses images, juste pour nous mettre les pieds dans le « réel ».
Jouons donc aux osselets !
S’approprier un recueil de poésies (j’allais dire en poésie) est souvent affaire d’heures, de jours ou de nuits bénies, même s’il faut parfois Pour la millième fois, ouvrir comme une fleur / Un poème à la lumière, avec ses étamines (…) Les présents fragments d’une odyssée inachevée se goûtent à petites doses, tant ils sont riches, denses en images et en pensées : ils ont occupé mon âme, quelques semaines durant. On entre dans une sorte de méditation laïque, comme si l’on épousait une calligraphie, goûtant la forme, l’encre, la construction et la déconstruction de la ponctuation, l’espace, tout autant que la signification propre des mots.
L’Astragalizonte aurait-elle pris le pouvoir ? Jetons ces poèmes sous nos yeux, invoquons Aïleen, déesse de la chance, de la fortune et du hasard : jouons !
… Au pays des phrases dont un vent étranger brosse les paroles, ensemble vers l’aurore, ainsi que les herbes hautes et luisantes sur la pente où des couples se cachent pour l’amour. Proximité de l’auteur avec la nature : Le printemps sent le désir et l’hormone. Des vestiges de l’Eden resurgissent de toutes parts, observant les nuées qui traversent le bleu surpris par le passage d’un avion. Ou par le retour d’une escadrille de colverts dodus comme des quilles.
Ou bien :
C’est à flanc de vertige que chante la cigale
Elle agrippe quelque écaille de réalité parmi la mouvance des airs
Constate le désordre et lui offre son rythme opiniâtre
Rien ne détourne son petit archet
Mistral, cigales : Bordes évoque également avec émotion sa grand’mère provençale, femme subtile et simple (…) qui réservait son âme pour les saveurs d’une beauté ordinaire.
Revenons à la démarche poétique, qui n’est, malgré tout, pas vraiment la langue de tous les jours, mais celle du cœur, nous l’avons bien compris. Il faut s’efforcer d’habiter tel pays d’une langue maternelle, s’en imprégner comme un humus d’engrais, jusqu’à ce que son énergie souveraine à travers un corps de chair prenne la parole.
(L’Astragalizonte me pardonnera-t-elle de citer si fréquemment l’auteur? Il faut bien admettre que ses phrases sont très belles et il me semble légitime de rendre ici au lecteur quelque senteur et saveur de son recueil…)
Coup de dés : silence avant la joie : Ce dont un poète parle importe moins que ce qu’il tait. Bel aphorisme suivi par : il y a tout au fond du poème un cristal chiffré qui ne se livre pas. Sans oublier les profondeurs océanes (à la première personne) : Bernard l’hermite, je squatte la coquille confortable du langage dont, en grandissant, j’élargis la spirale au fil des ans : dans ses tréfonds, elle recèle un abîme amorcé avec ma vie, d’où monte constamment la rumeur de la mer.
Humour tendre cousu ça et là, telle une dentelle :
Le corbeau comme toujours promet « demain, demain »
Il crie cela depuis l’époque des Romains
Poésie terrienne, on vous l’a dit, instinctive au-delà des thèmes souvent naturalistes qui ont pourtant souvent une connotation philosophique. Bordes se plaît à jouer avec la ponctuation, avec la place du mot et des majuscules dans l’espace de la page, avec une langue parfois à mi-chemin entre le texte vertical et une prose plus classique. Toujours il nous ramène aux règles du jeu (mais les dés ne sont pas pipés), de la métaphore, de la phrase construite, de la beauté qui guette le lecteur. Ce livre garde une intime cohérence tant par ses thèmes que par sa forme stylistique. Il en est de même pour divers autres textes qui suivent ces Figures de la poésie, dont Hellenika (Xavier Bordes est un fin connaisseur de la civilisation grecque) et Hivernales, à la « coloration » plus intimiste et qui évoque de nombreux voyages :
Pouvoir de la parole
et nappe de la neige
Un brin d’espoir au fond du ciel
malgré la rivière verrouillée
prend de pâles couleurs
C’est l’Alaska sur les collines
un présent écrasé d’uniforme blancheur
Espaces ouverts à la manière de La Prose du Transsibérien de Blaise Cendrars…
Des semaines durant, nous avons joué aux mots, au hasard, au rêve, à la poésie. Avec L’Astragalizonte, avec Aïleen, avec Xavier Bordes. Depuis les îles grecques jusqu’au fond de l’Alaska. Sur un brin d’herbe et une goutte de rosée. Jusqu’au fond de la nuit et à la pointe du jour. Le coup de dés n’était pas vain…
©Claude Luezior
Commander le livre de
Xavier Bordes
au prix de 15€ttc est encore possible