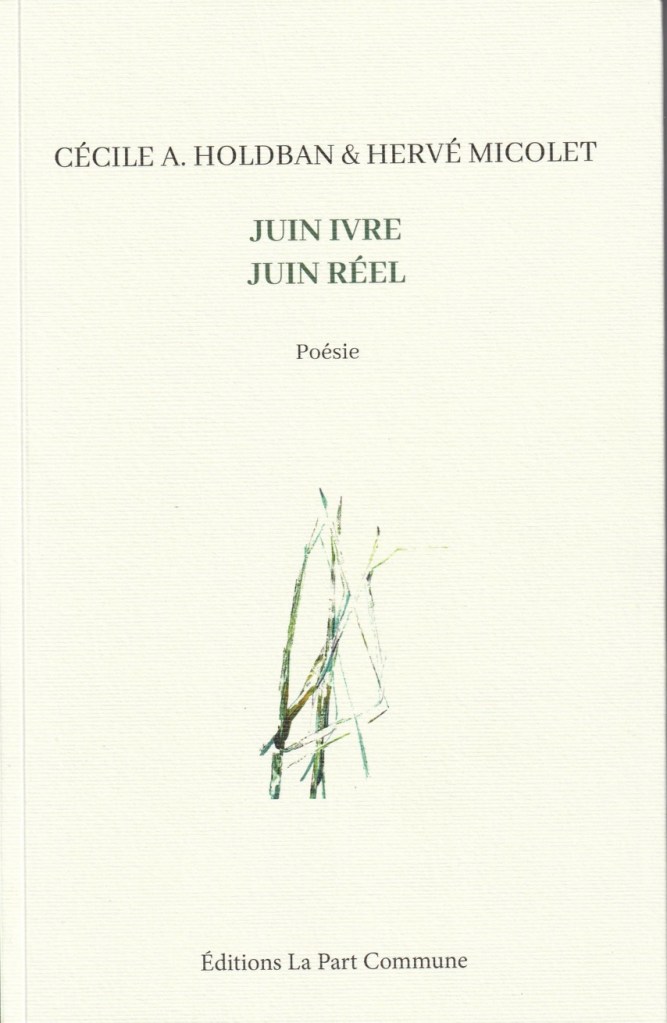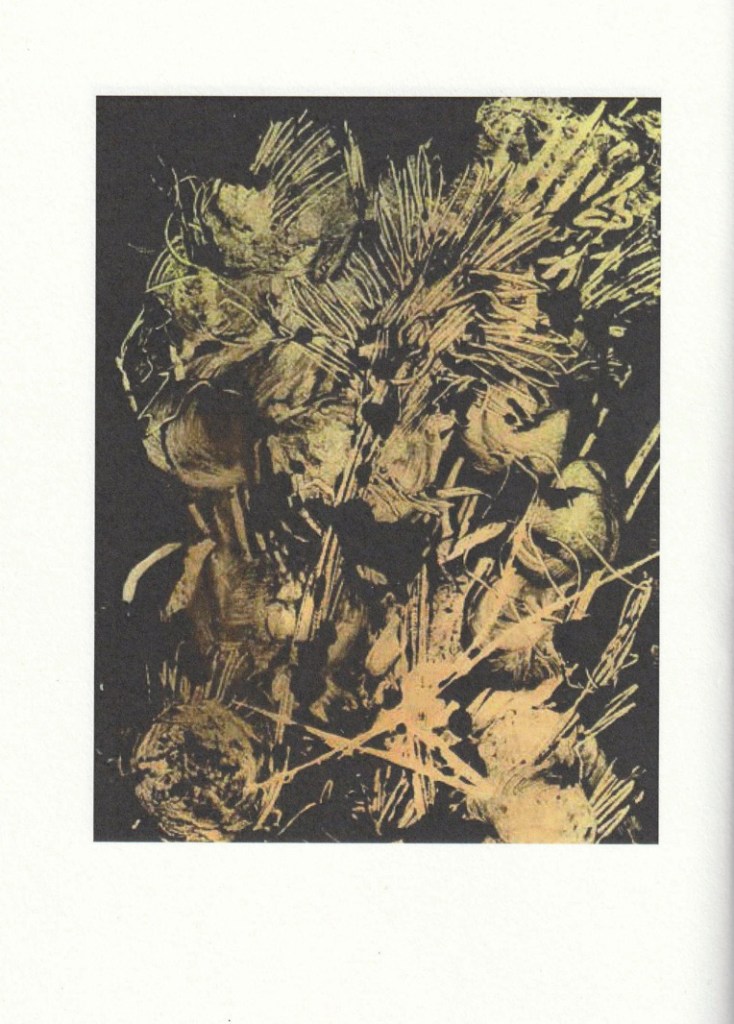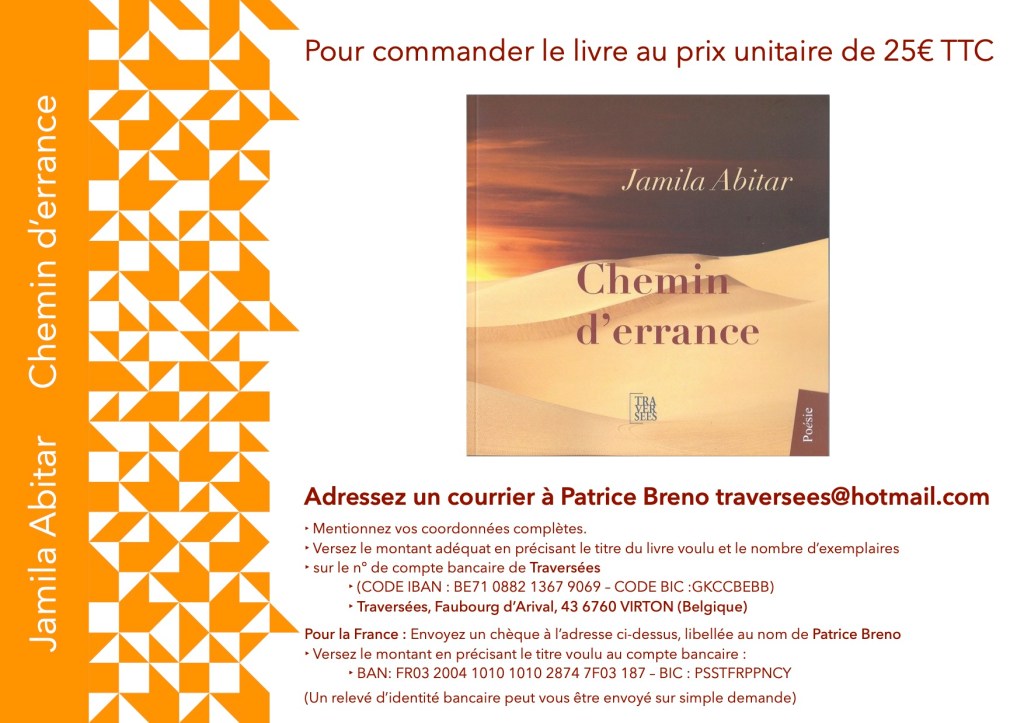Une chronique de Marc Wetzel
Cécile A. HOLDBAN & Hervé MICOLET – Juin ivre, Juin réel – , huit monotypes de Cécile A. Holdban, Éditions La Part Commune, 60 pages, avril 2025, 13,90 €
Pourquoi deux auteurs pour célébrer Juin ? C’est que, si tout mois est astronomiquement double, Juin l’est différemment des autres. Tout mois de l’année, en effet, voit ses levers de soleil chevaucher deux constellations du zodiaque : deux-tiers de temps pour le signe qu’il termine, un tiers de celui qu’il étrenne. Mais Juin, voilà, est fait de deux tiers de printemps – son moment Gémeaux – et d’un tiers d’été – son moment Cancer : en lui se joue le sort de la plénitude (comme en décembre, seul autre mois aussi ambivalemment riche, qui, achevant le Sagittaire, voit mourir le lièvre dionysien de l’automne, et, entamant le Capricorne, voit naître la salamandre vulcanienne de l’hiver, se joue la grandeur du temps, ou l’avenir de l’adieu. C’est le jour de Perséphone, ou Coré, qui s’ouvre alors, pour une saison, la porte sombre de la terre)
» ô
Juin, cher souvenir, je te sais
le mois des grands jours,
véritablement le grand mois
dans la jeunesse de la terre
et du ciel, jusque quand
le soleil est au plus haut du ciel,
si du temps nous est de reste,
et que nous vivons deux fois l’an
le meilleur des jours, celui
de toi, Coré, puis celui de Juin
dans sa gloire la plus grande » (Hervé Micolet, p.22)
En juin, la vie (sous les Poissons, le Bélier, le Taureau) est pour l’essentiel faite, menée à bien : elle a donné ce qu’elle devait. Reste à la penser. Et les Gémeaux sont comme l’arpège (virtuose, cérébral, un peu défensif) de la vie donnée, son exercice déjà un peu distancié, comme le Cancer qui finira Juin cherche déjà, dans sa carapace un peu rêveuse, son étrange « armure » de « trilles », à protéger la vie du trop de soleil qui s’annonce : son silence (ou son murmure doux, enveloppant, un peu indidieux) vient comme recouvrir ou emballer la parole annuelle de la vie, et l’on sent bien qu’une telle coquille du devenir a l’ambivalence de ce qui limite et heureusement circonscrit la neuve poussée des choses, mais pourrait aussi, à l’occasion, proliférer elle-même, prospérer pour son propre compte, jouer à la dotation malheureuse d’une fécondité de métastases. Juin est compliqué, Juin a la réussite subtile, et le fanion métissé, alors qu’il y a des mois simples, « carrés », à l’essor un peu bébête, comme Mai. Mai n’est que l’acmé du printemps, fait du Taureau (où la vie se plaît sans nuances à son travail, et travaille sans recul à son plaisir) et des Gémeaux (de leur début heureux, celui des prises de contact maximales et optimales de la Nature avec elle-même, qui n’aura jamais si bien entre-communiqué, où l’élan créateur qui résout constamment les tensions est la pensée suffisante, qui ne s’examine pas encore elle-même). Juin, à l’inverse, se regarde s’accomplir, entrevoit de quel opaque et monstrueux travail de maturation de la terre sa vitalité est venue, et se demande si sa si somptueuse surface est bien méritée !
« Après
que les semences furent gardées
dans l’obscurité, la Surface
un moment triomphale
jusqu’au Solstice d’été, peut-être,
est avide de s’éjouir et pure vigueur
quasi, avec d’âcres senteurs
& les premières mouches viandardes
& un duvet émis dans l’air, comme
de plumes de poules dont voici
les carcasses. Nature ne cache pas
que sa reverdie se replante
dans un cimetière plus qu’immense,
si que le fastueux printemps
est la véritable fête des Morts.
Dans le règne heureux
où les ombres reviennent,
le jour de Coré, la Fille au jour
J, ce n’est donc qu’un interrègne
dont Juin est le prince ivre,
puis après certainement
tout décline et dépérit,
et pour une heure d’aise
voici bien des ténèbres,
le salaire de ce péché mortel,
la jouissance … » (Hervé Micolet, p.18-19)
Cécile Holdban caractérise, elle, « Juin réel » comme l’enfant pour « toujours », comme courant devenu directement vie, comme l’innocence réussie et affichant complet, ou la folle et brouillonne plénitude de se former une fois pour toutes :
« Courant brouillon, berges sans repos
lieu de tous les spectacles
silence, si l’on sait le surprendre
le fleuve est notre oreille
de la source à l’embouchure
il fleurit sans raison dans ses ronds d’eau
et fête juin réel :
l’enfant pour toujours » (Cécile Holdban, p.41)
Or, bien sûr, il n’existe pas d’enfant pour toujours, sinon illusoirement dans le rêve (où, en nous, ce qui n’a pas grandi tient seul les commandes) et marginalement dans l’art (où l’oeuvre fait grandir, mais hors d’elle et pour d’autres, les « percepts » et les « affects » – comme disait Deleuze – qui dépassent ceux qu’ils atteignent, et ne les instruisent que des forces qui leur survivront). Le prodigieux Juin, oui, mais pour quoi faire ? (« Juin appelle le miracle,/ mais de quel assemblage ? », p.44), et, quand la Nature se surpasse ainsi elle-même, s’adressant « réellement » à qui ? (« cette voix, c’est son aire, son heure,/ c’est la question du jour à la nuit/ de Socrate à la mort/ de la langue au silence,/ et je veille/ pour l’entendre encore,/ et je veux dans ses trilles ouvertes/ fabriquer mon armure« , p.44). Le formidable Juin, devine Cécile Holdban, ne s’adresse qu’à ce qu’il dépasse, et cet amour réussi que la vie terrestre y a pour elle-même ne peut ni soutenir ni consoler nos propres élans d’amour, tous par contraste hétéronomes, particuliers, irréversibles. D’où la mélancolie sans issue de cette supplique à la Plénitude, elle auto-suffisante, sise en tous les » visages », et toujours sûrement cyclique, de Juin :
« Parle-moi, cher silence,
puisque le monde parle,
parle-moi quand celui que j’aime ne répond pas,
parle-moi surtout quand je n’entends
que l’écho de la grande angoisse
et du vent des vieux siècles
parle-moi, quand
l’oiseau de proie qui tourne sur le pré
ni même la piéride ne me prêtent visage,
parle-moi lorsque l’arbre que je nomme
ne vient plus à ma rencontre,
que les étoiles ne rient pas,
que les enfants vieillissent
parle-moi, dis-moi vite,
car près de moi enfle une pierre,
c’est la pierre des rumeurs,
et elle devient un mal
qui ne se soulève pas, et la beauté s’y brise
et nous n’y pouvons rien » (Cécile Holdban, p.50)
Il fallait bien deux poètes pour établir Juin dans son impétueuse et un peu menaçante splendeur, et deux excellents, comme il le méritait.