Une chronique de JEAN-LUC BRETON
Santiago Montobbio, Poesía en Roma, Editions Los Libros de la Frontera, 2018
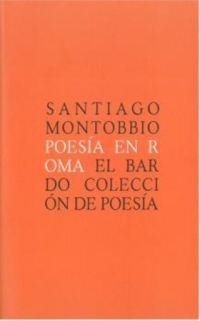
Santiago Montobbio, qui avait habitué ses lecteurs à une poésie centrée sur sa ville, Barcelone, passionnément aimée, et parfois sur des paysages de plages catalanes, évoque Rome, carnet et stylo en main. L’exotisme d’un séjour italien convient superbement à Montobbio, qui révèle dans ce recueil une joie de vivre et de créer rarement livrée de manière si lumineuse sous sa plume. Certains poèmes reprennent certains de ses motifs habituels, la nuit, le vent, les blessures, mais ces motifs sont comme balayés par la magie d’une ville éclairée, vivante, chargée d’histoire et de soleil, comme l’est évidemment aussi Barcelone pour les touristes qui la visitent, mais sans doute pas pour le promeneur solitaire qui la connaît intimement. Telle est la magie de la mise à distance. Même les lieux les moins avenants de la capitale italienne deviennent des espaces de sérénité ou de bonheur.
On le sait depuis longtemps : la magie de Rome, sa poésie, tient au fait qu’elle est pleine de ruines, qui se trouvent au cœur de la ville moderne, sous les rues ou les bâtiments, des ruines dont les matériaux ont servi de remploi pour construire des maisons ou des palais. Cette façon si particulière qu’ont les Romains de vivre parmi les matériaux antiques, une colonne dans un mur ici, ailleurs un sarcophage ou une fontaine dans une cour, est, aux yeux de Montobbio, allégorique de la création, à partir d’éléments disparates, qui se présentent pêle-mêle, sans hiérarchie, d’une forme achevée, qu’il nomme à juste titre « poème ».
Santiago Montobbio évoque à plusieurs reprises un discours séminal qu’il a fait à Paris en 1999, et dans lequel il développait l’idée que l’Europe, c’est, malgré les différences d’un pays à l’autre, le sentiment d’être partout chez soi, dans un mouvement double d’enracinement et d’envol vers le ciel (« des mains tendues jusque dans l’air »). D’où le sentiment de bien-être, l’excitation un peu fébrile qui préside à ses déambulations romaines. D’où sa recherche d’une familiarité dans l’étrangeté.
En effet, le piéton de Rome de Santiago Montobbio est un être d’habitudes, il refait peu ou prou les mêmes itinéraires, revisite les mêmes lieux, connus ou moins connus. En d’autres termes, il fait ce que font les vrais touristes, il se crée des repères dans la ville, et, puisqu’il est poète, il alimente chacun de ses passages d’images nouvelles, de réflexions qui montrent qu’il s’approprie les lieux. On a envie, en lisant ce recueil, de se précipiter à Rome et de regarder telle voûte ou tel tableau, telle taverne ou tel café, avec les poèmes de Montobbio sous les yeux, comme on le fait parfois, ou aimerait le faire, avec Montaigne, Stendhal, ou d’autres écrivains voyageurs.
Montobbio, comme nous tous, a de ces guides-là, le peintre Ramón Gaya ou les poètes Keats et Shelley, par exemple. Il cherche leurs traces, visite les lieux qu’ils fréquentèrent ou qu’ils auraient pu fréquenter, essaie d’imaginer leur vie à Rome en écrivant des poèmes au très cosmopolite café Greco ou au très britannique salon de thé Babington. Et en cela, Santiago Montobbio appréhende parfaitement ce qu’est la culture du voyage, une série de palimpsestes culturels, qui dans une certaine mesure nous empêchent de voir et de ressentir la ville avec nos yeux propres, tout en rendant plus intenses nos émotions devant les lieux qui ont résisté au temps, comme le prouvent les témoignages des écrivains du passé qui, déjà, les ont contemplés et évoqués.
Et la révélation de Rome est précisément là : visiter une telle ville, c’est la même chose qu’écrire des poèmes. La ville se livre mais retient toujours quelque chose d’elle-même, qu’on découvre lors de nouvelles visites. De même, la poésie exige le retour, la poursuite, une nouvelle évocation, un nouvel effort, pour saisir au vol un ineffable changeant. La ville a le double pouvoir d’attirer et de rejeter le visiteur, qui doit à la fois se fondre en elle (les images de pénétration sont nombreuses dans le recueil) et s’en déprendre, comme dans le cas d’une relation amoureuse trop possessive.
©JEAN-LUC BRETON

