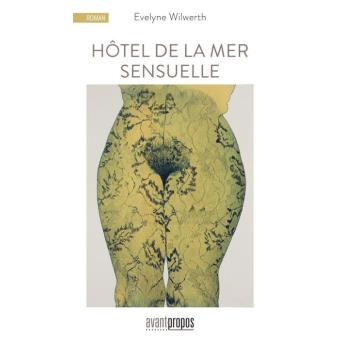Auteurs autour, de Paul Mathieu
Editions Traversées-La Croisée des chemins, 2015, 299 p., 15€
Le titre Auteurs autour, à la fois étrange et séduisant, appelle à l’esprit des images d’œuvres-clés et d’écrivains-phares. Lire, n’est-ce pas en effet faire à la fois l’expérience du confort de la connivence, de la reconnaissance, d’un partage serein avec une voix familière, et celle de l’aliénation, du voyage, de l’exotopie, pour reprendre le joli terme de Bakhtine ? Dans son ouvrage, Paul Mathieu se sert à plusieurs reprises de métaphores géographiques pour évoquer les œuvres et les univers des écrivains qui constituent ses alentours à lui, son bouillon de culture propre, les terres littéraires où il aime à aborder. Il rappelle à propos le mot d’archipel utilisé par Butor pour évoquer Joyce, et l’on pourrait ainsi dire qu’Auteurs autour est une croisière d’archipel en archipel, familiers ou bien inconnus, reconnus ou bien confidentiels, en tout cas toujours un bonheur de découverte ou de redécouverte.
L’ouvrage se présente sous la forme de vingt-et-un essais, repris de différentes revues ou inédits, sur des écrivains, de la fin du dix-neuvième siècle à nos jours. Ces textes sont répartis en deux chapitres, les « points de repère » (Andersen, Butor, Ghelderode, Joyce et Kafka) et les « voix contemporaines ». Le choix de Paul Mathieu est un choix forcément personnel (certains auteurs inspirent autant qu’ils sont inspirés), et chacun, en fonction de ses passions et de sa personnalité, pourra regretter l’absence de tel ou tel de ses maîtres à penser, de femmes, d’écrivains du Sud, d’Afrique ou d’Asie, mais c’est aussi un choix justifié, judicieux et formidablement étayé par des analyses pertinentes, et la modestie du propos est acceptée et évoquée dès le sous-titre de l’ouvrage, « Notes sur quelques voix contemporaines et au-delà ».
Les passionnés de littérature s’interrogeront évidemment sur ce qui peut bien unir Andersen et Joyce, Mandiargues et Verheggen. Et, malgré le droit à butiner de texte en genre et d’école en auteur que l’on reconnaît volontiers à Paul Mathieu, malgré l’admiration que l’on ressent pour la plasticité de sa langue, qui adopte le lyrisme un peu académique d’Ovide (auquel il rend un très bel hommage dans son essai sur Georges Thinès) comme le verbe déferlant, zigzagant, truffé de jeux de mots, de Verheggen, on a envie de suivre quelques pistes avec les auteurs choisis par Paul Mathieu.
La première, à mon sens, est celle du méandre. L’image, reprise d’Umberto Eco, est employée par Paul Mathieu dans son pertinent essai sur Joyce, parce que le parcours de l’écrivain irlandais, de Gens de Dublin à Finnegans Wake, en passant par Ulysse, est symbolique de l’invention de la modernité littéraire, depuis les récits linéaires du début, vus à travers les yeux d’un narrateur extérieur presque objectif, jusqu’à l’odyssée de l’imagination, […la] réinterprétation perpétuelle de son propre objet qu’est Finnegans Wake, ouvrage solipsiste par excellence, mais d’un solipsisme à partager, si l’on peut oser cette métaphore, pour peu que l’on accepte le méandre comme figure allégorique du tricotage et du détricotage à l’œuvre dans l’écriture. Méandre aussi que la poésie bucolique qui explore et commente le monde à partir des quelques dizaines de kilomètres de la Maye chez Jacques Darras, les je successifs de Jude Stéfan, le lyrisme rocailleux de Verheggen ou encore celui des acrobaties lexicales de Marcel Béalu, qui constituent un art poétique.
Béalu, mais aussi André Schmitz ou Luc Bérimont, plaisent à Paul Mathieu à cause de l’ancrage de leurs textes dans des objets du quotidien, des choses anodines, parfois surannées, souvent dérisoires. En lisant les essais qui leur sont consacrés, on repense aux analyses splendides de Paul Mathieu sur Andersen, dont l’art consiste à nous donner l’illusion de la spontanéité. Les héros d’Andersen, Paul Mathieu nous le rappelle, ne font pour ainsi dire rien, voire ne sont pas des héros (L’innovation principale de l’auteur ne provient-elle pas de l’utilisation des objets (et des animaux)?), qui semblent nous parler et nous accompagner dans l’extraction d’une morale existentielle. Cette idée que le héros ne f[ait] pour ainsi dire rien est celle qui irrigue les œuvres de Kafka et de Joyce citées ici, mais aussi tant d’autres textes de la littérature contemporaine et au-delà, puisqu’on pense aussi, par exemple, à Emma Bovary, au prince Muichkine ou à Oblomov.
Une autre piste, avec laquelle Paul Mathieu joue de manière récurrente, est la question de la belgitude. L’essai sur Hubert Juin la traite de manière approfondie, et Paul Mathieu y fait sienne la question rhétorique de Joseph Duhamel : Une histoire de la littérature belge est-elle possible ?, avant de donner deux éléments de réponse : sont « belges » le surréalisme et l’incessant questionnement sur [soi]-même. Le surréalisme, avec sa fascination pour les objets anodins détournés de leur sens et son goût pour les assemblages hétéroclites, est de toute évidence un élément qui unit un grand nombre des auteurs de ce volume, puisque la poésie qui plaît à Paul Mathieu est celle qui questionne sans cesse les mots dans leur forme et dans leur sens, qui fait jouer étymologie, homonymies et intention de signification, amène ce qu’il nomme avec pertinence une descente en marche du train-train sémiotique dans le texte consacré à Verheggen, le post-surréaliste goguenard par excellence. Quant à l’incessant questionnement sur soi-même, il est à peine étonnant que cette belgitude-là s’aventure à passer la Haine (pour reprendre le très beau titre de Rose-Marie François) et à annexer le Ponthieu aquatique et mouillé de Jacques Darras et même le Canada de Guy Jean, en passant par Copenhague, Dublin et Prague.
Ce questionnement sur soi-même, cet effort incessant de donner forme littéraire à des émotions, sont peut-être ce qui unit le plus profondément les convives de Paul Mathieu. Il n’y a pas de repus de la littérature et de gens satisfaits d’eux-mêmes parmi les auteurs dont il s’entoure, et c’est tant mieux pour ses lecteurs.
©Jean-Luc Breton
 Myriam Eck, « Mains suivi de Sonder le vide », Editions « p. i. sage intérieur, 3,14 de poésie », Dijon, 8 euros, 2015.
Myriam Eck, « Mains suivi de Sonder le vide », Editions « p. i. sage intérieur, 3,14 de poésie », Dijon, 8 euros, 2015.