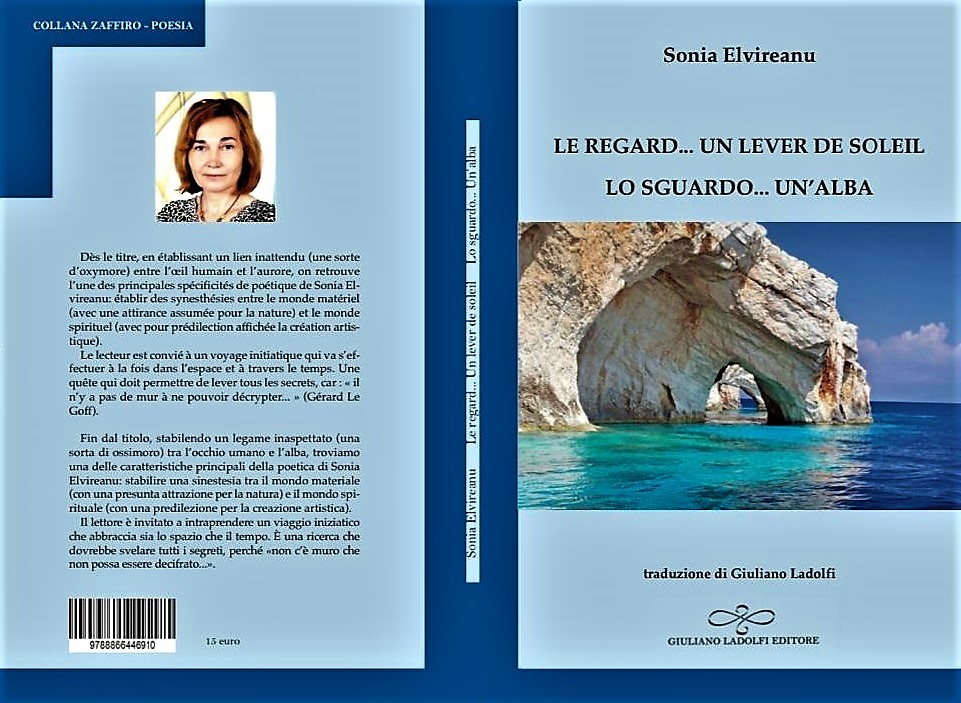Une chronique de Marc Wetzel

Pierluigi CAPPELLO, Allez le dire à l’empereur (Mandate a dire all’ imperatore), poèmes traduits de l’italien par Giovanni Angelini. Préface de Gian Mario Villalta. Edition bilingue. L’ours de granit, janvier 2024, 144 p., 15€
Le pur lyrisme de Pierluigi Cappello (1967-2017) est certes sans illusions sur lui-même, car – dit le poème éponyme (p.21) – le lyrisme ne prétend ni nourrir son homme ( Quand « tous les puits sont asséchés« , « dirigez vos proues vers la sécheresse » !), ni guider quiconque hors de lui-même (« Vous foulerez de très vastes chemins/ vastes à ne plus avoir de directions« ), ni nous épargner le grotesque ou le tragique des adaptations nécessaires (« Vous accorderez votre dureté à la dureté du scorpion/ à la rumination du chameau/ à la fibre de chaque racine …« ), mais il est sa ligne de vie : ligne tracée non sur, mais par, sa main.
Le pur lyrisme est, de nos jours, devenu denrée rare – et pourtant notre appétit reste vif pour ce que savent les coeurs d’exception. Le lyrisme, c’est, intuitivement, la première personne de l’enchantement : quelqu’un chante avec cette drôle de chose qu’est un coeur humain, et, tout de suite, le coeur des choses sait ou saura quoi en faire. En tout cas, tous aussitôt sont concernés et nul ne se satisfait plus de rester seul : un chant à boire convainc aussi les sobres, un chant de banquet ravit aussi les mendiants de la rue, un chant d’amour au loin console le célibataire qui passait. La « magie » lyrique est toute simple et résiste aux lazzis des bons et sérieux esprits : une âme monte à l’étage des sans-âmes, et leur fait (pour leur plus grande joie !) soudain honte. Voilà ce qui se passe : une nuée verbale traversant un front nous emporte et nous engage. Qui bouderait alors son plaisir se moque de la vie.
Pierluigi Cappello est donc un pur lyrique, et sa vie l’en excuse (né à Chiusaforte dans le Frioul en 1967, le fameux tremblement de terre de mai 1976 condamne sa famille à des années de campement forcé; un accident de moto – qui tue son pilote – brise en morceaux son passager de 16 ans, et notre poète ne connaîtra jusqu’à la mort que le fauteuil roulant ; il meurt littéralement de fatigue à 50 ans, épuisé par ses propres efforts de survie …). Sa poésie, précoce et précise, est exemplaire (l’exemplaire, c’est l’exceptionnel qui aide les autres à être quelconques !) et juste (elle fait comprendre ce dont elle donne le sentiment), comme quatre passages le diront tout de suite et mieux – évoquant, respectivement, la stupéfaction, la fidélité, le désespoir, le veuvage :
« Par ici on a vu le lynx, moi aussi je l’ai vu
il y a des années, au coeur de la nuit,
tout près d’un entrepôt des munitions.
Je cherchais Sirius pour me rapprocher du ciel et j’ai trouvé le lynx,
derrière moi, avec ses yeux de mère en colère.
C’était comme si le néant
avait laissé une faille et il était apparu
comme l’image d’un livre d’école
la bête était là, à deux pas
et j’ai oublié la splendeur des étoiles » (p.53)
« J’ai rassemblé vos voix dans mon souvenir
et je suis là où je peux penser à vous, tous, dans vos jours de froid
qui montaient de la neige piétinée, dans la mémoire, la mienne,
dans le dévouement à la vie qui passait d’heure en heure
de mois en mois plus rapide et sans importance
comme des adresses écrites à la va-vite, des noms sitôt oubliés … » (p.51)
« À l’ouest, un cargo a sa quille ensablée
et le sable n’a pas de nom
un quelconque marin de Tyr
s’est allongé sur les lattes du pont
les yeux grands ouverts, la rétine brûlée
et le soleil est sans pitié » (p.107)
« Depuis qu’elle n’est plus là
la maison est devenue plus vaste
lui, il reste avec sa douleur dans la télé allumée
les miettes sur la table les soirs quand elle était là
la cigarette éteinte dans un verre » (p.47)
La figure paternelle, qui bouleverse, figure de la confiance en lui-même acquise du conatus, est bien davantage ici que l’ordinaire girouette (même loyale et pertinente) des vents bons et mauvais de l’affectivité. Elle est ce dont toute vie consciente et libre rêve, assurant la valeur de présence de toutes les participations (celles qui m’y intègrent comme celles qui m’en excluent) au monde commun. Le père est toujours et partout ce qu’on sait pouvoir accepter ou devoir refuser de la vie, depuis sa souveraineté souriante. Père qui est la belle et bonne horloge des initiatives et des retraits, même quand lui-même ne sait plus l’heure :
« Hier, je suis passé te voir, papa,
ces jours-ci la lumière n’est pas coupée par l’ombre
dans les arbres, sans vent, il y a l’odeur sèche de l’air
j’espère t’apporter le récit des orages,
l’odeur de l’hiver sur les tempes
à Chiusaforte il a neigé, il neige toujours
et les fontaines sont figées dans la glace
je pense par moments que tu es encore là-haut
à ranger les bûches avec soin,
et non pas dans ces lieux,
la maison de retraite et son terrain de boules
où vous vous retrouvez comme des feuilles dans le parc
unis dans l’attente, loin des villes assiégées.
Vous disiez demain, vous disiez voici mon fils
(Dicevate domani, dicevate questo è il figlio)
et avec le silence du sifflement dans la tourmente
vos noms s’en sont allés
vous qui avez été peuple et ombre
rémission et force … » (p.29)
Il y a dans ce recueil un chef d’oeuvre (« De pauvres mots », p.39 … – qu’on peut d’ailleurs voir et entendre sur Internet (*) notre poète primé réciter en public, en septembre 2013, cloué sur son fauteuil, bonnet académique sur la tête, pour sa lectio magistralis, entouré de pairs émus et complices) – poème qui raconte, un par un, des individus – proches compris ou inconnus devinés – à même leur vie : chacun admirablement caractérisé dans un destin qu’il croit unique, un incident de vie qu’il ignore mérité, une routine qu’il espère libre : l’humour noir involontaire, l’empathie malicieuse, le désespoir laborieux …, tout sonne juste :
» L’une donne un coup de pied à un chat/ et y perd sa pantoufle »
» L’un empoigne la tronçonneuse/ et il sent la sciure et les étoiles«
» L’une est très bossue/ et trouve toujours des pièces dans la rue«
» L’un tombe d’un vélo attaché/ et quand il se relève il a la manche de la veste déchirée/ et il essaie de nous poursuivre«
» L’une écrit sur le papier d’emballage du charcutier/ j’en ai marre de ce monde-ci, je vais voir l’autre au-delà «
Quelques poèmes d’ardente tendresse (« Dédicace à qui sait », p.77-97) commentent à voix ténue une rencontre parfaite : il y a quelqu’un(e) dont on veut mériter les mots d’amour; dont on ne se plaindra jamais d’être connu; qu’on devient ambidextre à caresser ; dont le prénom se dit mieux dans notre bouche que dans la sienne; qui a le coeur dont on est fier d’avoir besoin etc. , et le bien est tout ce qui justifie de l’aimer :
« Avec toi, je confonds ma gauche et ma droite » (p.83)
« Entre le plaisir et ce qui reste du plaisir/ mon corps est comme un lieu où l’on pleure/ parce qu’il n’y a personne » (p.95)
« Écrire comme tu sais oublier,/ écrire et oublier./ Avoir le monde entier dans la paume de sa main/ et puis souffler » (p.97)
Enfin le long poème (« La route de la soif », fin du recueil) semble résumer la caravane d’efforts d’une vie – comme si celle-ci notait les attendus de son propre Jugement. C’est comme un « Voici tout ce qui m’aura mené », que le poète confie au seul Saint-Pierre qu’il est sûr de rencontrer, au seul secrétaire d’existence fiable et attentif que les parages de la mort lui réservent : lui-même. Et qu’importe si ce Saint-Pierre meurt lui-même, et que le jeu de clés du Ciel est purement verbal, puisqu’avec lui, disparaîtra tout autant ce que ses proches ont permis que ce que le malheur lui aura appris. Leçons lentes, bien dites et partagées : l’adaptation à ce qui durerait toujours est absurde; la solitude ne cède qu’au sommeil, au coma, au délire; l’enfant en nous écartera jusqu’au bout, résolument, l’adulte qui affirme mourir; une mère seule peut bénir notre attachement à la vie, et, par suite, nous en délier assez et légitimement. On ne peut en citer ici qu’un bref passage :
» L’emprise qu’ont sur nous nos gestes les plus coutumiers
est impossible à décrire et à séparer de nous-mêmes.
Je ne peux que parler de ses cheveux qui avaient la consistance de la lumière
si fins, si longs, ils faisaient corps avec l’air et je peux dire la ligne
de ses bras qui épousaient ses hanches avec la douceur
d’un souffle sur un miroir d’eau ou de la couleur turquoise
étrange de son regard, couleur que seuls les enfants
sont capables d’imaginer s’ils n’ont jamais vu la mer … » (p.135) (**)
© Marc Wetzel
** remerciements à l’excellent Yann Granjon – de la librairie Sauramps-Comédie de Montpellier -, auquel je dois, après bien d’autres découvertes, d’avoir connu l’existence de cet auteur.
—