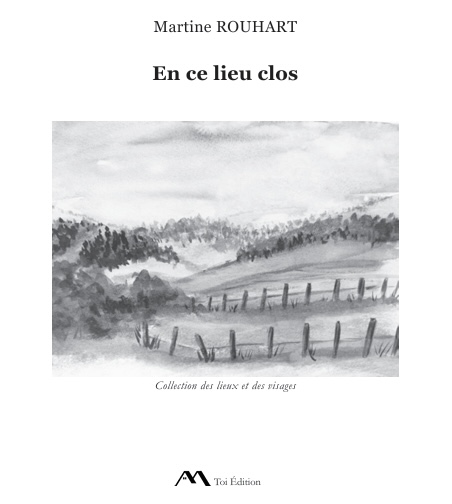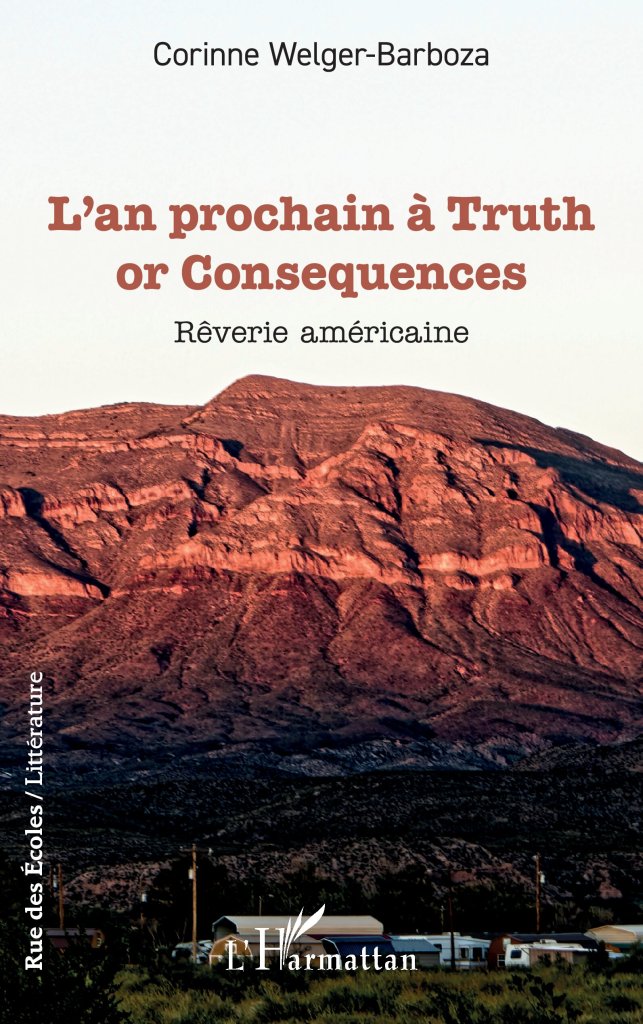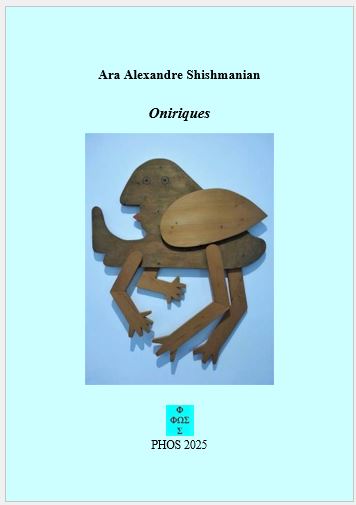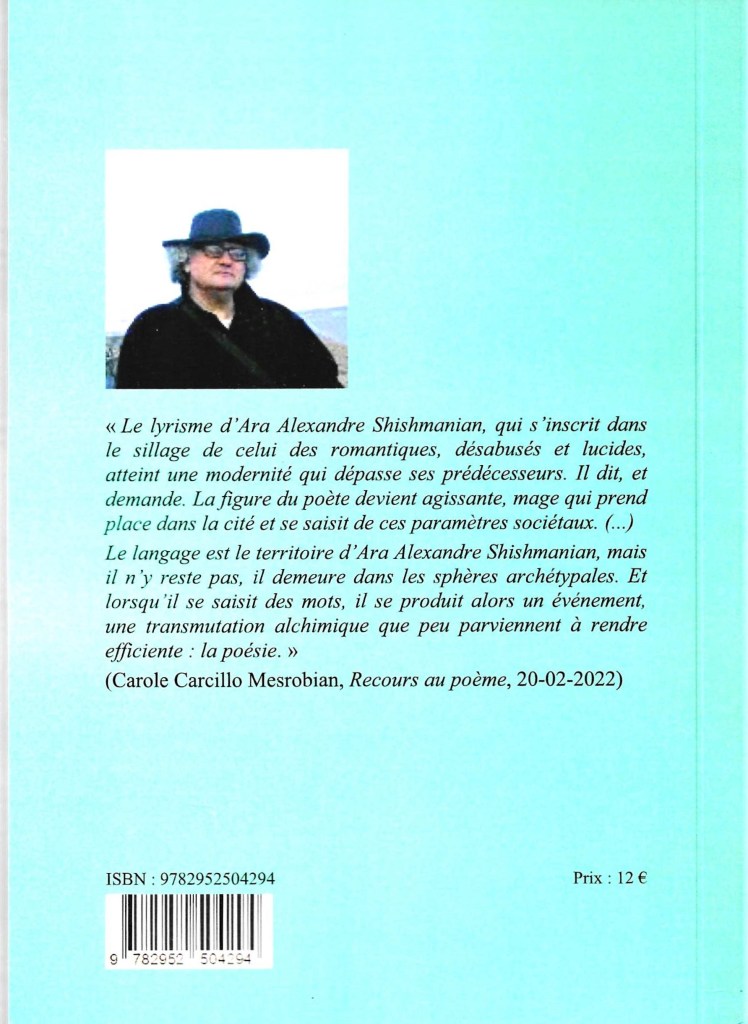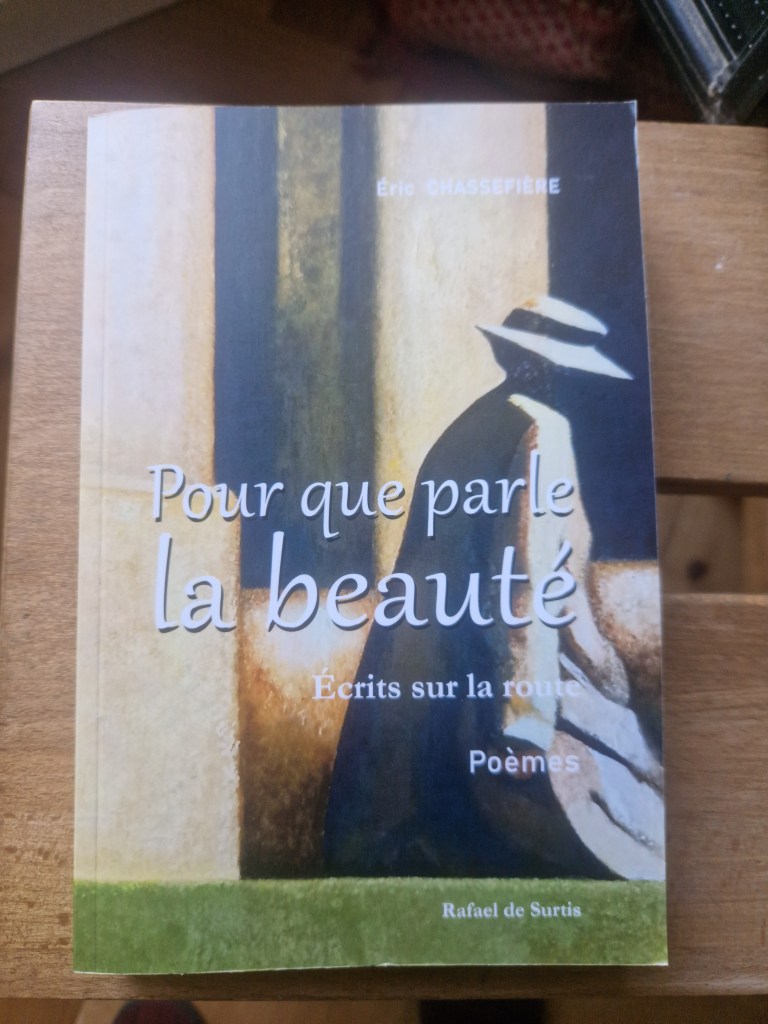Une chronique de Michel Joiret
En ce lieu clos…
Les postures d’éveil de Martine Rouhart
L’écriture imposerait-elle sa propre dictée de l’inconscient ? Son propre vocabulaire ? En peut restituer un lieu ou déterminer un moment choisi (comme « en hiver », « en 1982 »), exprimer une origine ou une durée (« j’en viens », « j’apprends en trois jours »), remplacer une quantité ou un élément précédé de « de » (« j’en veux », « j’en ai peur »), et servir de préfixe verbal pour composer de nouveaux mots.
L’adjectif « clos » peut désigner un terrain fermé et cultivé (comme une vigne), le participe passé du verbe clore (qui signifie fermé, terminé), ou apparaître dans des expressions telles que « à huis clos » (en privé) ou « clos de murs » (entouré de murs). Le mot est un emprunt « au latin médiéval clausum, qui signifiait « espace clos ».
« Clos » s’accommode volontiers de la pérennité… et préserve le visiteur de l’intrusion, du hasard, voire de « l’accidentel ». En l’occurrence, « Le lieu clos » ne rend pas seulement la « mesure objective » des éléments qui le composent mais s’inscrit d’évidence parmi les « innombrables pays intérieurs » de sa visiteuse.
L’écriture s’apparente ici (se risque ?) à un lent et minutieux chemin de ronde. Gauchie par le silence et l’observation, elle prend la mesure des lieux en leur adjoignant tour à tour une présence rituelle ; et tout en alignant d’authentiques « griffures » de la pensée, elle détaille ici et là l’empire naissant du jour recomposé.
Dès lors, l’auteure optera pour l’exacte mesure de sa prudente avancée : « Un jardin/clos de murs/où il fait bon/s’évader.
L’environnement fraîchement réanimé, comme « découvert » détermine sa progression muette et la ramène irrépressiblement aux « innombrables pays intérieurs » qui vont paramétrer la journée.
La posture d’éveil la sollicite d’entrée de jeu et lui dicte une écriture nourrie de partage, de mémoire et d’une sorte de prudence affective… De fait, un « nouveau temps se précise » dont l’auteure ne sait rien sinon qu’il s’écrira entre nature et nature intérieure. Les griffures sensibles, peu à peu observées et ramenées au discours, prennent alors tout leur sens dès lors que la découverte des « lieux clos » prendra l’exacte mesure de la journée à vivre.
D’évidence, la « maison d’âme posée à l’ombre/d’un tilleul » entretient à sa manière un orchestre de « petits bruits » et s’accorde aux herbes, les branches, les oiseaux : « On sait que les arbres/écoutent nos rêves ».
Et on découvre au fil des pages que l’auteure éveillée « dans une chambre/éclairée/de poésie » accordera sa vigilance au double éveil de la nature et de sa nature intérieure. Plus explicitement, la «résurgence » des mots secrets retrouvera les essences du petit matin « un parfum de chèvrefeuille, une image de clarté ».
Consciente des « limites qui se rapprochent » et forte des signes récurrents que lui adresse l’entame du jour, Martine Rouhart consulte « des mots/pour boussole » : une procédure singulière certes, mais aussi une incursion décisive de la ligne poétique dans l’attente du prochain.
Le lecteur entreprend alors de détailler (comme un nouvel accessit), le micro-univers du jour apparu et auquel il est conféré une sorte d’identité passagère.
Pour faire de ses impressions contrastées un inventaire textuel, l’analyste-poète recourt à une langue « minimale » et « naturelle » susceptible d’accueillir chacun dans ses propres jardins et d’en approcher le mystère.
Martine Rouhart aurait-elle investi son « lieu clos » à seule fin d’exister à ses propres yeux ? Ou de retarder autant qu’il est possible l’inéluctable menace des portes qui s’ouvrent à l’entame de la journée qui vient ?
En ce lieu clos suggère, à n’en point douter, de prochains développements. D’aucuns parleront d’une « conscience éveillée » ou d’un « silence habité »… Et l’auteure renverra le quidam à ses propres alertes.
Le lecteur ne manquera pas d’explorer le mode singulier de la « pensée nomade » qui s’affrète aux mouillures du petit jour (et qui relève chez Martine Rouhart d’une aspiration à l’imaginaire, insistante). Il appréciera dès lors la part d’identité dont elle assure expressément le crédit :
« Le poème est mon refuge » (le propos mâtiné d’hésitation, d’attentes inexprimées, de petites peurs induites et d’un évident souci d’absolu « Je règne/sur une demeure/aux parois de verre/reflétant le ciel ».
©Michel Joiret
- Martine Rouhart, En ce lieu clos, poèmes, M Toi Edition, septembre 2025, Villematier.