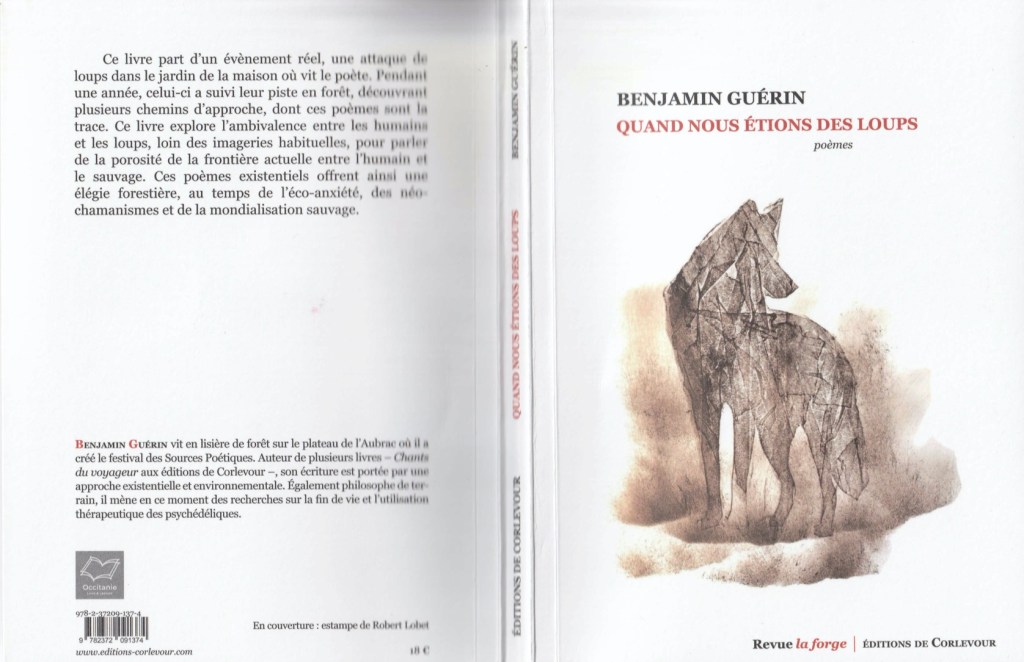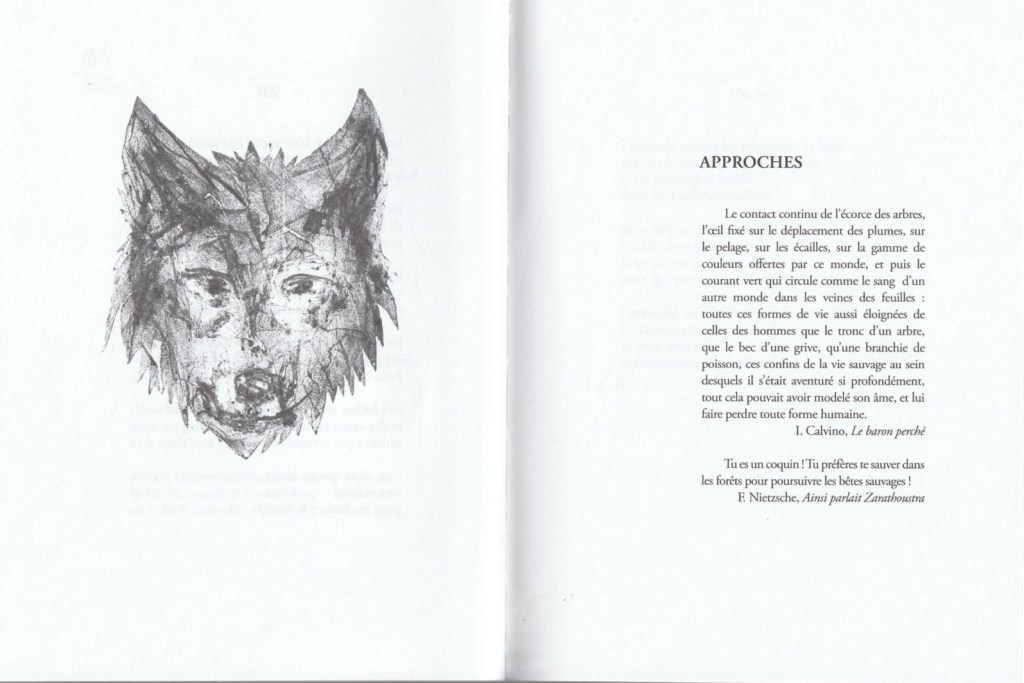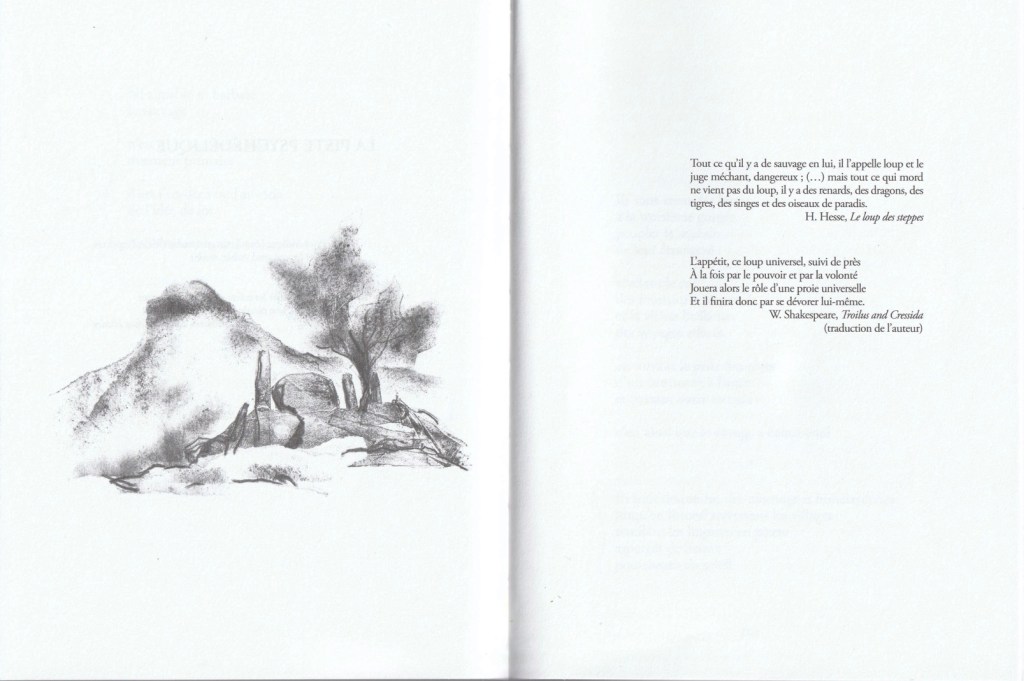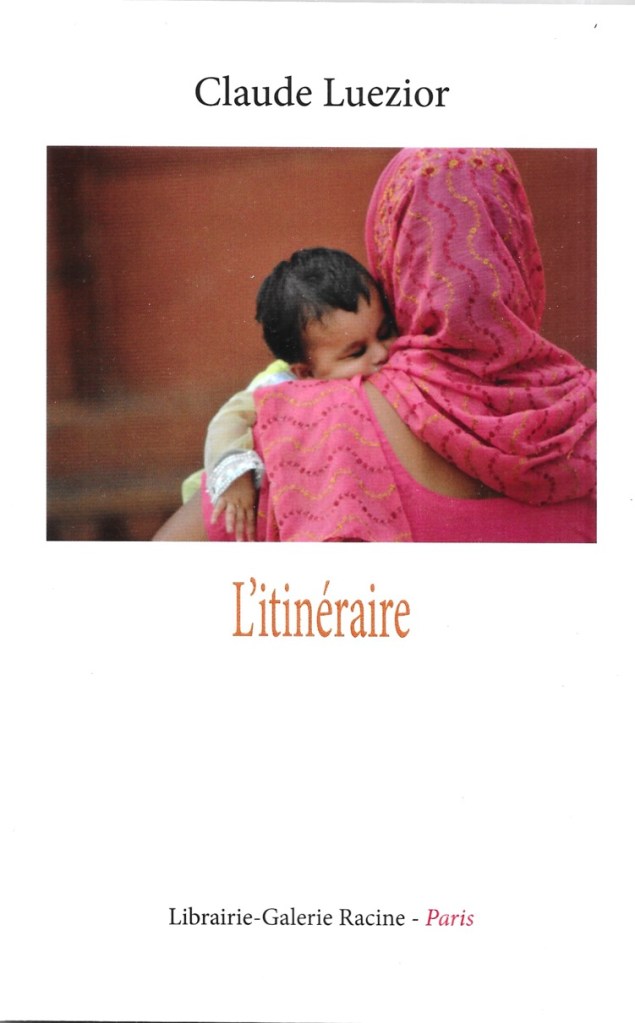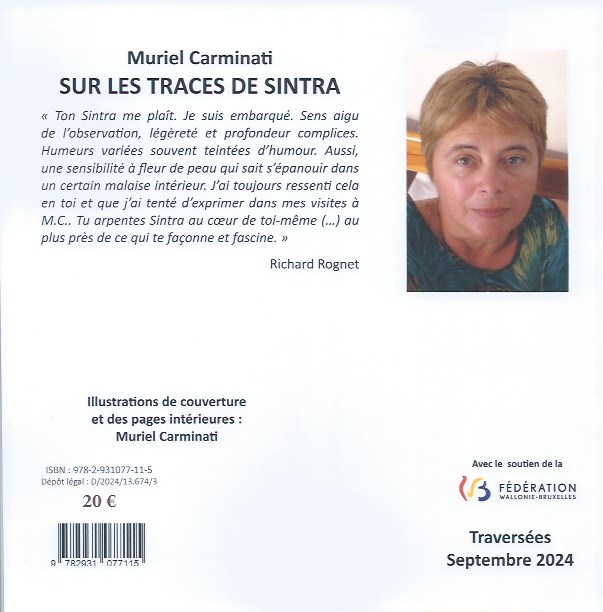Une chronique de Marc Wetzel
Benjamin GUÉRIN, Quand nous étions des loups (poèmes), estampes de Robert Lobet, Editions de Corlevour, septembre 2024, 144 pages, 18 €
Ce poète de 40 ans vit en lisière de l’Aubrac, potier au pays de Peyre, et nous raconte d’abord les deux brebis récemment prélevées, dans son paisible jardin – là même où le jour ses enfants « vont et viennent » ! – en bordure de forêt, en pleine nuit, par des loups (dont il connaît les empreintes, reconstitue l’approche si prudente et déterminée jusqu’à leurs proies endormies, suit la trace, piste très avant et très haut le victorieux festin – ramasse les os « nettoyés à blanc » par de logiques rapaces, restes qu’il revient chez lui enfouir). Voici la situation :
« Le cri de mes enfants envahit la terre
et je porte une fois encore
la mort entre mes mains
pays de sang
pays de froid
pays de mort
j’y ai enterré tellement de monde
que je ne sais plus
les os se mélangent à présent
ils sortent de la fosse que j’ai creusée dans mon jardin
il me semble même qu’ils pourraient marcher
et ramper jusqu’à moi
les loups sont à ma porte
ils grattent le soir
ils sont dehors
ils sont dedans
et je m’enferme
j’engouffre tout mon temps
dans des grilles de fer
et j’attends
j’attends que progresse
le temps des hommes
et le temps cruel
le temps
de l’anthropocène » (p.16-17)
Le loup, on le sait, est le grand discret de nos massifs – comme un plus gros renard sans ses zigzags, un chien qui hurle sans aboyer jamais (car dès qu’il n’y a « plus rien à crier », sa gueule arrête les frais, p.84), aux crottes poilues, comme disent les manuels, dont la blancheur sent fort, ascétique (ne dormant qu’à même le sol, pourvu qu’il soit caché dans de la verdure dense), nomade (se déplaçant trop pour s’offrir terriers – juste bons pour blaireaux et putois …), farouche et intrépide (ne sondant ni les murs, ni même les cavités rocheuses pour, lui, s’y lover et frotter, et dédaigneux de tout lieu où se percher). Et ce qui arrive au loup du recueil (au loup qui signe ce recueil), c’est peut-être du Kafka à l’envers : un loup se métamorphoserait en homme, et il n’aimerait d’abord pas trop ça. Et nous, sa meute ignare et vile, nous feignons de n’avoir rien vu. On lui laisse sa chance : tant qu’il peut continuer à avancer à peu près, on le laisse à ses baroques essayages généalogiques, son travestissement trans-spécifique, derrière son mince paravent de mots. Il est là, « tenant ses maigres postures de dignité » (p.83). Secrètement, on compte alors sur lui, sur sa sorte de destin expérimental, pour nous dire la nue vérité que voici : bien sûr, nous sommes au moins des loups, tous, des prédateurs universels (et, malheureusement, souverains !) organisés, malins (nos « lois » et « incendies » vont ensemble, dit le texte, pour pouvoir clôturer ce que nous défrichons, et dévaster ce que nous excluons). Nous massacrons urbi et orbi, mais en nous cachant la mort (que nous donnons) « derrière nos emballages », gibiers en barquettes et cylindrées de thon – nous omettons seulement, comme loups désormais amnésiques, « d’assumer le prix de tuer ».

L’idée du poète semble celle-ci : les humains sont, comme les loups, éternels voyageurs, tueurs indépendants et privilégiés sans vrais prédateurs. À ce titre, ils ont, comme les loups (même si les loups se cachent plutôt dans la nature, et les hommes de la nature), un statut un peu à part dans la vie terrestre, celui d’étrangers. L’homme, considérant la place de la culture (des langues, des institutions, des oeuvres, des technologies) dans la nature, ne peut que s’y constater tel. Mais quel étranger est donc le loup dans la nature ? Un rôdeur discret, respectueux de ce qui ne le regarde pas, qui ne songe nullement à exporter son modèle de horde, qui ne juge – ni ne s’attarde dans ! – les milieux aux antipodes du sien ( on en voit peu se prélasser « sur un échangeur autoroutier », p.62), bref un « alien » sans empire, vanité ni plan de carrière : un étranger sobre, furtif, qui se satisfait d’un permis de séjour implicite dans le monde terrestre, n’y joue pas à l’ange, n’exagère jamais sa dîme, – pour résumer : le loup sait être autre. L’homme est exactement l’étranger contraire : bruyant, intempestif, violant ses hôtes, bordélique, prolixe, aliénant, et que ni sa science (même éthologique !) ni son érudition (même désintéressée et bon enfant) ni sa charité (toute spirituelle ?) n’auront su rendre tolérant, réellement polyglotte ni modeste. Bien sûr, le loup n’est pas non plus un étranger prévenant- mais lui, en tout cas, ne prétend pas faire la leçon à ce qui lui échappe ! L’intuition de Benjamin Guérin est alors ceci : cessons, au moins et d’abord, d’être de mauvais étrangers dans la nature. Trois moyens ou remèdes. Soyons d’abord beaux joueurs dans la mort, comme le sont les bêtes :
« Chancelant de ne plus savoir
attraper les oiseaux du regard
je laisserai ma peau à la forêt
il y aura juste un peu de sang
et quelques histoires
pour habiller l’univers
un mausolée de pierres
un tas de cailloux
où pisseront les loups
ce sera simple et je mourrai
les paupières rongées par les insectes
pleines encore de tout le paysage
et ouvertes à l’horizon sauvage » (p.63)
Ensuite, que notre Histoire ne fasse pas tant d’histoires ! Entendons par exemple les loups « hurler » de rire devant nos avancées civilisationnelles :
« Ils ont ri
en nous voyant piller la mer
assécher la terre et raser les bois
ils se sont roulés par terre
en nous voyant remâcher le monde
affaisser les côtes et racler les montagnes
ils ont ri tous ensemble
et de toutes leurs dents
sur la folie des hommes
ceux qui persistent à vivre
en ramassant le sable
jusque dans la mer
même en plein soleil
pour napper de béton
des maisons trop chaudes
que le sel rongera » (p.116)
Enfin, quelle « langue commune » forger, de toutes pièces, du sein de notre culture, pour, loups et nous, c’est-à-dire natifs de vie et natifs de raison, nous ré-entendre, c’est-à-dire, non (vainement !) nous comprendre à égalité, mais bien pour patiemment et paisiblement renaturaliser notre compréhension même ? Magnifique et subtil pari – que la raison puisse réussir sa symbiose en retour d’avec la vie !! – évoqué dans la fin du premier grand poème : « Anthropocène » :
« Nous abolirons la nature
et nous cesserons
de nous opposer à elle
nous serons la nature
nous serons la forêt
nous partirons en friche
et notre coeur s’ouvrira
sur le monde et la vie
nous déposerons nos papiers glacés
nos publicités et nos dessins animés
cessant de nous émerveiller
devant l’étrangeté
nous deviendrons enfin
nous-même l’étranger
nous réapprendrons à vivre
nous nous ferons férals
nous serons sauvages
nous lirons les pistes
comme des panneaux routiers
et nous saurons où trouver l’eau
la nourriture et notre tranquillité
et quand nos mots seront trop longs
pour arrêter le présent
nous goûterons le temps
infini des arbres
des chevreuils et des martres
des grillons et des faunes
et je me demande
quelle sera la langue
du commun entre nous
du commun entre tout
et peut-être pourrons-nous
enfin apprendre
la langue des loups ? » (p.29-30)
Bien sûr, immense est la difficulté, redoutables sont les pièges (logiques, et anthropologiques !). Un autoportrait du sauvage, n’est-ce pas contradictoire ? Si la « Nature » ne peut certes plus être un simple « environnement » corvéable, ni même un simple équipement natif désormais incapable de se débrouiller (se reproduire, s’entretenir, se réguler) seul, quel guidage conscient cet immense Essor jusqu’ici responsable de lui-même peut-il pourtant fournir ? Comment sérieusement rompre (pour les beaux « yeux parfumés » des loups !) avec nos « prairies efficaces », nos « bassins disproportionnés », ou même nos « forêts virtuelles libres de tout barbelé » ? Et la moderne nouveauté perpétuelle, qui nous condamne à en être les épuisés émigrants, permettra-t-elle cette remigration intérieure, essentielle, salutaire que notre poète devine et prône ? Sommes-nous encore capables d’à nouveau plonger …
« … dans la vie comme on plonge
follement dans l’abîme
avec les sirènes » (p.39) ?
Le recueil se termine sur un texte extraordinaire (« La piste psychédélique« ), qui paraît prêt à recourir aux paradis artificiels pour pister mieux les loups que « nous étions », ou nous donner l’audace de, de les redevenir d’une manière responsable. Pourquoi « psychédélique » ? C’est peut-être qu’il y faut une âme, comme on ne se doutait pas en détenir une, pour – le cerveau biochimiquement sommé d’y travailler ! – lui faire manifester ses parentés enfouies, retrouver ses ruades natives. Métaphysiquement, le cerveau humain est comme une surveillance intime (en partie rationnelle) du cours cohérent de notre corps, comme la vie elle-même (l’existence organique) l’est, peut-être – auto-espionne locale, et piste enregistreuse d’elle-même ! – au sein de la Nature totale. Mais nul besoin de stupéfiants en réalité, car une vigilance transfiguratrice y suffit, une attention enfin étrangère (« quand se pratiquent/ par-delà la conscience/ les sévices rances/ de la torture blanche« , p. 122) que la poésie de ce profond et très étonnant auteur fait naître pour nous, à l’école – sans mots, sans estrade, sans diplôme ni blâme – des loups :
« les loups sont venus
nous ouvrir les yeux
à coup de canines » (p.113)
en
« pénétrant l’étoile
jusqu’à la glande
au centre précis
de notre crâne
le lieu de nos résonances
sous les coulées d’hormones
sous les marées d’effroi » (p.118)
et en
« suivant la piste
qui ouvre la conscience
à même la chair » (p.139)
Benjamin Guérin pratique décidément une drôle de chasse : la chasse au loup qu’il est (ou était, ou sera). Il poursuit l’animalité en lui, non pour la tuer (personne n’a jamais rien trouvé à manger dans un loup !), mais pour la pister au mieux. Ce qui atteste d’une sorte de pourchassement intérieur, une battue cérébrale – oui, un baroque « Loup y es-tu ? » lancé dans son propre labyrinthe – et si ce cheminement reste obscur et mal situable, il est pourtant entier, décisif, humble (aucun loup n’a temps ni loisir de jouer les Narcisse !) et fier. Guérin y suit en mots une piste de vie, normalement ambivalente (toute piste trahit ce qu’on y poursuit, mais oriente ses poursuivants), mais de vocation libre : déjà une piste de danse, de cirque ou même de ski (au contraire d’une piste d’aérodrome !) s’ouvre sous ses usagers, change et se remodèle avec eux. A fortiori la piste, en nous rouverte, des loups.