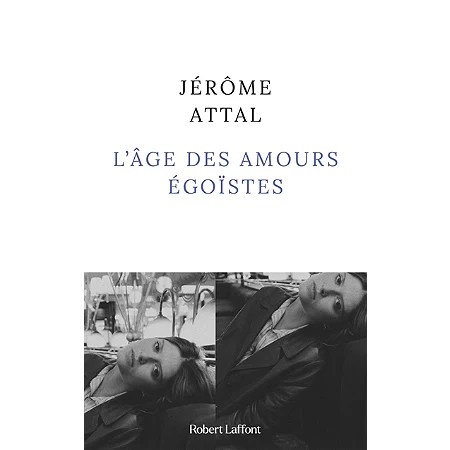Une chronique de Nadine Doyen
Jérôme Attal, L’âge des amours égoïstes, Robert Laffont, ( 19€- 221 pages), novembre 2021.
Si Jérôme Attal a déclaré son amour pour la capitale londonienne, il n’hésite pas à mettre Paris (qu’il connaît comme sa poche), au coeur de ses livres.
Rappelons :
– 37, étoiles filantes où il nous fait déambuler dans le Paris des années 1937, en particulier dans le Montparnasse mythique, en compagnie de Giacometti.
&
– un livre jeunesse : Duncan et la petite tour Eiffel, au Label de la forêt.
Ici, Jérôme Attal revisite ses années estudiantines en mettant en scène Nico, son alter ego, semble-t-il. À cet âge « égoïste », (25 ans), «moment bâtard de l’existence », pas facile de concilier travail, amour, musique, vie en groupe, sorties nocturnes.
Une vie chaotique, comme « en état de survie »,« au bord du précipice ».
La tête de chou trouvée sur une tombe, lui faisant penser à Gainsbourg, (figure tutélaire pour un musicien), va lui servir de talisman, de confidente, « de mascotte » à son désarroi. Elle est une réplique en résine de la sculptrice Claude Lalanne.
Il ne la quittera plus, la trimballant dans un sac « Herschel ». Il pourra dialoguer avec elle, « sur la table des soucis, le couvert est mis pour deux ».
Lui portera-t-elle chance dans sa quête d’amour, lui permettra-t-elle de voir percer son groupe « Peggy Sage », séduira-t-elle le professeur monsieur Fabis, lors de la soutenance de son mémoire ? Mais c’est à Laura, cette fille charismatique, qui l’a chamboulé, qu’il voudrait offrir ce présent ! Leur liaison est plutôt en pointillé, Laura aime trop sa liberté. Des moments suspendus, certes, mais frustrants pour Nico qui est conscient de ces « liens lâches », guère satisfaisants, puisque pas exclusifs ! En mémoire ses « baisers voraces comme des plantes carnivores ».
Mais n’y a-t-il de vrai au monde que de déraisonner d’amour, pour Musset ?
Par alternance, on assiste aux répétitions de son groupe, à ses rencontres pleines de sensualité avec Laura, hélas éphémères. « L’amour est une obsession » pour Bacon !
On le suit dans ses errances dans les rues de Paris, sur le Pont des Arts, dans ses soirées au Bus Palladium ( dont la disparition doit raviver ses souvenirs) avant de retrouver la solitude de son appartement. On s’arrête avec lui devant la statue de Valentine Visconti dans le jardin du Luxembourg.
On le suit aussi en Normandie lors de ses vacances en famille où il fait le constat de l’érosion du sol ( affaissement, glissement de terrain). Voir les maisons vouées à « une demolition party » lui inspire une chanson à caractère plus universel autour de la situation de la planète, tirant la sonnette d’alarme, tels les collapsologues.
Enfin, on l’accompagne dans ses visites à son père, atteint de syllogomanie !
Ayant une formation en Histoire de l’Art, il nous offre une immersion dans l’oeuvre de Bacon, sujet de son mémoire de maîtrise pour lequel il a fait moult recherches, a échafaudé d’étranges rapprochements avec les toiles d’autres peintres!
On l’accompagne à l’expo Bacon dont il détaille les tableaux qui ont retenu son attention, les rapprochant de ceux de Van Gogh, de Gauguin dont « Le Jambon ».
Occasion de prendre en considération ce poste ingrat du personnel chargé de surveiller les tableaux, « condamné à l’immobilité d’une salle à l’autre ». Ce qui rappelle le roman de David Foenkinos «Vers la beauté » !
Il reste au lecteur à consulter le net et à s’attarder sur tous les tableaux que l’étudiant en art évoque avec beaucoup de précisions.
Lors de la soutenance, le jeune homme nous bluffe d’ailleurs par ses réparties alors que son maître pointe des failles, des oublis ( cf Soutine) !
Jérôme Attal, se complaît dans les jeux de mots. Au lieu de Francis Bacon, pourquoi pas «Francis Trout ou Francis fish », avance son professeur.
On se surprend à vouloir recopier de nombreuses tournures, si surprenantes sont-elles : «C’était une nuit sans étoiles, gonflée artificiellement à la testostérone des lampadaires. ».
Il excelle dans les descriptions d’intérieur qui reflètent la personnalité du locataire ! Pénétrer dans la chambre de son père, « c’était un peu comme entrer dans un palais byzantin, murs décorés de culs de bouteille sculptés en forme d’étoiles ou de pâquerettes. »
Cet écrivain, à la double culture franco-britannique, a pour marque de fabrique, cette façon de distiller sa «British touch » ! On prend un « English breakfast ».
Ceux qui connaissent l’auteur ne seront donc pas étonnés de voir dans le récit une pléthore de mots en italiques en anglais : crazy, what does it mean ?, It’s all about money, demolition party, running, bikers, morning glory, no bad days ( sur un mug), « black dog » , en faisant allusion à la dépression de Churchill.
Les chansons qui traversent le roman ont des titres anglais : « Wild is the wind ».
C’est un « Nico », adolescent, à multiples facettes qui se dévoile : seul, gauche quand il danse, sensible, pudique, timide pour aborder des filles, infernal selon sa soeur, une version parisienne de Peter Pan pour la mère, incorrigible dans sa propension à « mendier du temps », hésitant sur son avenir, sans réel « plan de vol ».
Amoureux fou, victime de désillusions, de déceptions, de violence, souffrant « de la pathologie du train » ! Souvent mélancolique, désemparé, découragé, abattu, en proie au chagrin, déprimé par «la connerie de certains ». Il confie avoir trouvé en Paris, le lieu parfait où « on pouvait pleurer tranquille toutes les larmes de son corps dans l’indifférence générale ». « Délicieux d’avoir Paris pour décor à l’attente ».
Son épiphanie ? Son mémoire de maîtrise validé ! Mais aussi le retour d’Inès…
Son âme de poète nous séduit quand il écrit à Laura, lorsqu’il décrit le paysage de Blonville : « Je flirtais avec les vagues, les parterres de roses trémières qui se détachaient sous la crème fouettée des nuages. », « J’apercevais un ongle de mer, une pente de toit où gambadait un écureuil roux pétrifié en épi de faîtage. »
Son imagination intarissable le conduit à inventer des objets comme « un GPS miniature à l’usage des mouches » et à prêter au père une vie riche, hors du commun, s’amusant comme un fou avec ses vidéos, habillé en spationaute « flottant dans un hyperespace… », dans lequel il se complaît. Ce qui rappelle, pour les aficionados de Jérôme Attal, les inventions du père de famille dans Les jonquilles de Green Park.
Dans ce roman d’apprentissage ponctué de confidences, on devine :
- l’insatiable lecteur à travers ses multiples références littéraires ( Huguenin, Anaïs Nin, Rimbaud, Verlaine…) , faisant la part belle à la littérature et à la poésie.
- le chanteur parolier nourri de chansons, ayant pour référence Dylan, Bowie et cultivant le culte Gainsbourg. « Avec les chansons, il avait trouvé un endroit à lui, une forteresse, alors que tout n’était que tourmente au-dehors ».
- le connaisseur en peinture qui lit Anton Ehrenzweig, fréquente les musées.
- l’auteur, lui-même convaincu par la vocation de l’art : grâce à « une toile, un roman, une chanson » nous pouvons « remonter la pente dans ce monde strié de diagonales violentes ». Un poème « comme un radeau sur une mer de souvenirs » !
Toute une érudition dont il a le talent de nous imprégner et de nous enrichir.
Dans ses échanges avec Ignacio, le fiancé de sa sœur, pointent les inquiétudes et les doutes de l’écrivain lors de la sortie d’un livre. On peut subodorer que Jérôme Attal partage cette angoisse, il a tort, il nous régale encore !
Au cours de la lecture, nous nous retrouvons otage de son récit, dans un véritable « étau d’impatience » quant au triple dénouement.
Jérôme Attal sait nous émouvoir dans ce roman intime, à la veine autobiographique, très maîtrisé dans lequel il livre ses réflexions sur le métier d’écrivain, le comparant avec celui de parolier, mais aussi sur l’amour. Un récit qui lui ressemble !Et où il a mis une nouvelle fois tout son coeur !
Dernier livre paru : Petit éloge du baiser, Les pérégrines ( 2021)