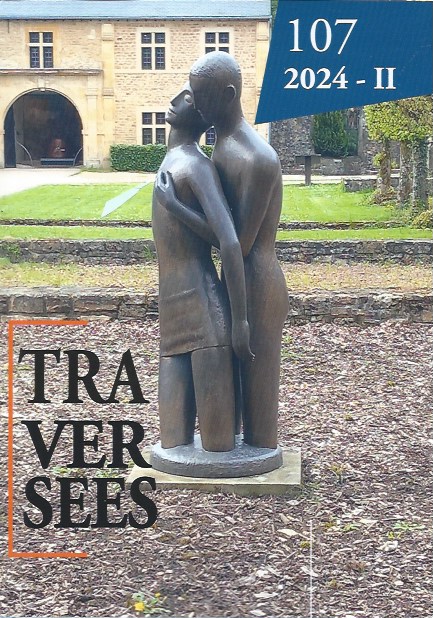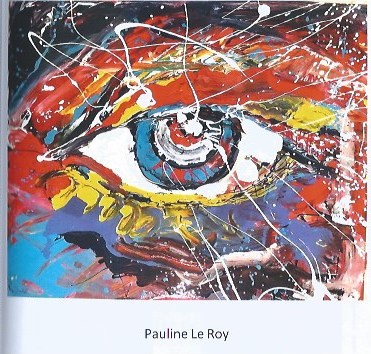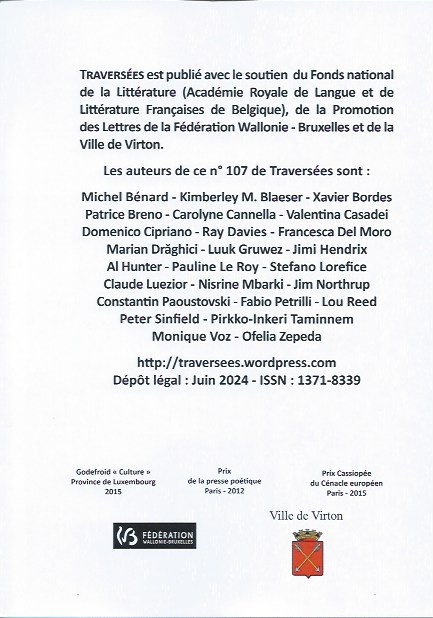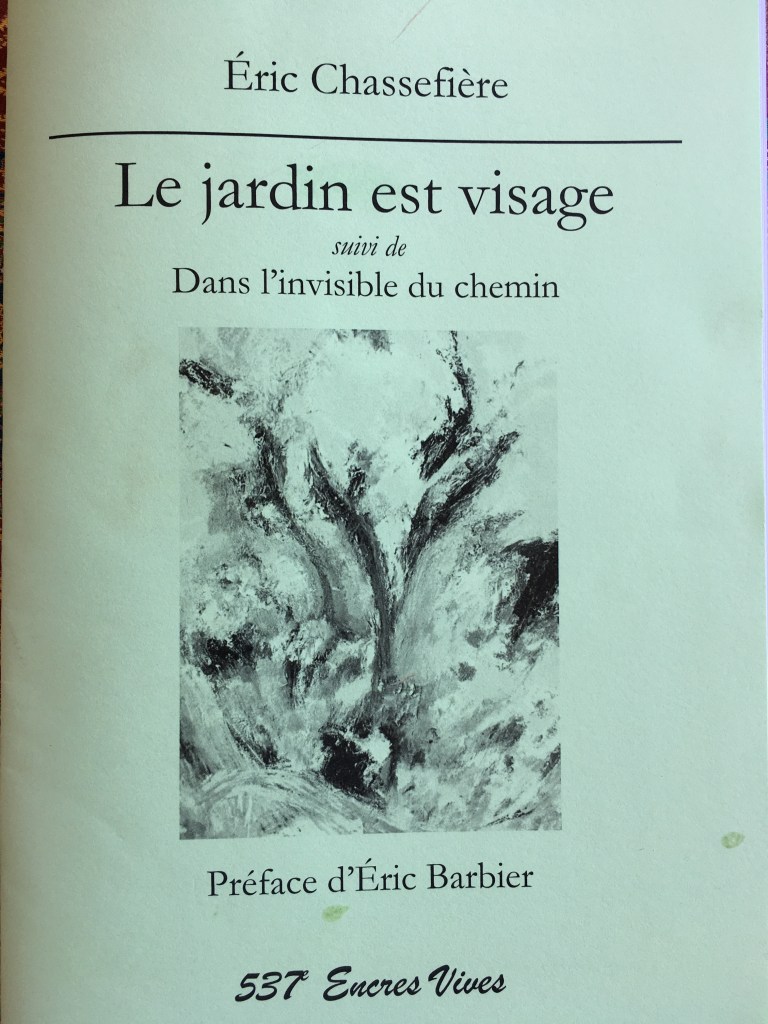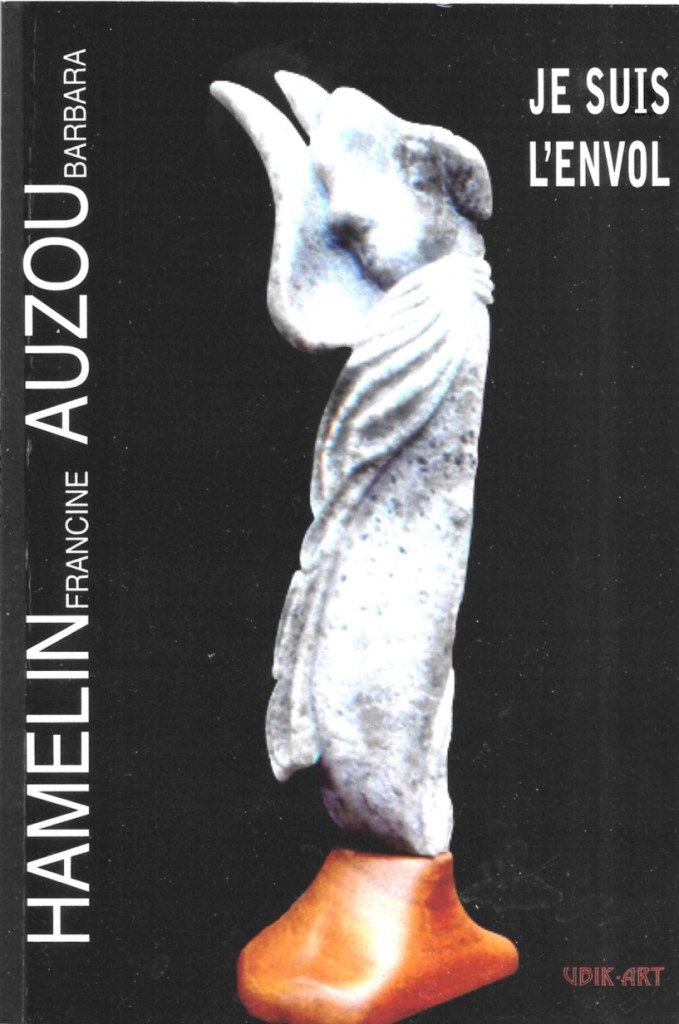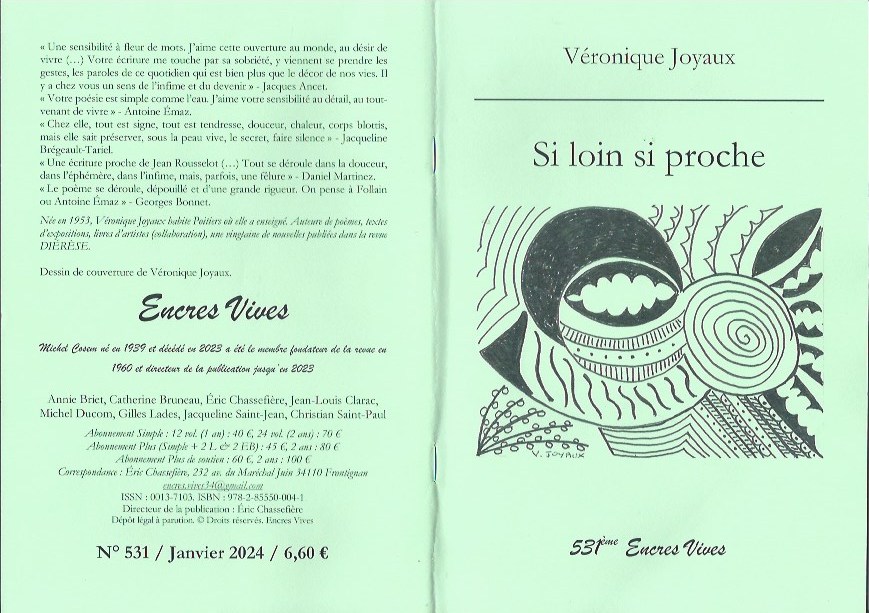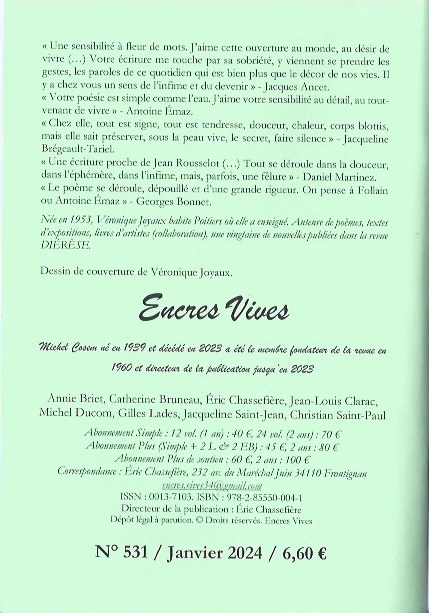Une chronique de Lieven Callant

Marie-Hélène Prouteau, La Petite plage, Suivi de Brest, rivage de l’ailleurs, Préface de Mona Ozouf, Éditions La Part Commune, 2024.
Vingt-six tableaux autour d’un même lieu, « la petite plage ». Un lieu pour révéler tous les autres, ceux inscrits dans les rêves et les légendes, ceux inscrits dans la mémoire. Points de référence, points d’ancrage. « La petite plage » est la plage de Kerfissien située à Cléder commune du Finistère en région Bretonne. Ce littoral de sable blanc, de rochers majestueux, est très fragile et particulièrement sensible à l’érosion.
« La petite plage », est pour Marie-Hélène Prouteau ce qu’est la madeleine trempée dans du thé pour Marcel Proust. J’entends par là que ce lieu focalise les émotions, creuse le temps, le rend élastique. La vigueur qu’en retire l’auteur lui permet d’asseoir un univers, son univers poétique et de rassembler en ce lieu oeuvres picturales, littéraires qui s’y réfèrent.
La petite plage est l’épicentre naturel que je revisite indéfiniment. P93
Ce finis terrae, c’est la frontière où commencent les choses. P21
Ici même et autre part, c’est la vie qui résiste. P22
Dès le commencement du livre, la nature flamboie dans les vagues qu’orchestre le vent, les saveurs se marient à d’autres plongeant leurs racines dans les profondeurs du temps, remontant le long de souvenirs perpétuellement revivifiés.
Je suis celle qui apprend à lire la mer, à lire le vent. p20, nous dit Marie-Hélène Prouteau . Elle est celle qui nous apprend à admirer l’insurrection des vagues, Elle est celle qui nous fait passer du paysage qu’on admire à celui que l’on retrouve dans le regard d’un autre peintre célèbre ou écrivain connu: Paul Gauguin, Émile Bernard, Paul Sérusier, Charles Laval, Charles Filiger, Ernest de Chamaillard, Madeleine Bernard, He Yifu. D’un musicien ou d’un sculpteur: Hans Arp
« L’ici, maintenant » devient « l’ici, toujours », « l’ici, autrefois », on se rapproche de la vie au lieu de s’en écarter. On redécouvre tempêtes, gestes héroïques ou gestes quotidiens nécessaires à la survie, souffrances des luttes, victoires de la liberté et du courage, de la persévérance.
Marie-Hélène Prouteau s’interroge et interpelle notre conscience comme par exemple dans L’enfant et le petit chien. Sa lecture des lieux nous invite à revisiter notre vision des choses, à relire nos paysages mentaux, imaginaires ou réels. À rechercher des liens, à établir des connexions avec ce qui nous arrive et ce qui arrive au monde, aux autres.
Mais comment poser une main sur sa douleur ? Comment lui dire : faire le mal est autre chose que faire du mal ?
Ce petit chien dont le nom s’est perdu n’était pas mort d’un tir aveugle. Ce n’était pas un accident. C’était le mal à la dimension du scandale. La salissure de l’âme pouvait gagner la vie. P30
Un jour comme celui-ci, j’ai l’impression que ma plage de sable blanc est une estampe orientale. Il y a les vagues, le sable, les rochers. Et rien d’autre. P37
En quelques traits d’encre, le peintre esquisse le plein, la marée haute, avec la cavalcade des flots contre les rochers. P38
Elle s’évanouira, sans autre beauté que sa disparition. La mer bretonne parle du passage des heures, du passage des choses. Dans le grand remuement des marées. P76
Ce lieu et ce qu’il représente permettent à Marie-Hélène Prouteau de déterminer ce qu’est la poésie :
Le ciel glissant dans la mer, la mer glissant dans le ciel. Là commence la poésie.
Pas de lisières toutes faites, pas de direction verrouillée. Mais l’absolue nudité des choses qui met en joie.
Jamais elle ne perd de vue la réalité ni n’oublie la fragilité d’une nature menacée aujourd’hui comme hier ( marées noires ), exploitée à outrance, meurtrie.
Demeurer, c’est habiter un lieu et habiter un temps. Un temps qui n’est pas uniquement le présent. Un lieu qui n’est pas uniquement un espace. P93
François Cheng parle de « sentiment-paysage » pour dire la connivence entre l’esprit humain et l’esprit du monde. P93
La petite plage, c’est la clairière des métamorphoses. P94
Elle m’est un contrepoint lumineux quand je songe qu’il pèse sur le monde une atmosphère d’opéra en feu : de sombres drapeaux s’agitent, si prompts à déclencher des lapidations de femmes, des pendaisons, des attentats-suicides. P95
Dans BREST, RIVAGE DE L’AILLEURS, on revisite aussi le passé d’un lieu : « les nefs immenses des Ateliers des Capucins tout récemment réhabilités. » l’Imposante carcasse de fonte, de verre et d’aluminium. Dans la grande nef, les rayonnages de livres bruissent d’autres rumeurs. Celles des mots, des phrases et de leurs mystères. Prodigieuse matière volatile. »
L’écriture, la poésie de Marie-Hélène Proutou est construite autour d’un lieu, le lieu où elle ne cesse de renaître à elle-même, autour duquel gravitent souvenirs personnels, émotions, sentiments qui nourrissent sa soif de connaissances, son amour de l’art. Ce livre nous invite à nous inscrire dans une recherche des valeurs vraies, justes, simplement humaines.