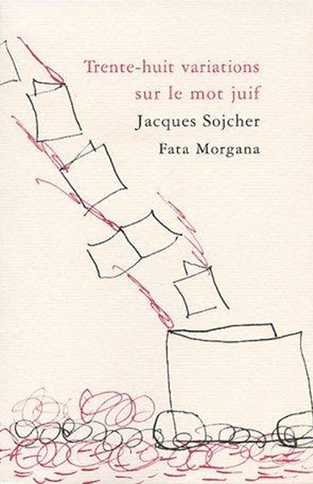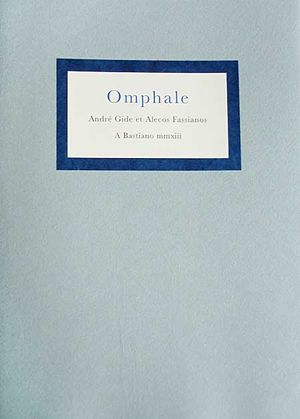Sojcher, le survivant

Jacques Sojcher

Pour permettre au discours de se poursuivre il faut parfois l’abréger. Surtout lorsque tout est dit et qu’il semble déjà bien tard et que « le rêve de ne pas parler » hante le poète belge depuis ses talus d’impossibles approches. Désormais Sojcher fait court, comme s’il « était loin déjà et dans un récit faire une sorte de « Bah » dont il ne se prive plus. D’un éclair il donne beaucoup plus que la trace de son passage : il ajuste en fragments ses zigzags.
L’écriture est aussi discrète que tranchante puisqu’il s’enveloppe de ce qui ne cesse de trancher le discours. On retrouve ici parfois les jeux de langue chers à l’auteur. Ils s’affirment par le souffle, sa coupure, son rythme cassé. La plénitude de l’idéalisme est une nouvelle fois broyé, l’âme se retrouve tête coupée sur l’échafaud du verbe (ce qui est sans doute moins ennuyeux pour elle que pour un corps).
Sojcher n’en finit jamais de désosser le romantisme et la poésie hégélienne. Pour autant il ne revendique pas un matérialisme à tout crin. Plutôt que d’évocations ou bien sûr de narrations il faut parler de récitatifs lacunaire. L’écriture se nourrit volontiers ici sur les décharges des catastrophes, mais elle ratisse les scories pour avancer nue. Tout est tendu et têtu. Le mystère du texte tient à son plaisir désespérant, à ses ruptures qui refusent les aboutissements. Lautréamont n’est pas loin mais en ellipses et laps. Il s’agit de montrer combien « la chose intellectuelle » est une vue de l’esprit.
Mais nous resterons épris de cette poésie aux énergisantes raides bulles. L’auteur est par essence l’anti BHL. Dans la suite parfaite de ce que Beckett nomma si astucieusement ses « foirades » Sojcher inscrit ses ses vanités dans sa géographie de l’ailleurs en des fables faussement lyriques. L’auteur ne sera donc jamais en odeur de sainteté mais cela prouve que ses textes ne seront jamais d’odorants « pare-fumets »
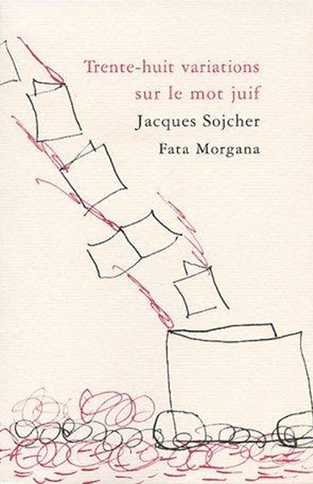
Avec C’est le sujet et Trente-huit variations sur le mot juif clôt le triptyque entamé avec L’idée du manque (même éditeur, 2013). Les poèmes de ces recueils sont des moments saisis en quelques mots au fil du temps, une suite de choses vues, éprouvés, méditées. On y retrouve la thématique cher à l’auteur : l’oubli et la mémoire,n le souvenir et le manque, la naissance – quelque part « avortée » et la mort. Par delà l’approche de l’intimité surplombe le « lieu » où elle s’est forgée : l’Histoire et le peuple juif celui du livre à la fois éternel et qui ne peut s’écrire du moins tel que Sojcher aurait aimé le rêver.
Pour le poète et philosophe belge il n’existe pas d’autres passages que par la mémoire même si – chemin faisant – il a « oublié la langue de sa mère ». Celle qui lui a donné le jour et la lumière a disparu dans la noirceur et les cendres de la Shoah. Depuis ce temps la langue que l’auteur a choisi dit les déchirures et tout ce qui le creuse. Il reste tel qu’il fut laissé dans « le rêve de ne pas parler ». Un rêve mis à mal par la grâce de l’écriture. Apaise-t-elle avec le temps ? Rien n’est moins sûr. Mais ses condensations et ses déplacement demeurent seuls viables. Néanmoins le sentiment de la perte est fichée là. Au mieux la poésie est une pluie d’hiver, d’été, une pluie des quatre saisons. Mais sous le rinçage du temps Sojcher ne peut espérer échapper aux disparitions. Ils n’ont jamais cessé de créer une douloureuse proximité avec ceux de sa fratrie, de sa communauté humaine face à la bestialité de certaines idéologies.
La poésie n’est donc pas faite pour savourer l’écart entre présence et absence mais pour le tarauder dans la substance même l’intimité. Chaque texte de Sojcher reste hanté par le cauchemar, la nuit de l’être mais la croyance néanmoins à l’identité suprême de ce dernier lorsqu’il n’oublie pas les leçons de l’histoire que parfois ses frères d’Israël oublient. C’est pourquoi l’auteur ne s’éloigne pas des mots car il ne peut s’éloigner des morts. Ils le harcèlent. Mais ils respirent dans l’écriture de ce fils en reconquête de l’origine que la barbarie a réduit en cendres.
Les mots – du moins ceux qui restent et dont Sojcher préserve de prodigalité – demeurent donc au centre du manque. Ils représentent son reste au nom de la promesse tenue par le poète bruxellois. On espère qu’ils parviennent à modérer le froid dans l’île perdue de son corps. Qu’ils restent le un mince rideau sur lequel perce un soleil noir pour rompre la dualité qui partagea le poète entre noms, lieux, présents et retours.
A chaque partage, à chaque absence demeure l’écho qu’une bouche sans lèvres et sans langue tente de proférer en souvenir des terres engraissées de cadavres innocents. A partir de là la joie n’est jamais uniquement joie mais la douleur reste douleur. Sojcher est lié à elle, à son commencement. A la recherche de l’ « autre» qui en lui le hante mais qui ne peut-être pas plus qu’un leurre. C’est pourquoi le poète ne cesse de marcher, pas à pas, dans le pas du pas et du papa. Car c’est à travers le corps de ce dernier, de son absence qu’il faut se mesurer sans résoudre son énigme. Tant que faire se peut Sojcher à défaut de franchir une fracture, recoud une fêlure. Toute sa poésie est déductible de ce schéma. Mais la question demeure : existe-t-il d’autre passage ?
Jacques Sojcher : un peu de soleil dans l’eau froide
Après « L’idée du manque » et en même temps que « Trente-huit variations sur le mot juif », « C’est le sujet » clôt parfaitement un triptyque majeur dans l’œuvre du poète et philosophe belge. Ce dernier recueil est le plus fort car dans des poèmes de quelques vers Jacques Socher met en évidence – à travers méditations et choses vues et éprouvées – l’essentiel de sa quête : l’oubli et la mémoire, le deuil et le souvenir, le manque et la survivance au sein d’une réflexion – ici allusive – sur l’Histoire et la judéité.
Tout l’héritage douloureux du poète transparaît de manière sibylline. Il n’écrit que l’essentiel et parfois préfère le silence à la dilution du logos puisque « La question est sans réponse. / Le concept / n’est d’aucun recours ». Et comme « Penser n’empêche pas / de mourir » écrire devient pour Sojcher « aussi rare qu’aimer ». Mais le poète pratique dans l’absolu les deux.Loin de toute propension de l’égo (« il » remplace « je », le neutralise), le devoir de mémoire, la douleur de ses martyrs sont présents de manière effacée, loin des sophismes et parfois avec la pratique d’une autodérision d’un clown trapéziste qui n’hésite pas à se jeter sans filet dans le vide.
La mémoire joue sur des oppositions entre présent et passé, entre constat et hypothèse : « Il aurait pu vivre ailleurs / Une femme inconnue / l’aurait porté / dans son ventre ». Sojcher reste ce voyageur en vignettes (rehaussées par celles – tout aussi superbes – de Lionel Vinche) qui oblige sous le registre d’une presque légèreté primesautière à la réflexion la plus profonde. Une fois de plus le poète ne fait qu’emmener avec lui non ses rêves mais ses propres bagages, sa propre interprétation, son propre inconscient. L’étrangeté espérée et explosive n’est qu’un cataplasme sur une jambe de bois ou un affalement dans le temps qui reste. Celui-ci est toutefois sauvé des catastrophes de l’humanité par l’affect. Sauvé aussi par l’écriture qui – même si elle « ouvre » l’inquiétant abyme des profondeurs bestiales et de l’Histoire – laisse entrevoir un peu de soleil dans l’eau froide.
LE VOYEUR ET SON DOUBLE
« Exposed : Voyeurism, Surveillance and the Camera », Tate Modern, Londres jusqu’au 2 octobre.
L’image reste toujours liée dans notre monde judéo-chrétien au péché et à la culpabilité comme s’il fallait toujours faire payer le poids de l’opprobre à celui qui regarde (et qui a priori ne demandait rien) ce qu’on lui offre. L’exposition de la Tate Modern soulève donc une série de problèmes et déplace le problème essentiel de l’art en mettant au centre non le voyeur mais la société du voyeurisme. En plus de 250 œuvres (photographiques principalement) « Exposed » – titre qui n’a jamais mieux porté son nom – expose à partir non de l’image – présentée ici comme conséquence – mais de l’objet qui a été conçu pour montrer, surveiller, faire jouir ou punir : l’appareil photographique (en toutes ses déclinaisons jusqu’àu téléphone portable preneur de vues) et l’utilisation qu’en la société en fait.
-
Jacques Sojcher, « L’idée du manque », Illustrations d’Arié Mandelbaum, Fata Morgana, Fontfroide le Haut, 2013, 56 pages

Pour Jacques Sojcher il n’existe pas d’autres passages que par la mémoire même si – chemin faisant – il a « oublié la langue de sa mère ». Celle’ci lui a donné le jour et la lumière avant que la noirceur de la Shoah le recouvre de cendres. Depuis la langue que l’auteur a choisi dit les déchirures et tout ce qui le creuse. Il reste tel qu’il fut laissé dans « le rêve de ne pas parler ». Un rêve mis à mal et pour le sauver par celui de l’écriture. Apaise-t-elle avec le temps ? Rien n’est moins sûr. Mais ses condensations et ses déplacement demeurent seuls viables. Néanmoins le sentiment de la perte est fichée là et au mieux la poésie est une pluie d’hiver, d’été, une pluie des quatre saisons. Mais sous le rinçage du temps Sojcher ne peut espérer échapper aux disparitions. Ils n’ont jamais cessé de créer une douloureuse proximité.
La poésie n’est donc pas faite pour savourer l’écart entre présence et absence mais pour le tarauder dans la substance même l’intimité. Chaque texte poétique de Sojcher reste cauchemar et la réalité, l’identité suprême, la nuit de l’être. L’auteur ne s’éloigne pas des mots car il ne peut s’éloigner des morts. Ils le harcèlent. Mais ils respirent encore par l’écriture de ce fils en reconquête de l’origine que la barbarie a réduit en cendres.
Les mots – du moins ceux qui restent – demeurent donc au centre du manque. Ils représentent son reste au nom de la promesse tenue par le poète bruxellois. On espère qu’ils parviennent à modérer le froid dans l’île perdue de son corps avant qu’elle disparaisse. Qu’ils restent ce un mince rideau sur lequel perce un soleil noir pour rompre la dualité qui partagea le poète entre noms, lieux, présents et retours.
A chaque partage, à chaque absence demeure l’écho qu’une bouche sans lèvres et sans langue tente de proférer en souvenir des terres engraissées de cadavres innocents. A partir de là la joie n’est jamais uniquement joie mais la douleur reste douleur. Sojcher est lié à elle, à son commencement. A la recherche de l’identité perdue et de l’ « autre» qui le hante mais qui ne peut-être pas plus qu’un leurre le poète ne cesse de marcher, pas à pas : dans le pas du pas et du papa. Car c’est à travers le corps de l’autre qu’il faut se mesurer sans résoudre son énigme. Le résoudre se serait être Oedipe ou le meurtre ou le manque. Alors tant que faire se peut Sojcher à défaut de franchir une fracture, recoud une fêlure. Toute sa poésie est déductible de ce schéma. Mais la question demeure : existe-t-il d’autre passage ?
Ça a un nom : c’est l’existence
Près des vieux faubourgs de Bruxelles se dressent sous un ciel magnanime les fleurs de l’Apocalypse de Jacques Sojcher. Fidèle à sa poésie l’auteur tente de donner vie (ou dit-il « hébétude ») aux deuils et aux souvenirs qui innervent l’œuvre. Son « froid est la couleur du manque ». Il est renforcé par les dessins superbes et en effacement d’Arié Mandelbaum.
L’existence semble donc promise plus que jamais à l’inéluctable démolition d’un legs en disparition. . Partout il y a des fuites d’eau. Les odeurs stagnent. Esclave de la mémoire de la monstruosité humaine le poète tente de réparer les fuites. Mais d’un livre à l’autre c’est à peine si quelques conduites sont renforcées. Quant à la langue elle semble ne pouvoir parler qu’une langue de bois. Le poète doit se chauffer avec. Quoique épuisé il a donc bien du mal à dormir comme un vivant : les yeux fermés.
Pour lui « la maison de l’être » chère à Bachelard reste bancale, caduque, rococo, riquiqui. Il n’existe de place que pour le manque. Il n’y a plus d’escalier pour s’envoyer en l’air et respirer au grand jour. Hanté par le mal, habité de démons et d’horreur, depuis l’adolescence Sojcher se donne le droit à rien ou à peu. Sauf, évidemment, le nécessaire. A savoir l’exercice de l’écriture. Elle lui a permis non seulement d’enfreindre la loi du « rêve de ne pas parler » – titre de son livre majeur – mais aussi de ne pas se suicider. Ou de ne le faire – pour ainsi dire – qu’à petit feu.
Sojcher rappela précédemment qu’il avait « oublié » la langue de sa mère. Celle-ci pria beaucoup pour lui sans vraiment le sauver. Mais elle put lui accorder un sursis nécessaire. Si bien qu’un minimum d’instinct de conservation lui donne aujourd’hui encore le droit d’imaginer le pire mais aussi de revenir au nœud primitif. Il y retisse la langue au moment même où elle se délite en espérant que les mots ne meurent jamais – surtout ceux qu’on assassine.
La poésie de Sojcher s’incarne au milieu de leur peau béante. Son murmure presque aphone tente, entre certitude et amnésie, de réanimer des figures chéries par des mots capables de rédemption. L’auteur bannit le plus possible ceux qui ont fait profession d’effroi et qui sont brandis pour fustiger les vivants. Il garde ceux qui coulent d’une source primitive où la pensée pourrait enfin devenir limpide. C’est pourquoi, au moment même où ils s’étiolent dans le crépuscule, le rêve d’écrire demeure afin de les faire marcher sur ce peu d’eau vive.
©Jean-Paul Gavard-Perret