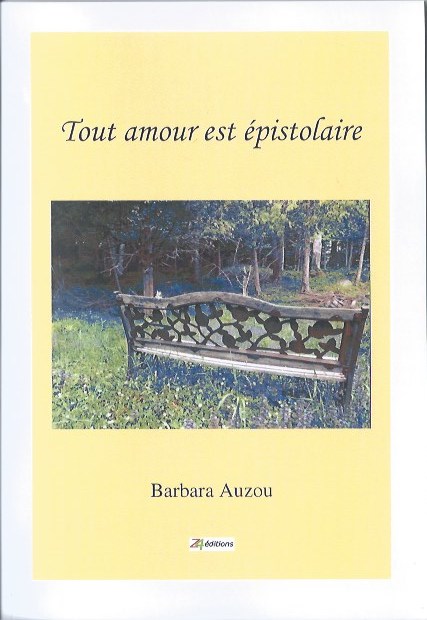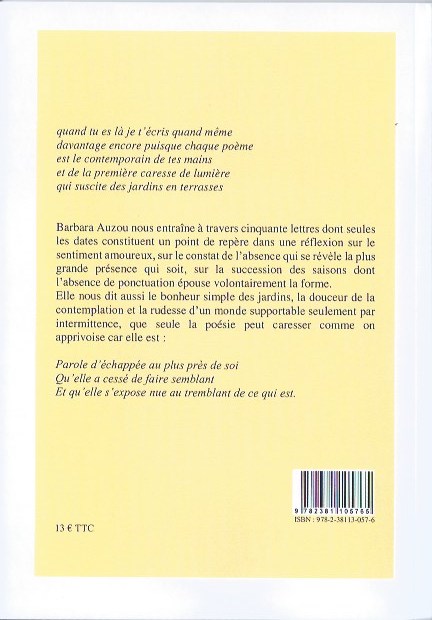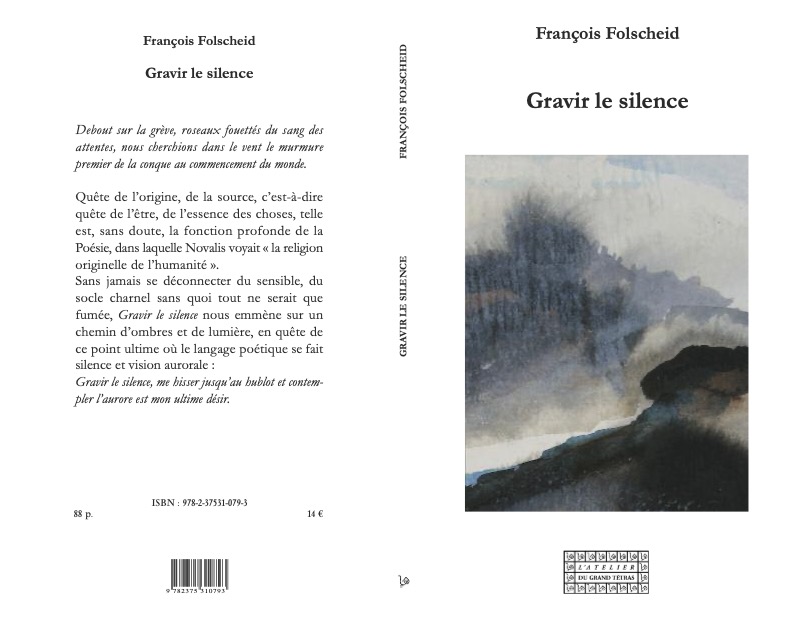Une chronique de Claude Luezior
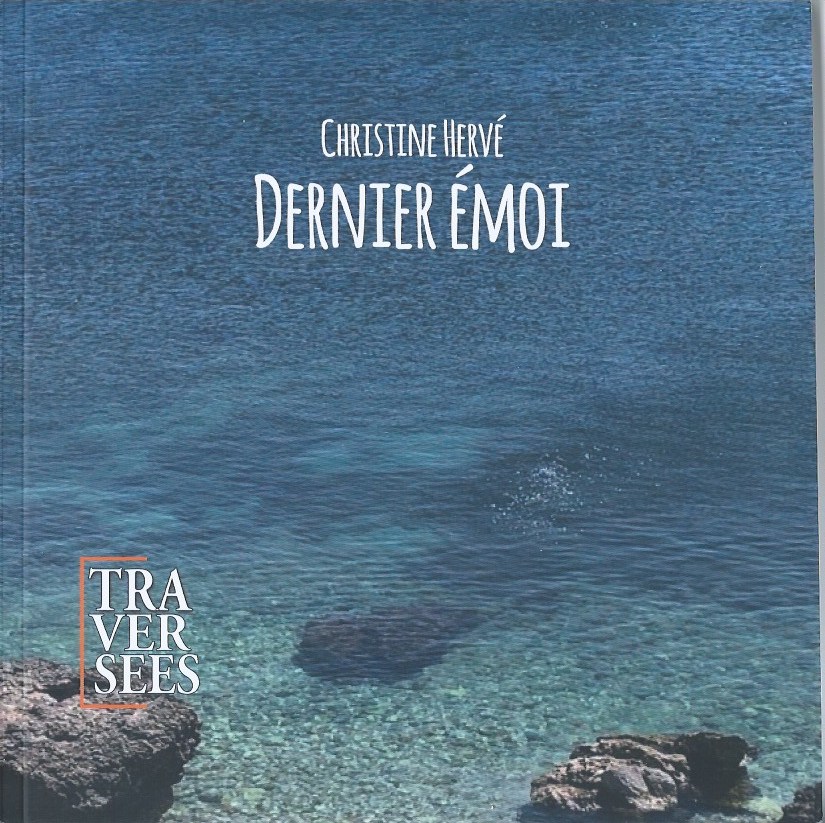
Christine Hervé, Dernier émoi, 120 p., Ed. Traversées, 2023, ISBN 9782931077078
Curieuse expérience que de lire une prose sans aucune ponctuation : on s’y perd un peu, mais finalement, en relisant, en scandant sa propre respiration, naît une sorte de complicité avec la poétesse, en une manière de décodage qui n’est pas désagréable.
On ne connaît plus les nuances du vert de ses yeux la douceur de ses mains mais l’écho de sa voix vibre encore fantôme offert au blanc du ciel
Le « on », rehaussé par une lettrine, est à la place du « je » et renforce le contexte dramatique. Désespérance ?
On accroche les guenilles de nos songes on se plaît à de belles retrouvailles au mitan du lit on lui crée des histoires héroïques lui chante des louanges il se complaît à nos fantasmes habillé de lumière ou de brume il resplendit.
Prose poétique, bien entendu, où naissent et s’étoilent les images. Nous ne le dirons jamais assez : certaines proses ont davantage de poésie que des textes rimés et à la verticale.
L’absence a ici un rôle central, térébrant, incantatoire. Dans un silence assourdissant, exprimant une violence contenue mais surtout une révolte et son lot de souffrances. Paradoxalement, jusqu’à porter les espérances en étendard, jusqu’à danser sur ses silences…

Cela dit, ce recueil est pluriel, avec des textes comprenant des phrases syncopées, lapidaires, rythmées par une très abondante ponctuation (comme si l’autrice était en manque) et enfin des poèmes libres, jetés sur le blanc de la page. Tour à tour :
Scanner. Tumeur. Dans le bas ventre. Son homme ne dort plus. Il arpente la chambre. Broie le noir de la nuit. Et elle qui voudrait se reposer ! Elle entend jusqu’à ses pensées -Viens, le lit est froid.- Non, je vais à l’étable. Une vache doit vêler.
Puis, plus tard, dans le chapitre Dernier émoi :
Ne dis rien
Seules nos mains
Seules nos lèvres
personne
De façon étonnante, la section poèmes s’intitule tourbière, alors que leur fluidité aurait suggéré « torrent» ou « cascade ». Toujours est-il que l’autrice maîtrise plusieurs styles, lesquels donnent une différente coloration à chaque texte.
Vers la fin, ce recueil renoue avec le registre d’une symphonie amoureuse :
Son baiser
oublie les années
et mon cœur bondit
au parfum sauvage
de l’adolescence
Expérience littéraire hors normes. Condensé d’âmes, de fulgurances : Christine Hervé joue avec les mots, la (non)-ponctuation, l’espace de la page mais aussi ses (et nos) sensations, notre empathie, certainement.
À relire une fois encore, avec passion.