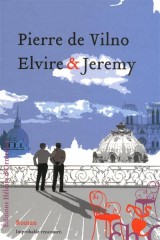Les poètes andalous, Poèmes et proses universels de Rita El Khayat. Ed. L’Arbre à paroles, Belgique. Collection Poésie Ouverte sur le monde, 2011 ; 163 pages.
Les poètes andalous, Poèmes et proses universels de Rita El Khayat. Ed. L’Arbre à paroles, Belgique. Collection Poésie Ouverte sur le monde, 2011 ; 163 pages.
– Poèmes et proses universels -, que Rita El Khayat, (REK) accompagne de nombreux dessins, croquis et photographies de son cru ; première et quatrième de couverture incluses. Dans ce recueil kaléidoscope plurilingue (français, anglais, italien) sont convoqués tour à tour : un poète japonais (traduit de la langue française par l’auteure), des auteurs arabes, des mystiques. Il s’agit de cueillettes savantes, savoureuses qui se côtoient, se télescopent ; d’humeurs plurielles, personnelles, singulières, oscillant du chagrin à la joie ; de l’indignation à la gratitude ; de la description de tableaux quotidiens, « à côté de lieux mythiques aujourd’hui disparus » p.95 ; de poésie du lieu, celle de l’Andalousie perdue et rêvée : « Voyez ! / J’ai perdu mon Royaume / Poètes andalous, / Levez-vous » p.9. « Poètes andalous, / Ma peine est immense / Elle va jusqu’à la lointaine / Étoile jurer de mon chagrin, / Demain, / Je quitte l’Andalousie, / Berceau de mes pairs, » p.10.
Ainsi, d’après Rita El Khayat, ses pairs n’ont pas su retenir en leurs vers, la splendeur : « les trésors arrivés de partout », aussi « Rien de tout cela n’est demeuré dans vos poèmes, / Poètes andalous ! » p. 13 ; « Je suis le poète femme / Étranglé de misère / Aveuglé par la laideur / Meurtri par la déchéance, / Quand vous fûtes destitués, » p.16 ; « Ayez honte au fond de vos tombeaux, / Poètes perdus, / Poètes vains et vaniteux », car « L’Andalousie a été perdue ! » ; « On m’a ravi la terre de mes Aïeux » p.17.
Poésie du lieu encore, hymne à son pays, le Maroc, pérégrination d’une mélancolie amoureuse à travers les villes de prédilection de l’auteure : l’une native, les autres écrins de vie, du travail, du passage, du patrimoine, de la transformation. Rabat, Casablanca et Marrakech. Cette dernière : « unique, ‘la Ville Rose’ est un cadre enchanteur pour les passions dévorantes enfermées dans les romans. Marrakech est si caractéristique du pays tout entier qu’elle donne son nom au Maroc (…). Elle est la fête permanente de la lumière et de la couleur, l’endroit même de la musique et des percussions venues du fond des déserts, situés aux pieds de la ville qui en absorbe les résonances et les tonalités, les moments de chaleur intense et de tiédeur par les souffles des vents apportée ». p.65.
Sur Rabat, REK rapporte ceci : « mon enfance, à Rabat, tant de fraîcheur habitant les couleurs de ces aquarelles, ma passion quand j’étais fille, Perle de l’Atlantique, bijou incrusté sur la côté occidentale du Maroc » p.86 ; « Ensevelie paresseusement dans les rouges feu des hibiscus et les dégradés de violets des bougainvilliers, elle se repose au couchant de la flamme du soleil qui a caressé vigoureusement sa tête étalée sur les sables de la plage, son ventre clos sur les ruelles de la Médina et ses pieds allongés dans les ruines du Chellah, langoureuse citadelle aux secrets millénaires » p.87.
A propos de Casablanca, REK écrit : « La nostalgie de ma vie de jeune fille, du temps passé de la ville, de son apparence qui a tant changé s’empare de moi devant les édifices loqueteux ! Je suis si triste que l’on détruise ce qui est le musée mondial de l’Art Déco sans même relever les plans et mesures, archiver, photographier, reconstruire, épargner de l’oubli, préserver comme unique et fantastique… C’est Casablanca, l’une des plus belles villes du monde pour qui sait la regarder » p.97.
L’attachement portés à ces trois villes s’étend néanmoins à d’autres villes : « De Tanger à Tiznit, en aimant profondément toutes les merveilles du Maroc, un pays à nul autre pareil » p.113. Une autre merveille est ici accentuée par l’auteure et concerne les portes : « Les portes de la vie terrestre se referment sur le repos de la nuit, sur la fin des fêtes et des cérémonies, sur le groupe de visiteurs venus refaire l’alliance », aussi « L’ineffable de la nature du Maroc réapparaît dans un objet aussi familier qu’une porte : au fond d’une impasse, encadrée de feuillage vert et luxuriant, parmi des fleurs flamboyantes, teintée, en bois massif, chaque porte raconte une maison, un quartier, une époque et tant de vies derrière elle écoulées » p.114.
Amoureuse de l’Océan « si près de la ville », REK assure : « Je suis née au bord de l’Atlantique : je ne le quitterai jamais. ».
Poésie des lieux ancestraux, et poésie de femme témoignant de destins d’autres femmes ; « les femmes sont des perles » p.63. En effet, au fil de l’écriture où transparaît le respect, l’empathie pour les destinées de femmes plurielles, s’égrainent des définitions telles que : femme-Fleur-Parfum-Souffle-Enfant-Mystère-Fatale-Flamme-Bijou-Lumière-Secret-Eau-Terre.
Les femmes modernes vivant en occident côtoient leurs sœurs d’Orient et d’Afrique qui « Voilées et pudiques, / Fortes et sincères, / (…) portaient sur leur tête / Les caravelles des coiffes, / Un enchantement, une bigarrure, / Vaisseau prêt à prendre le large, / Dans la chaleur et la violence / Du désert / Et / De la pauvreté », où « des coins et îlots restent une terre rétive au modernisme et à la modernité brutale » p.64, et où encore « Trop de sang séché a rendu tout obscur, / Le sang des porteurs dans la forêt équatoriale / Celui des esclaves, / Celui des gésines et celui des morts, / Devant la case et sous le Baobab.. / Le sang des révoltés de l’Indépendance, / Une histoire grotesque après les Blancs… » p.74.
Et du Maroc actuel, secoué par les attentats, elle conte ceci « (…) le mardi 17 avril au soir, il y a eu un très gros orage sur Casablanca. Le bruit du tonnerre était assourdissant, empêchant quiconque de dormir. À une petite fille éveillée bien tard, on demande : ‘Qu’est-ce que c’est que ce bruit ?’ Elle répondit, tranquille, ‘le terroriste’ ». Mais même s’il est prouvé que l’on peut vivre dans des conditions épouvantables, extrêmes et de haute dangerosité, Rita El Khayat ne se résigne pas à : « considérer normal ce qui ne l’est pas ». Et elle voudrait voir : « des champs de roses à l’horizon, dressées contre la laideur », à la place de la fureur meurtrière.
REK avec une certaine humilité et une bonne dose de philosophie fait ici aussi montre de son propre combat pour exister, en tant que femme, poète dans un monde qui lui a laissé des stigmates, ainsi : « brûlée à mon tour par les aberrations de la vie et les injustices innombrables que j’ai vécues » p.158.
Elle porte – sur le monde du vivant et des choses, sur l’histoire des petites gens, des puissants, et sur les paysages métissés, des regards à la fois lucides et nostalgiques, traduits à l’aide de sentences modérées, de critiques, de cris d’alarme, cris d’amour, cri de femme-Fleur-Parfum-Souffle-Enfant-Mystère-Fatale-Flamme-Bijou-Lumière-Secret-Eau-Terre ; femme qui avance dans une rectitude souvent approximative, – malgré tout ce qui fâche et révolte -, car « le ciel de ce jour n’est jamais, jamais celui de demain. La lumière est mille, une, multiple, rose ou orangée, elle se meurt à elle-même dans le temps qu’elle se réinvente, à l’infini » p.143.
Ainsi, Rita El Khayat, poète du lieu de la lumière, de la beauté fuyante, des émotions arlequines dépeint-elle – ici et maintenant – : « toutes les fibres inouïes de la tendresse, de la cruauté, de la limite et du gigantisme de chacun… » p.144, avec cet élan féminin, filial, maternel, maternant et décliné de manière humaine, trop humaine.
Minibiographie
Rita (Ghita) El Khayat est médecin psychiatre et psychanalyste, diplômée des Universités de Paris. Anthropologue spécialiste du monde arabe, professeur des université italiennes. Elle a publié trente-sept ouvrages, dont des essais, des romans, des nouvelles et de la poésie. Elle a écrit de nombreux articles sur la condition féminine dans le monde arabo-islamique. Elle est aussi journaliste et chroniqueuse littéraire à la radio.
Rome Deguergue