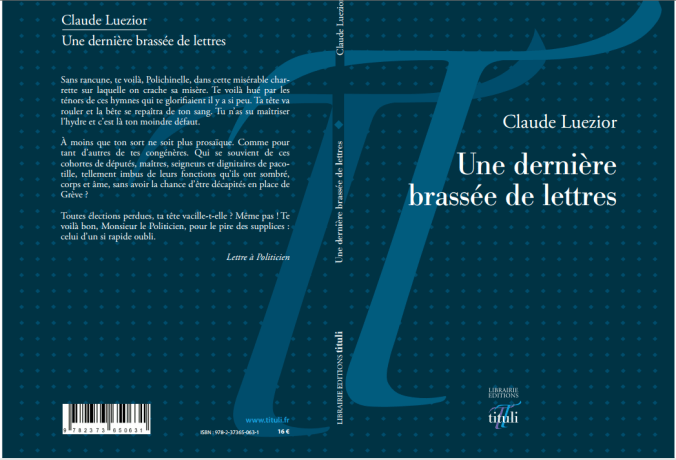Chronique de Marc Wetzel

James NOËL – La migration des murs – Galaade 2016
« C’est au pied du mur qu’on reconnaît le son des mots » (p. 128)
« La prolifération des murs, la pluralité
des murs est un fait singulier qui
exige un interrogatoire express de
tous les propriétaires du monde,
tous les propriétaires, petits et
gros Pluralité des murs, attention
fait singulier » (p. 16)
« La civilisation des murs est arrivée
à sa fin Pour que les murs
redeviennent viables, ils doivent
tomber » (p. 12)
D’abord, il y a le paradoxe (« migration des murs ») du titre, car migration, c’est déplacement massif de résidence, c’est changement de séjour ; et mur, c’est obstacle installé, c’est auto-immobilisation. Un mur qui migre ne devrait être qu’un éboulement, une avalanche. En tout cas, un mur nomade, un mur qui part s’établir ailleurs, perd (et donc trahit) sa triple fonction – de protéger, de porter, de contenir. Une digue voyageuse ne serait qu’une vague de plus parmi celles qu’elle était censé briser !
Ensuite, il y a l’ambivalence (native, indépassable) d’un mur. Si tout mur est stable (car consistant), impartial (car insensible, impassible) et cohérent (car homogène, d’apparence une dans sa continuité nécessaire), tout mur est aussi unilatéral, borné (il ne délimite qu’en séparant, il ne protège qu’en excluant), est inhospitalier, inerte (un mur
artificiellement végétalisé le prouve spontanément inhabitable ; quand un muret bourgeonne, c’est qu’il menace ruine !), est enfin imparfait, vulnérable, fragile (son inévitable exposition au réel même dont il défend le dégrade, l’assemblage qui le forme dilue entropiquement son ordre) : le meilleur et le pire d’un mur se maçonnent l’un l’autre ! « Solidité sordide » (p. 19) résume James Noël.
Il y a enfin dualité d’une part des murs anciens, des murs de toujours, artisanaux, pré-technologiques, à texture et finalité traditionnelles : rempart, clôture, palissade, remblai, paroi, façade – comme l’étaient nos « ruches de pierre » (Alain) urbaines des tribunaux, des temples, des théâtres, des halles, des gymnases : murs locaux (ils n’agissent que là où ils sont), stationnaires (au garde-à-vous fonctionnel), obstructifs (obstacles normalement infranchissables, ou fixant les conditions de leur franchissement, comme le mur du son, la poterne ou le portique), tactiques (ils savent arrêter, filtrer, surplomber, soutenir, isoler, mais ne sont cheval de Troie d’aucune arrière-entreprise) ; d’autre part, des murs contemporains, qui (ce que fait voir James Noël) sont, à l’inverse, globaux, mouvants, contagieux et stratégiques : ils sont appareillés, numérisés, interactifs, programmables, et parfois même oscarisés, – murs-drones, murs-leurres, murs-hordes, murs-spots ou de seconde intention, murs furtifs, murs intelligents . Tous les flux matérialisables sont devenus murs potentiels, et tous les murs rationnels sont devenus portatifs (selon la volatilité de leurs propriétaires, selon la micro-compartimentation des réseaux sociaux, selon la tarification maffieuse du saute-mouton des frontières, selon le palais des glaces des étreintes et des guérillas virtuelles, selon les formidables pressions expropriatrices qui harcèlent les hommes …), comme le suggère sévèrement et mystérieusement notre auteur :
« Il existe une nouvelle migration
beaucoup plus forte que celle des
flux qui poussent le sang à bouger
les lignes dans tous les sens des
hémisphères Une migration en dur,
qui massacre le champ libre du cœur
à coups de barre de fer » (p. 44)
James Noël raconte et dévoile, le premier peut-être dans ces termes, la « prospérité » proliférante, « l’omniprésence omnivore » et déréglée, « l’invasion » mercenaire, l’arrogante moderne distributivité des murs. Bref, au double sens (détroussement et envolée) du mot, la propriété c’est le vol des murs. Voilà, peut-être, la difficile et formidable intuition du recueil.
Notre haïtien archéologue des murs présents est un intellectuel, acteur, éditeur, conférencier, mais avant tout poète : un esprit, donc, inspiré, généreux, délicat ; mais aussi une âme imprévisible, obscure, agitée. Une fécondité toujours menacée de se perdre dans l’immensité de ce qu’elle déploie et se s’aliéner à l’intensité de ce qu’elle révèle. Mais c’est comme ça : chez le vrai poète (il l’est), les métaphores sont décisives, mais en contrepartie, bien sûr, les décisions restent métaphoriques ; l’engagement poétique reste, par principe, interne à la parole : même les plus nobles des actions réelles de soins, de reconnaissance, de développement, d’émancipation, ne sont pour le travail poétique que vulgarité d’intendance, historiquement vitale, certes, socio-politiquement pertinente, mais nécessairement secondaire pour l’écrivain, et son seul responsable privilège : être un front qui chante … la perfection des choses inexactes ! (comme disait Maldiney).
Et inexactes, oui, les choses le demeurent parfaitement dans le chant tendu, difficile (le vertige brouillant logiquement la clarté de l’appel), risqué (car irrattrapable), et radical (le mot est juste ou rien ; s’il vient à rater sa formule, non seulement le poète a parlé pour ne rien dire, mais il n’aura pas parlé du tout !) de James Noël. Ainsi :
Pour exprimer l’idée que les murs sont des conglomérats de sensations sans sensibilité, il écrit :
« Les murs ont des odeurs, mais
les murs n’ont pas d’aisselles » (p. 39)
Ou la nette idée que le droit est comme un mur de la propriété, qui ne valide que ce qu’il restreint, ou n’impose que par contrainte la liberté même qu’il fonde,
« Les propriétaires, petits et gros, pèsent
très lourd sur le dur marché des
murs Dès l’enfance de l’équerre, ils
ont posé la première pierre, ils sont
arrivés ensuite à imposer les murs
comme seul horizon indépassable » (p. 29)
Ou la belle idée que la rationalité, même lorsqu’elle s’applique (règle, compas, fil à plomb) aux choses mêmes – pour les construire ou les valider, est elle-même trop formelle, trop contractuelle, trop intemporelle d’origine, pour partager leur vie et comprendre leur sort,
« Qui a dit que l’équerre était l’enfance
des instruments Un instrument
marqué à ce point au millimètre
saurait-il avoir une enfance ? » (p. 31)
Ou l’étrange idée qu’un mur, n’étant jamais abattu pour lui-même (en soi, son inerte et longiligne front de taureau n’intéresse ni n’indispose personne !), mais toujours seulement pour ce qu’on lui fait enclore, défendre ou supporter, accuse, bombardé, la capricieuse culture de faire à sa place payer son anodine infrastructure,
« Les murs tombés sous le coup
des bombes accusent le bois et les
meubles d’être coupables du grand
feu qui se propage de l’intérieur
comme une vocation » (p. 90)
Ou l’audacieuse idée que les murs, normalement inhumains (et ayant le droit de rester tels!) l’ont mauvaise de crouler sous les graffiti où des hommes complaisants déversent ce qu’ils voudraient que montre le miroir de leur âme ; tout le street-art n’est qu’une trace de rouge à lèvres du narcissisme collectif,
« Les mots sur les murs sont stratégie
fine pour leur donner une couche
d’humanité Tous ces bétons en
rangs serrés, qui portent un mot
comme s’ils parlaient avec une
main sur le coeur » (p. 74)
Ou encore la dérangeante idée – s’il s’agit bien de ça ici – que le kamikaze (le tout-venant des bombes humaines, le suicidaire téléguidé de la jugeote) n’est qu’un mur à roulettes et à clous, avançant tuer les raisons de vivre qu’il ne peut saisir,
« Dernière nouvelle Une catégorie
de murs entre dans une forme de
radicalisation. Et dire que c’était trop
dur d’aborder le problème, même
d’un point de vue superficiel . Mettre
des cœurs en cage depuis des siècles
pour mieux les sauter à la dynamite
La mort en pleine ceinture pour
une explosion qui génère cassure
après cassure » (p. 58)
On le sait : l’innovation exponentielle est comme un fâcheux mur du sens, qui referme (donc claque) toujours plus de portes derrière lui qu’il n’en fraie et aménage devant. Ainsi les murs mêmes de la nouveauté – murs Big-Datesques de l’information, murs héréditaires de l’argent, murs polluants du dérèglement atmosphérique, murs narcissiques du bien-être coaché, murs gémeaux des oeillères de jute des fanatiques et des loups de satin des esthètes … justifient l’amère simplicité d’une remarque de la postface :
« On aurait souhaité faire seulement de la littérature, mais dehors l’air est barricadé de toutes parts, c’est tout juste si le royaume des borgnes et des aveugles n’exige pas un permis, un passeport pour avoir de droit de respirer. L’homme avance entre essoufflement et étouffement. L’omniprésence omnivore des murs le place dans une impasse. Ce livre est un appel, une invitation à l’escalade » (p. 128)
Cette poésie âpre, fine et tourmentée, me paraît enfin avoir trois rares qualités :
Elle n’est jamais manichéenne : James Noël moque les murs et loue les ponts (p. 124), mais nuance toujours : il y a des ponts mortels (une épidémie en gagnera l’autre rive plus aisément qu’à la nage ; un pont sur l’Achéron ne mènerait que plus sûrement dans les Enfers), comme il y a des murs vitaux (nul ne murmure contre un mur anti-bruit ; et le mur anti-épidémie a sauvé la Drôme de la peste provençale de 1720) . Ce que notre poète dénonce, et même méprise, ce ne sont pas les maçons des murs (car ils les assemblent pour vivre, et un jour seront leurs plus compétents déconstructeurs ! p. 112) mais bien leurs architectes, les adeptes du pouvoir anguleux, les créditeurs de l’équerre facile, les chorégraphes aussi de leurs hypocrites entrechats :
« Certains murs marchent sur la
pointe des pieds, d’autres s’érigent
même en voyeurs en leur manière
de faire la courte échelle … » (p. 122)
Ensuite, l’idéal spirituel semble bien celui-ci : les murs humains, quelle que soit leur utilité extérieure, sont destinés à finir en nous, à y être jugés, dilués (en tout cas recyclés), car, même ce dont en nous nous devons nous protéger (comme les pulsions fatales et les fantasmes ruineux), nous devons toujours pouvoir y accéder. L’emmurement personnel, c’est l’autisme ; les cloisons inamovibles du moi font la psychose, la forclusion. Contre cela, l’humour (qui est le tremblement d’esprit par lequel le cerveau se révèle seul organe apte à se moquer tendrement de soi) et la lucidité (qui, même roborative, montre comment le cerveau et la vérité savent respectueusement se faire l’amour) suffisent, comme le dit le contraste de ces deux passages :
« Pas la peine de chatouiller les murs
Ils n’ont aucun sens de l’humour Par
contre, les murs adorent qu’on leur
pisse contre Allez comprendre » (p. 42)
et
« Quelque grand que soit un mur,
il est conduit à faire faillite en
nous, à s’effondrer dans un de nos
moindres tremblements intérieurs
Toutes proportions gardées, les murs
ont la vie dure Il est de toute urgence
de les porter comme inquiétude,
au mieux comme métaphore » (p. 30)
Reste, insiste l’auteur, à savoir au nom de quoi, face aux murs, n’être plus leurs dupes. Car leurs concepteurs en ont, bien sûr, fait des imposteurs (comme incendies se flattant d’éclairer, pandémies feignant de divertir ou barbelés prétendant décorer, les murs disent instruire là où seulement ils intimident, et jouent les rebelles là où ils ne résistent… qu’au beau, au juste ou au vrai !). La forte et franche réponse de James Noël semble celle-ci : pour retrouver sur nous-mêmes la bonne, l’objective, l’authentique distance, la hauteur infinie du ciel suffit – ciel qu’il ne convient alors pas de murer en ou par Dieu. C’est ce que nous disent ensemble trois passages, à la sarcastique intransigeance, nous enjoignant de n’imiter des murs que leur résolu agnosticisme :
« Aux yeux des étoiles, les murs et
les gratte-ciels sont des géants aux
pieds d’argile Les étoiles, ça roule
des reins et cille des yeux dans une
migration hautement lucide… » (p. 107)
« Les murs de la chapelle Sixtine
sont des murs comme les autres
Il n’y a pas de mur plus sexy, plus
métaphorique qu’un autre Tout est
dans le revêtement et dans les pans
de la réalité des murs Les murs de
la chapelle Sixtine sont des murs qui
ont une foi solide en leur propre
existence …» (p. 98)
« Les crucifix font souvent l’affaire
des murs, qui ne demandent pas
mieux pour soigner leur profil
Blanchiment de la conscience
Blanchiment de la foi dans la chaux
vive Blanchiment des crimes contre
l’humanité Meurent des peuples à
genoux sous prétexte de prier » (p. 110)
L’évident génie littéraire et spirituel de l’Haïtien James Noël (38 ans, et voici déjà un chef d’œuvre) adoucit ainsi, ou en tout cas illumine, les temps qui viennent.
©Marc Wetzel