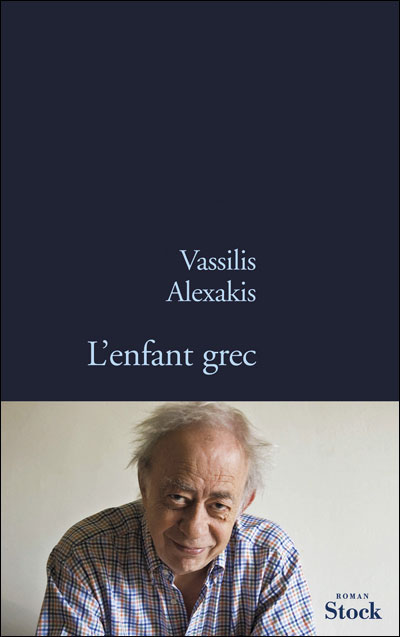Chronique de Nadine Doyen
Peut-on oublier un mot de sa langue maternelle ou de sa langue d’adoption ?
Oui, dira l’auteur, qui, en a fait l’expérience. Il s’interroge sur le mécanisme de la mémoire chez les adultes, mais aussi chez les enfants et nous livre les résultats de son enquête. Ce mot oublié donne donc le titre au roman.
Vassilis Alexakis est un habitué des allers retours Paris-Athènes. Dans ce roman, il nous fait partager son séjour 2013, nous relatant les retrouvailles avec sa famille, la réception qu’il organisa pour ses 69 ans, (son anniversaire tombant à Noël), ses rencontres fortuites dans les rues, le tout dans les moindres détails. Des sujets récurrents sont développés : l’écriture, la traduction, les langues et la crise grecque.
Mais ses pensées sont constamment tournées vers son éditeur, devenu plus qu’un ami, un confident, taraudé par la crainte de ne pas le revoir. L’auteur lui téléphone et commence une conversation ininterrompue, échangeant sur de multiples registres.
Le portrait de celui qui n’est pas nommé (1), facilement identifiable, puisque l’auteur de Deux vies valent mieux qu’une, livre catharsis, se tisse au fil des pages.
Le romancier se remémore leur première rencontre en 1974, la publication de son premier roman Le sandwich et relate comment leur lien professionnel se transforma en une véritable amitié, une complicité fraternelle matinée de déférence. Avec nostalgie, il se souvient de leurs étés à Tinos, leurs familles réunies.
On suit avec empathie le combat de l’éditeur contre la maladie, le traitement de la dernière chance et la façon dont Vassilis Alexakis le drape de bienveillance et lui apporte un soutien moral incommensurable, une présence lénifiante jusqu’à cette fatale date du 25 mars 2013, coïncidant, ironie du sort, à la fête nationale grecque.
Et si le tag « Je dépéris », vu sur un mur à Athènes, était une voix prémonitoire ?
En parallèle, se brosse l’autoportrait de l’auteur bilingue, sollicité de toutes parts, par des salons, des universités, des librairies et médiathèques. Avec humour, à l’instar de L’écrivain national de Serge Joncour, il commente ses voyages en train, ses rencontres avec son lectorat, ses passages dans les villes, dont il ne connaît, parfois, que la gare, la cathédrale ou le phare (énigme de Brive). Il est passé expert en noms des habitants. Il ne cache pas ses idées politiques sur la carence du gouvernement de Samaras, l’administration qui sommeille, la troïka et le parti Aube dorée. Il est indigné de voir l’église intouchable, la misère dans les rues, occultée par les pouvoirs publics. Avec Zoé, ils évoquent les droits bafoués. Il ne se prive pas d’égratigner les journalistes peu délicats ou le net, source d’infos erronées. Il souligne l’inéluctable solitude de l’écrivain et justifie son choix de quitter Stock. Il concède sa propension aux mensonges. Il confie sa lassitude de Paris, où l’on garde ses distances.
En marge de ce duo éditeur/écrivain, défile toute une galerie de personnages atypiques, hauts en couleur : Minas, le clochard érudit qui lit Cavafy, Théotokas ; Lilie qui tricote des pulls pour les miséreux SDF ; la dame au cageot rouge ; « un marchand de loukoums qui miaulait » ; Orthodoxie, qui joue dans une équipe de football et vend Le radeau, en gilet rouge. N’oublions pas que Vassilis Alexakis est un fanatique de ce sport. Dans le quartier du Céramique, au cours d’une maraude, l’auteur croise Thodoros, ex- commerçant, ruiné.
L’auteur sait à la fois nous émouvoir (avec ses larmes de « la taille de pièces de dix euros » et nous dérider par des scènes insolites ou cocasses, frôlant le ridicule, mais excellant dans l’autodérision. Le travelling sur une poubelle qui dévale, avec l’auteur s’évertuant à la freiner est plein de suspense. Une passagère qui ne sait plus détacher sa ceinture, arrivée à Roissy. Le pantalon qui se détache du fil et atterrit on ne sait où. Parfois c’est lui qui chute de son fauteuil. Sa sortie d’une bouche d’égout, couvert d’« une boue, blanchâtre », dans l’indifférence des passants. Comme il le fait remarquer tragédie et comédie « sont deux genres qui se côtoient sans cesse, qui habitent sur le même palier ». On sourit à la naïveté de sa question concernant les marées : « Comment je vais faire pour rentrer chez moi ? ».
Il adopte un style imagé pour décrire sa table de ping-pong : « Les documents formaient des chaînes de montagnes. Les deux raquettes, comme elles sont bleues, figuraient des lacs ». Tel un poète, à Tinos, il sait s’émerveiller devant la beauté d’un papillon : « j’ai eu l’impression qu’il applaudissait le paysage ».
On adhère d’autant plus facilement que l’auteur nous apostrophe en ami. Ne nous fait-il pas partager même ses messages téléphoniques ?
Avec Vassilis Alexakis, 71 ans, on ne prend pas racine. Toute sa vie n’a-t-elle pas été une course ? Fait-il remarquer, « complètement essoufflé ». Il nous embarque dans ses déambulations athéniennes (le café d’Exarkheia, le quartier de Kypséli peuplé d’immigrés, de Kolonaki, d’Omania) et parisiennes (imaginant son ultime traversée de Paris). « Les lieux sont chargés de souvenirs », des liens et notre mémoire.
Il nous offre une immersion dans la langue grecque, émaillant ce roman de mots grecs, rendant hommage à l’helléniste Jacqueline de Romilly, qui a donné son nom « à une place près de l ‘Acropole ». « La grâce des mots tient à leur sens : c’est lui qui leur permet de s’envoler comme des ballons ». Il est lui aussi un adepte du name dropping : François Bott qui lui assure que « Trouville est le lieu idéal pour fumer la pipe », dont il ne se sépare pas.
Les aficionados de Vassilis Alexakis reconnaîtront les romans précédents qu’il évoque. Depuis celui où il apprend le sango, celui où il cherche le premier mot, des titres moins connus comme La tête du chat et l’avant-dernier qui est celui de la remise sur pied. On retrouve cette même autodérision et des scènes cocasses parfois cinématographiques. L’auteur aime convoquer les absents. Il nous a déjà habitués à ses récits d’outre-tombe avec : Je t’oublierai tous les jours ou L’enfant grec, dans lesquels il dialogue avec sa famille disparue (mère, père, frère). Rappelons que Vassilis Alexakis a reçu le prestigieux Grand Prix de l’Académie française.
Le bémol qui peut indigner des féministes, c’est la façon dont l’auteur évoque ses liaisons éphémères, concédant ne pas être amoureux. Par contre, sa petite fille Éléni le fait fondre de tendresse et il lui promet de « l’installer au cœur de sa mémoire ».
Dans ce roman largement autobiographique, Vassilis Alexakis mêle souvenirs, anecdotes, interrogations, confidences adressées « à mi-voix » à ses lecteurs, « façon de les traiter en amis », réminiscences de son « intermezzo » à Rome. Il s’égare dans des digressions sur les chiffres, les couleurs. Il nous offre une incursion dans le théâtre et le dictionnaire. En journaliste, il autopsie la situation de la Grèce, dresse un état des lieux dramatique (mesures d’austérité imposées par Bruxelles, pauvreté et « affres de la faim », fermeture de librairies), prémices de la crise actuelle. Elle « n’a plus qu’un visage, celui de ses fautes ». La Grèce, déliquescente, est à vendre. Il égratigne ceux qui bénéficient de niches fiscales, comme l’église. Toutefois, on comprend mieux son attachement à Athènes, plus rien ne le retient à Paris. Serait-il mal à l’aise avec la montée de la xénophobie, lui, l’exilé ? Désirerait-il se rapprocher de la mer ? Elle, « qui résiste le mieux à l’oubli » et qu’ « il faut regarder debout ».
Pour donner de la légèreté, la musique (bouzouki, rébétiko) et la danse ponctuent le récit, teinté de mélancolie. La vie ne vaut-elle pas d’être dansée ? L’auteur ne se fait-il pas passer pour « équilibriste » ? Jongler du grec au français, il excelle (« exercice salutaire pour le cerveau »), tout en soulevant les difficultés auxquelles un traducteur est confronté quand le mot n’existe pas dans l’une des langues.
Dans La clarinette Vassilis Alexakis rend un vibrant hommage à cet ami, qu’il a accompagné avec abnégation et tendresse, lui offrant un tombeau de papier à la hauteur de leur quarante années d’amitié indéfectible, de fidélité, de soutien réciproques. Comme le pense Milena Busquets, ne sommes- nous pas « davantage les choses que nous avons perdues que celles que nous avons » ?
Un roman touchant, alerte, fertile en imprévus, truffé de références mythologiques, d’une grande envergure, que l’on quitte à regrets, dédié aux enfants du disparu.
« Topissime », oserais-je ajouter !
©Nadine Doyen
(1) Jean-Marc Roberts