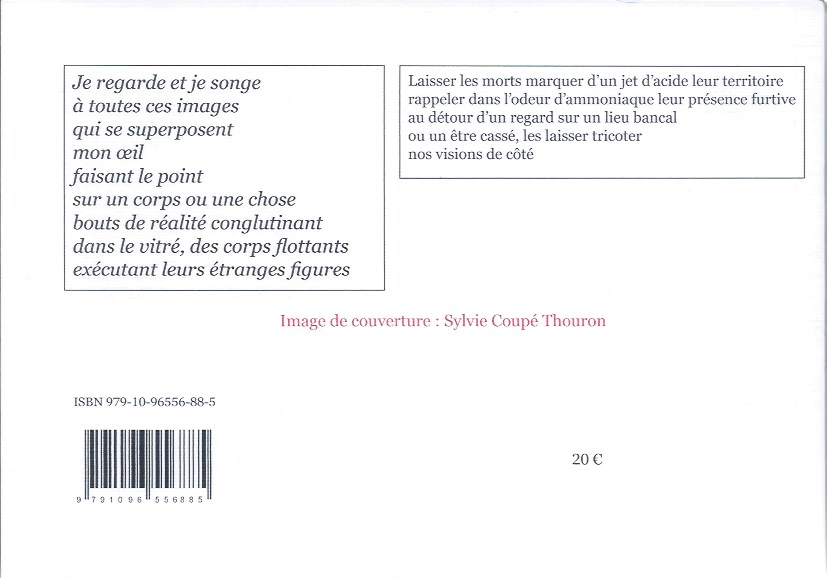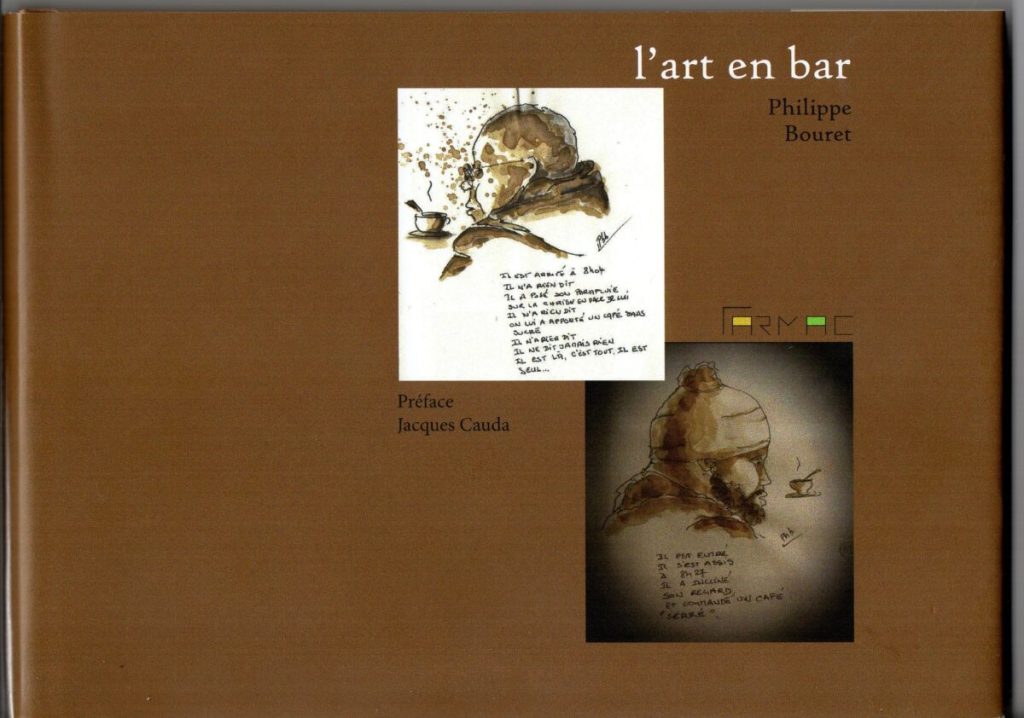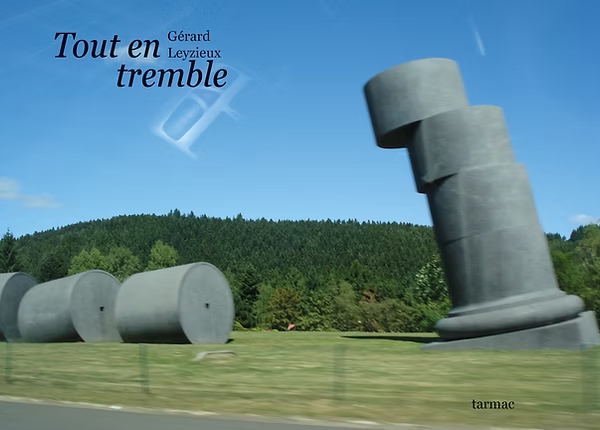Une chronique de Lieven Callant
Jérôme Carbillet, Les Vaches, Tarmac Éditions, format 148X210, papier vergé, 54p, 15€, juin 2025.
« Il me semble parfois que le monde est réel. » Peut-on lire sur le dos de ce livre écrit par Jérôme Carbillet comme si on voulait souligner que le poète passe la plupart de son temps à rêver et que le texte poétique ne serait que le fruit d’un songe.
Pourtant cette phrase surprenante parce qu’elle nous signifie un réveil, un sursaut ne prend de l’ampleur que grâce au contexte. Elle survient, seule face à la blancheur du papier de la page 41, après le poème de la page 40 intitulé « Fait divers ».
Quelque chose d’ordinaire survient parmi tellement d’autres faits, un homme meurt. Marc. Marc est « ce type hirsute et rachitique qui jouait, tous les après-midi, à la poupée dans le bac-à-sable du square Jean Monnet.(11 )» « Tout le monde le connaissait et sa présence n’avait posé de problème à personne. » Pourtant : « Et hier, donc, les agents de la police municipale ont découvert son corps, sacrément malmené. Quelqu’un lui avait fourré une de ses Barbies dans la bouche. »
« Il me semble parfois que le monde est réel » formule donc un constat. Ce qui est réel, ce qui le devient et que cherche à montrer ce puissant recueil est que l’intolérance gagne du terrain et que ses conséquences marquent les esprits, tuent les consciences et passent justement sous silence cette odieuse réalité. « Personne ne sait exactement ce qui s’est passé » mais on parle de « gestes déplacés » de « comportement inadaptés ».
L’ensemble des textes semblent nous mettre en garde et nous montrer que la société capitaliste marginalise de plus en plus d’individus en classant sous les termes de « troubles de l’humeur », « troubles psychiatriques » , « burn-out ». Elle culpabilise les individus, vous et moi, (tous les textes ou presque sont écrits à la première personne du singulier) qui subissent et souffrent à tous les niveaux, des cadences imposées. Les normes gomment les différences et imposent un modèle type de bonheur. La liberté devient un concept vague qui confère de moins en moins le droit de ne pas être d’accord, de vouloir vivre autrement, autre chose. L’expression est limitée et repose en général sur un consensus qu’il ne faut plus questionner.
Or, la poésie est justement l’enfant sauvage de la littérature. Elle choisit volontiers les chemins de traverses, les pentes ardues, les précipices violents. Il est difficile de dompter ses voix, d’éteindre ses incendies. On ne lui impose ni mode, ni coutumes.
Les vaches, ces paisibles ruminants qui regardaient passer les train subissent massivement en meuglant les mauvais traitements que leur font subir les industries avides de rendements et qui placent le bien-être animal, le bien-être tout court derrière leurs profits directs. Leur sort comme en miroir du nôtre, de celui qui nous attend?
« Un été
18 ans. Plein été. Job étudiant dans une banque du triangle d’or. Chemise froissée trop large. La gueule de bois. Et le rêve pour seul horizon. Wagon bondé. Je lâche un meuglement. Un long. très long meuglement de vache blessée. Personne ne se retourne. » P32
De nombreux textes parlent « d’une brûlure intense et pulsatile qui donne un sentiment de mort imminente. Il est alors impossible de se concentrer sur autre chose que la douleur et l’anxiété. » « Pendant quelques instants, la conscience mesure la valeur réelle de l’existence, et puis, bien souvent, elle s’en retourne à son inconséquence ordinaire. » P33
La première chose que nous révèle Gregory Rateau, dès les premières lignes de sa préface et comme si c’était important est qu’il avait trouvé une similitude de rage entre sa poésie et celle de Carbillet mais la poésie de ce très puissant présent recueil, c’est tout sauf de la vache enragée. La colère dépasse l’impuissance de la simple rage, parce qu’elle témoigne d’une douleur qui n’est en rien individuelle dans le sens où elle touche l’ego et trouve ses racines dans un malaise personnel. La meurtrissure est ordinaire, commune, partagée par tous et nous souffrons parce que quelques personnages toxiques nous imposent leurs vacheries et autres cruautés. À mes yeux, il ne s’agit pas d’une posture artistique comme on peut la rencontrer chez certains auteurs qui se servent de l’humour ou de la dérision.
Projet de vie
Mettre un jeton dans le caddy
Consommer
des morceaux
de vache
Pratiquer le tri sélectif
Passer un scanner cérébral
un scanner cérébral
un scanner cérébral
un scanner cérébral
un scanner cérébral
un scanner cérébral
un scanner cérébral
un scanner cérébral
un scanner cérébral
un scanner cérébral
un scanner cérébral
un scanner cérébral
un scanner cérébral
un scanner cérébral
un scanner cérébral
un scanner cérébral
un scanner cérébral
un scanner cérébral P34
Comme le signale l’auteur dans son avant-propos, il fait un constat après avoir entendu pendant une dizaine d’années des personnes en souffrance au travail. Ces textes de fictions sont son compte rendu clinique. Autrement dit, son analyse raisonnée et lucide des mondes auxquels il a été confronté en tant que psychologue et aussi naturellement en tant qu’être humain, humaniste.
« Quant au magasin Intersport, il exposait des dizaines de modèles de runnings comme des oeuvres d’art, et, en voyant tout ça, je me suis senti bizarre, et je me suis dit que l’enfer devait ressembler à ça. » p 22
« les rues ressemblaient à des rues
mais à rien d’autres
les arbres étaient des arbres
la route la route
et rien que ça
le monde en somme
était vidé de ses symboles »
Il s’agit bien de cela: interroger un monde en perte de sens. Est-ce que ma vie vaut encore la peine dans un tel contexte? On est en droit de se poser la question.
« Le ciel dégoulinait comme un oeuf frais sur ma tête, et je le sentais couler, très lentement, visqueux et froid, le long de mon crâne. »
« C’était le soir quand la mer s’est levée, agitée comme la nuit.
Du haut de la falaise. Des grondements. Un écran noir. J’ai
reculé. Et j’ai fait demi-tour. Mon coeur battait trop fort »
Seuils
Je me tiens à présent dans un monde où n’existent ni l’ombre
ni la lumière; où la possibilité même du silence est abolie,
comme celles du commencement et de la fin » P47
©Lieven Callant
____________________________________
- Jean Monnet est un haut fonctionnaire français et un banquier international, promoteur de l’atlantisme et du libre-échange. https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Monnet. ↩︎