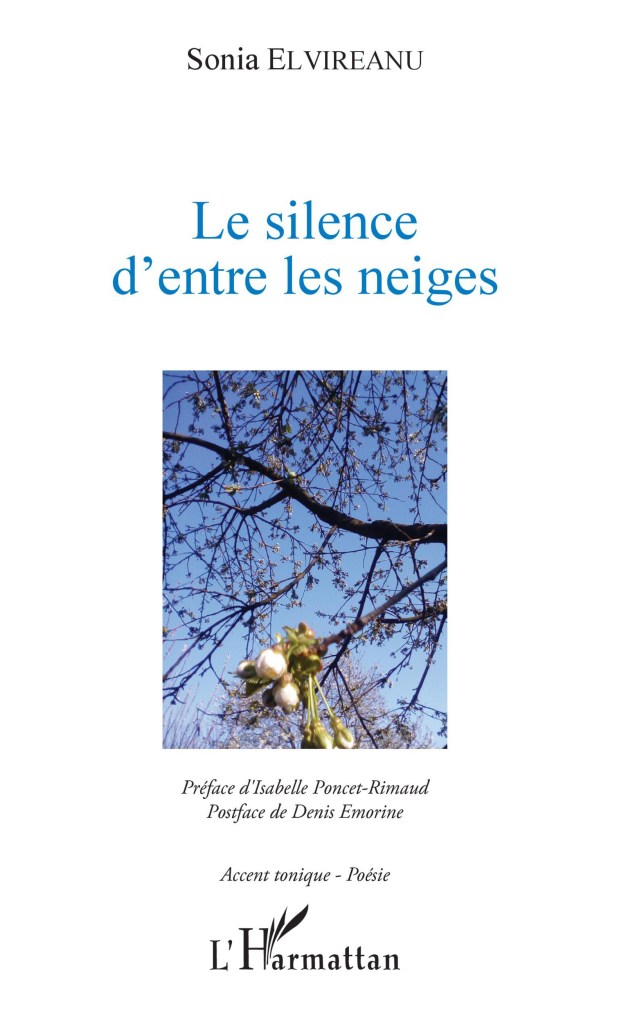Une chronique de Sonia Elvireanu
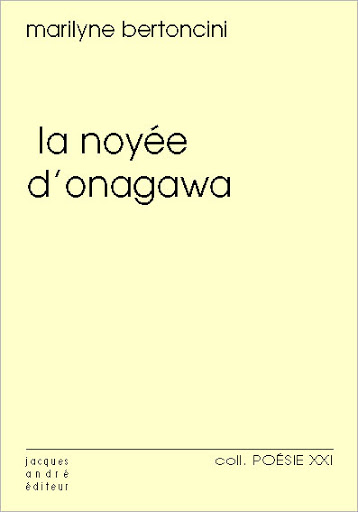
Marilyne Bertoncini, La noyée d’Onagawa, Jacques André éditeur, 2020. Coll. Poésie XXI, 51 p.
La noyée d’Onagawa nous renvoie par son titre vers le drame. Et c’est bien un livre troublant inspiré par le réel le plus dramatique, une catastrophe naturelle : le tsunami qui a ébranlé les côtes japonaises du Pacifique en mars 2011. Onagawa, petit port de pêche, à 400 kilomètres de Tokyo, a été d’un coup englouti par les eaux déchaînées de l’océan.
Pour évoquer en poésie ce cauchemar, la poète doit mettre en oeuvre son talent poétique, une profonde sensibilité et un imaginaire de l’eau à même de nous faire ressentir la force terrible de la nature indomptable. Cette tragédie collective, relatée à l’époque par la presse partout au monde, aura suffisamment impressionné l’auteure pour qu’elle jaillisse après des années dans son long poème épique La noyée d’Onagawa.
Ainsi le recueil est-il fait d’une suite de poèmes enchaînés à la manière des séquences de cinéma où la poète reprend les événements dramatiques racontés dans une dépêche. Elle appelle rêverie poétique ce poème narratif tel un fleuve, qui refait le film du séisme.
Marilyne Bertoncini poétise avec art un fait divers terrible et nous fait réfléchir aux désastres qui menacent l’homme dans son rapport avec la Nature. Un lyrisme délicat dans l’évocation du paysage d’avant la tragédie, rappelant la grâce des estampes japonaises, se mêle au dramatisme du récit. On aime les paysages crayonnés par l’œil contemplatif, presque atemporels, en fort contraste avec les images effrayantes de l’océan déchaîné par le tsunami.
La poète crée un préambule à l’événement tragique, présenté graduellement, avec la lenteur d’une caméra promenée sur la côte japonaise pour surprendre l’atmosphère calme, de fin d’hiver, d’avant la floraison des cerisiers japonais.
Elle s’imagine la beauté sereine du paysage marin qui entoure Onagawa, la baie au creux d’une vallée bordée de collines escarpées, la rumeur étouffée de la ville, son rythme, l’atmosphère moelleuse de la journée. Les images se déroulent de l’arrière-plan vers le premier plan, comme dans un film.
Puis, d’un coup, la poète inscrit ce paysage dans le temps historique avec la précision d’un horloge comme pour graver la date de la Catastrophe dans la mémoire du lecteur : vendredi, le 11 mars, 14 heures, 46 ‘, 23 secondes locales, 2011.
Avant d’évoquer le désastre, elle retourne en arrière dans son temps, se rappelle la même journée à l’autre bout du monde, en France, pendant son voyage en train le long de la côte : le ciel sombre, nuageux, en couleurs changeantes, picturales, le vol d’un goéland. Puis elle revient sur Onagawa, évoque l’océan enragé, ses eaux orageuses, les immenses vagues de vingt mètres qui ravagent la côte, engloutissant hommes et maisons.
Le rythme du poème change suivant les faits racontés, la tension monte, devient insupportable, car la catastrophe est à son comble. La mort avale les gens avant qu’ils ne puissent avertir du danger leurs proches. L’océan ressemble au monstre mythique en colère qui détruit tout, c’est l’apocalypse qui déchire le calme d’avant.
La tragédie est là : toute une ville noyée dans les eaux, un vaste cimetière marin. Sur cette toile épouvantable de la mort, la poète peint le drame tout aussi troublant d’un couple japonais : la femme est balayée du toit d’une banque par une immense vague et noyée dans l’océan. Son message de terreur est retrouvé sur son portable après le drame.
Le rythme de l’évocation ne soulage point le lecteur, car une autre voix se fait entendre, celle du survivant, le mari de la noyée qui raconte au journaliste sa douleur muette, un autre drame: solitude, absence, vide, culpabilité face à l’impuissance de sauver sa femme. Poussé à sa quête par le désespoir, il fait des plongées sous-marines, fouille le Pacifique gorgé de cadavres et finit par y trouver la mort, un Orphée à la recherche de son Eurydice.
Marilyne Bertoncini refait la toile de la tragédie à la manière d’un peintre, son pinceau a la force de faire sentir le désastre. Elle donne aux vers une cadence accélérée, l’apparence de l’haleine d’un homme qui va du calme au terrifiant et aux images des couleurs apocalyptiques :
« Au large d’immenses tourbillons
vertigineux vortex comme des puits sans fond
au cœur du Pacifique,
folles galaxies entraînant la nappe océane
et tout ce qu’elle porte
dans la béance noire
du monde.
La terre frénétique crachait le feu
Et deux vagues accouplées, têtes dressées, bouches d’ogresses
se précipitèrent sur la côte pour arracher, vies, arbres,
maisons »
La poète se fait alors la voix de la douleur muette pour évoquer la vie et la mort, la solitude et l’amour, autant de thèmes éternels. L’authentique de l’événement se mêle au poétique, la douceur à la cruauté, la sérénité de la vie à la terreur de la mort.
La rêverie poétique s’avère une poignante évocation d’un événement imprévu qui bouleverse d’un coup le destin des gens, basculés dans la tragédie. Elle fait réfléchir aux relations homme-Nature, de couple, à la vie menacée à chaque instant par la mort.
Un penchant vers les mythes et les paysages maritimes se fait sentir dans ce beau et émouvant poème épique comme d’ailleurs dans toute la poésie de Marilyne Bertoncini. Elle renvoie au mythe d’Orphée le drame du couple japonais et continue de s’interroger par le mythe sur la condition humaine, comme le remarque si bien Xavier Bordes dans sa superbe préface. Le critique y voit une parabole, « une représentation symbolique globale, planétaire, en notre siècle de désastres divers et de bouleversements climatiques. «
© Sonia Elvireanu