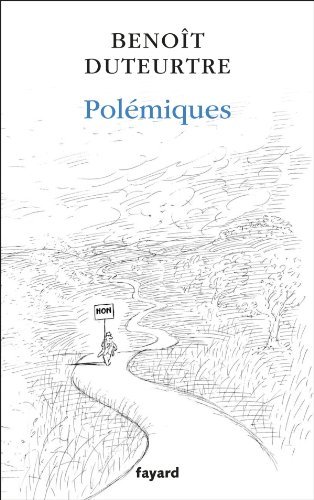RENTREE LITTERAIRE SEPTEMBRE 2013
RENTREE LITTERAIRE SEPTEMBRE 2013
-
Arnaud Cathrine – Je ne retrouve personne – éditions verticales (227 pages – 17,90€).
Arnaud Cathrine nous ouvre les portes de cette maison familiale sise à Villerville, sur la côte normande, comme celle de Bénerville pour Sweet home.
Les lieux ne sont-ils pas notre mémoire, comme la photographie de la couverture ?
Dans ce récit construit comme un journal, Aurélien fait défiler son passé, ses amitiés, sa liaison amoureuse. Son autoportrait s’esquisse en filigrane.
Seul dans cette villa, qui a subi les outrages du temps, le narrateur s’égare dans les limbes de sa mémoire. Il convoque des souvenirs éparpillés, qui affluent comme un boomerang. Mais ceux qui dominent ne sont pas les meilleurs. Il revisite son parcours professionnel et le compare à celui de son frère Cyrille ou d’Hervé (son pire ennemi au collège), l’agent immobilier, marié, qui a réussi.
On apprend qu’Aurélien a été missionné par sa famille pour assurer les visites avec l’agent immobilier, la décision étant prise de vendre ce bien, de plus en plus délaissé.
En particulier par Aurèle, qui n’y est pas revenu dans ce « lieu funeste » depuis 5 ans.
Le narrateur s’arrête sur les événements de 2007, son année « horribilis ».
Il en vient à se demander ce qu’il fait là, sinon attendre et « déposer son bilan ».
Très vite, on comprend qu’Aurélien, l’écrivain comme l’auteur, a été écartelé entre aimer ou écrire. Son choix fut de « sacrifier tout à l’écriture ». Ce qu’il revendique, c’est la paternité de ses romans et assume son refus d’enfant. Un enfant, n’est-ce pas, comme l’affirme Serge Joncour dans L’amour sans le faire, « une manière de s’inventer une suite, de se construire un avenir, en dehors de quoi il ne reste plus rien d’un couple, sinon des murs parfois ». Se retrouver dans cette maison qui a abrité son amour pour Junon plonge Aurélien dans un douloureux maelström.
Un mystère entoure Benoît, l’absent, qui fut la figure centrale d’un précédent livre du romancier. Ce qui soulève la question suivante : Peut-on piller la vie des autres ?
La révélation de Myriam, l’épouse du disparu nous éclaire sur le mal être qu’Aurèle éprouve en apprenant la fin tragique de Benoît. Elle nous livre la voix de l’absent qui n’a pas pu dire l’indicible : dire à Aurélien qu’il l’aimait. Un choc pour Aurèle.
Comme dans le roman Sweet home, Arnaud Cathrine fait sien le territoire de l’enfance et de l’adolescence, soulignant ce ballet d’alliances ou de rejets, ourdi par ses semblables. Il explore des thèmes récurrents : la perte et comment vivre avec nos fantômes, l’impossibilité d’aimer, les secrets enfouis (homosexualité), la solitude, le silence. Non seulement l’auteur autopsie les relations familiales, les rivalités (« dictature fraternelle », la « banqueroute sentimentale » des deux frères, mais il analyse aussi les liens privilégiés entre éditeur/auteur et lecteur/auteur. Il développe également un patchwork de réflexions autour du statut d’écrivain : traces laissées, notoriété, la confiance à lui accorder. Peut-on tout raconter à un écrivain ?
Comment ne pas être blessé dans son amour propre de ne pas avoir la reconnaissance de ses proches ? Mais combien gratifiante est celle d’une lectrice inconnue ? La preuve que « cette foutue incapacité à s’engager autrement que dans l’écriture » porte ses fruits. Évacuer ses blessures en les transformant en fiction est une forme de catharsis.
D’où les romans à la veine autobiographique cités : Sans elle et le Provincial.
Autre étrange coïncidence : le même destin tragique pour Benoît et Benjamin Lorca.
Parmi les références littéraires, on retrouve Duras, Calet et Perros.
Le ton du récit est véhiculé par une accumulation de mots liés à la mélancolie, « compagne attitrée » du narrateur, traversé par le cafard, la tristesse, cette solitude « faite pour durer » qui va le conduire à « l’isolement pur et simple ». L’écriture se met au diapason de cette vague de nostalgie. Plus l’écriture se fait intime, plus elle devient universelle. L’écriture pour le protagoniste devient un exorcisme, une façon de lutter contre l’oubli et l’absence. Une écriture féminine, pour Mado, cette « vieille subversive » qui lui reproche l’aspect sombre de ses romans. Arnaud Cathrine y déploie toujours cette même sensibilité et délicatesse, cette même pudeur dans la peinture des sentiments (désir refoulé) tout en sondant les fragilités de chacun, leurs blessures passées de se savoir « indésirable, indésiré » ou en soulignant leurs contradictions. Sentiment étrange pour Aurèle de « se sentir d’ici » dans son village natal et de « n’y retrouver personne ». Expression empruntée à Jean-Luc Lagarce.
Le romancier confirme son talent de portraitiste. On croise Aurélien, qui traîne « un alliage indécis », à l’allure juvénile, un « corps trop long, trop maigre ». Lui, le père : «Jamais d’affect visible ». Elle, la mère : « style Chanel sobre et chic ». Mado : « la mondaine ». Junon : « élégante », « un âge lumineux ». Benoît : « l’insondable ». Irène : « Deux fossettes soulignées. Et une voix grave, légèrement voilée ».
Des éclaircies viennent percer ce roman au ton grave. D’abord, grâce à Michelle, la fille de Junon, « l’enfant que je n’ai pas eu », confessera Aurèle. Elle irradie par sa candeur, son innocence et apporte sa touche solaire. Arnaud Cathrine livre des scènes débordantes de tendresse pendant la garde de sa « princesse », devenue pour lui « un divertissement précieux », celle qu’il drape d’un amour gratuit. Alors que cet amour sabordé pour Junon s’est mué « en une amitié particulière ». Michelle témoin de cette overdose émotionnelle qui imbibe « les yeux secs » du narrateur.
L’autre lumière provient d’Irène que le narrateur croisa dans un bar. Elle a su tatouer l’esprit du narrateur, en reconnaissant l’écrivain qu’elle lit. Telle une psychologue, elle a perçu la faille d’Aurèle et réussit à faire vibrer son cœur. Un voile pudique recouvre leur futur que l’auteur a préféré laisser à l’imagination du lecteur.
Arnaud Cathrine a choisi pour cœur de ce roman le thème de la famille, celle dont on hérite et celle que l’on se construit. Cette fois il a atteint le but auquel il aspirait : écrire « le livre impossible ». Si le roman ne fait pas rire, comme le souhaiterait Mado, il est suffisamment puissant pour susciter sympathie, compassion et pour toucher la corde sensible du lecteur et laisser son empreinte.
©Chronique de Nadine Doyen