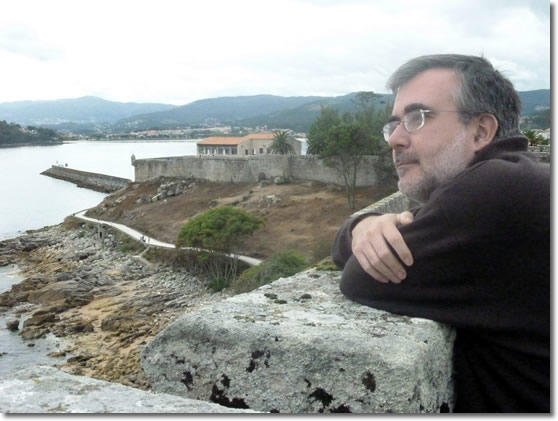-
Santiago Montobbio, LOS SOLES POR LAS NOCHES ESPARCIDOS. Editions Los Libros de la Frontera, Collection « El Bardo », 2013.
Les lecteurs de l’avant-dernier recueil de Santiago Montobbio, La poesía es un fondo de agua marina, se souviendront sans doute du cas singulier du poète espagnol : à une période créative très forte à la charnière des années 80 et 90, avait succédé un long silence de plus de 20 ans, avant que l’écriture de poèmes revienne s’imposer de manière impérative à l’auteur. Montobbio et ses éditeurs avaient alors fait le choix de rassembler un premier recueil de ses « nouveaux » poèmes, plus immédiats, plus inscrits dans la réalité d’une Barcelone toujours en mouvement, plus lumineux aussi. On sait à quel point les titres des poèmes et des recueils sont importants pour Montobbio et, très logiquement, le recueil fut mis sous le signe de la mer, qui est clarté, légèreté, mouvement.
Los soles por las noches esparcidos réunit quelques dizaines de poèmes de la même époque, mais il s’agit d’un retour à une poésie plus nocturne, plus intense, plus philosophique aussi, de ce grand métaphysicien du quotidien qu’est Santiago Montobbio. Certaines des images du recueil retrouvent la fulgurance des poèmes manifestes des années 80, comme j’espère pouvoir le montrer à travers les quelques citations qui suivent.
Une image frappante du recueil est celle du mur (je n’ai que / ce mur dans lequel je vis), mur auquel on se heurte, qui enferme et laisse toujours à l’étroit, prison qui est la métaphore de l’enveloppe corporelle (ne jamais sortir de chez soi ou, plus exactement / de l’intérieur de soi), où l’on vit caché, orphelin, solitaire, sur cette voie de garage où vont rouiller et somnoler les trains de la vie. Vivre, on le sent, est de l’ordre du survivre, parce que le parcours de l’existence exige la traversée d’un miroir ou un cheminement dans un labyrinthe. Les murs sont partout et de toutes natures.
Ce sont d’abord et avant tout les autres. Dans Los soles por las noches esparcidos, beaucoup de poèmes parlent d’amour, mais il ne s’agit pas d’un amour édulcorant ou apaisant. Il est bien plus souvent anesthésiant, et il transforme les murs en écrans, qui ne sont jamais que des murs pour voyeurs.
Un autre mur, auquel on se cogne sans cesse, est celui de la langue, instrument indispensable mais toujours inadéquat. Si on écrit, c’est évidemment pour dire l’indicible, pour révéler l’ésotérique, mais la parole fige et donc dénature la pensée, qui est toujours, comme la vie, un mouvement. Montobbio répète souvent je l’ai déjà dit, avec l’agacement de celui qui ne parvient jamais à épuiser son sujet (l’angoisse est toujours présente), ni à convaincre tout à fait les autres, qui occupent les cellules voisines, et ne peuvent jamais accéder à l’intégralité du sens du message. La nuit du titre du recueil et de nombre de ses poèmes s’impose comme allégorie de l’obscurité de la vie qu’on vit à tâtons.
Mais les nuits sont, comme l’indique le très beau titre, jonchées de soleils, multiples et modestes célébrations, voire épiphanies, du quotidien, celles qui aident à vivre et qui ouvrent l’espace : lumières, eau qui perle des fentes du néant, musique faite eau, mer qui n’a pas de terme, variation et motif qui, comme la pluie, reviennent. Pour l’écrivain, tout se confond toujours, la main qui écrit, les lieux, l’avènement du poème, les mots que l’écrivain choisit … ou qui le choisissent : Derrière chacun / de mes mots il y a toute ma vie […] Jusqu’à la façon dont je prends un café / on peut voir que j’étais le seul à pouvoir avoir écrit / mes poèmes.
Pour un écrivain aussi pudique et introspectif que Montobbio, chaque poème est un manifeste. Ce n’est pas un hasard si le tout premier s’ouvre sur le mot escribo (j’écris), si autant proclament que l’écriture est une patrie, un salut, la liberté, un mensonge même (mais cela revient au même, puisque l’art c’est cet absurde doué de sens) : De la vérité on ne revient pas. / Personne ne revient de ses terres. / La vérité est terrible, et elle nous attend. /Toujours la vie se termine en elle.
©Jean-Luc Breton