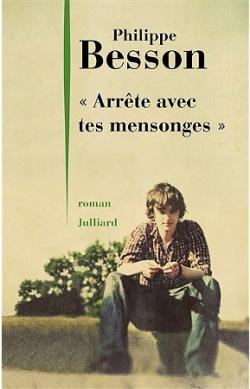Chronique de Nadine Doyen
Arthur Dreyfus, Sans Véronique, roman, nrf Gallimard (252 pages – 19,50€)
Après La correspondance indiscrète échangée avec Dominique Fernandez, Arthur Dreyfus renoue avec le fait-divers, comme pour Belle famille. C’est en Tunisie que la tragédie se déroule, inspirée par l’attentat sur une plage de Sousse (juin 2015).
En prologue, l’auteur nous indique les musiques dans lesquelles il a baigné pendant l’écriture de ce roman et suggère de le lire avec ce même fond sonore.
Le titre, puis la première phrase : « La dernière fois qu’il l’a vue vivante… » préfigurent la défection, la morsure du manque. C’est alors que le narrateur, après un travelling sur les passagers du métro, braque sa caméra sur un couple amoureux, sur le point de se dire au revoir,de se séparer, chacun prenant une direction différente.
Le lecteur sait donc qu’un destin funeste attend Véronique, mais pas son « homme ».
Le style change, beaucoup de passages en italiques (dialogues), et la ponctuation est inhabituelle. Ces phrases interminables surprennent, toutefois le lecteur n’en ressent pas la pesanteur. Qu’apprend-t-on de Véronique ? Pourquoi sa présence en Tunisie ?
On accompagne Bernard dans son retour à Thomery. On s’interroge sur sa crise de tachycardie au passage de Bois-Le-Roi, mais les lieux ne sont-ils pas mémoires ?
La vie de ce couple se déroule par flashback, depuis leur rencontre.
Quel lien affectif cultive-t-il avec Véronique ?
La solitude dominicale lui pèserait-elle à ce point pour surfer sur les sites de rencontres et ne pas hésiter à tromper sa femme ? Une disparition éphémère qui affole sa fille Alexia, avant qu’elle ne débarque lui remplir son frigo.
Arthur Dreyfus explore la relation père/fille qui ne fut pas toujours des plus amènes.
Devant l’adversité, un rapprochement spontané se dessine.
Le récit tourne au tragique. Un coup de fil fatidique et tout bascule pour Bernard. Le voilà terrassé, prostré, dans le déni, l’incompréhension. Carence d’informations.
L’auteur sait nous communiquer la commotion qui frappe ce mari, trop cabossé pour se révolter. Paroxysme de l’émotion quand les familles se retrouvent au Quai d’Orsay : le protocole, la cellule psychologique. Que dire à son entourage ?
Cette situation n’est pas sans rappeler la poignante lettre d’ Antoine Leiris, les livres de Maryse Wolinski, et plus récemment de Gabrielle Maris Victorin. Si ces êtres fracassés ont eu recours aux mots pour exorciser leur douleur, Bernard choisit une toute autre direction, bien plus dangereuse.L’auteur filme son départ
dans toute sa détermination, alors que sous le choc il avait oublié les gestes du quotidien.
« C’est avec la volupté d’une émancipation que Bernard a claqué sa portière ».
Au tiers du récit, un nouveau personnage entre en scène, même procédé d’annonce : « L’image qui frappe Seifeddine au moment de mourir, lorsque la balle tirée par un militaire ». On se doute qu’il y a un lien avec Véronique. Mais lequel ? Voici le lecteur avide de le découvrir. Par alternance, le récit oscille d’une famille à l’autre.
La famille de Seifeddine est modeste, meurtrie par la mort du fils foudroyé.
C’est sur le campus universitaire que Seifeddine tombe amoureux de « la blanche » Sophie. On suit leur relation naissante, leurs projets initiés par Sophie qui doit regagner Bruxelles, dont celui de présenter l’homme qu’elle aime à sa famille. Seifeddine s’active pour obtenir ses papiers, en vain, le visa manque. Désillusion double qui le conduit dans les bras de ses nouveaux frères, donc « dans les bras d’Allah ». Et c’est un professeur désarmé, désemparé qui prend conscience de la dérive de son élève si « brillant et inventif ». N’a-t-il pas détruit son outil de travail dans un accès de colère ?
Et à nouveau la narrateur cameraman zoome sur un couple se disant adieu, des baisers à la Depardon, qui choquent la génération âgée. Se reverront-ils ?
Le second chapitre est centré sur Seifeddine et Bernard, récit en flashback, dense.
On plonge dans le cheminement des pensées des deux protagonistes. Le rythme s’accélère. On perçoit le glissement, la dérive de celui qui faisait la fierté du père.
On assiste à l’engagement du « soldat d’ Allah », futur « martyr» ; à la confrontation avec son père, dépassé, impuissant ; à son entraînement intensif. Le voici sous les « ordres de Dieu », prêt pour cette « mission sacrée ». Instrumentalisé, son mal-être va se transformer en haine des autres, des mécréants, des impurs.
La scène du carnage est décrite avec un tel réalisme (onomatopées des tirs) qu’ elle peut raviver chez les âmes sensibles l’horreur des événements successifs que les chaînes d’info ont moulinés. D’autant que le narrateur ne nous épargne pas le côté « gore ».
Arthur Dreyfus montre une parfaite connaissance de ce fanatisme religieux, des idéologies, de méthodes d’intoxication, d’embrigadement et en rend compte avec moult détails. Il rend palpable cette menace constante dans le chaos du monde.
Dans ce roman, l’auteur explore la relation du couple fusionnel où l’enfant n’a pas de place. Bernard a-t-il pensé à Alicia, quand mû par ce besoin de vengeance, il part ?
Ses tribulations, « éléphantesques » nous réservent des surprises, nous tiennent en haleine. Réussira-t-il à venger Véronique, à en tuer « au moins un » ?
Certaines situations nous font même sourire (dans l’avion, ou dans le taxi
d’Antioche), l’humour du narrateur est là en filigrane. Celui-ci adopte un ton de reporter de guerre quand il décrit le délabrement d’Alep et pointe « la folie destructrice des hommes ». Tableau insoutenable de cet « embrouillamini des humains » contrastant avec ce chat « paisible, souverain » ronronnant.
Le romancier aborde le problème de la sécurité depuis les menaces .
Il souligne l’impact des réseaux délivrant leur propagande morbide, glaçante. Certains termes propres à cette culture : « kahba, kouffar, kafir, kamis » ou à l’ histoire « une ville irrédente » peuvent dérouter le lecteur qui aura à coeur de chercher leurs sens.
Arthur Dreyfus nous touche d’autant plus que la succession d’actes terroristes nous a profondément horrifiés, crucifiés, déclenchant ces scènes bouleversantes de recueillement collectif à grande échelle devant la barbarie.
Il dissèque, comme dans Belle famille, la part de monstruosité contenue dans ses deux protagonistes. Il évoque le statut de la femme : selon les islamistes dénuder ce corps tabou sur les plages, c’est insulter la culture musulmane, commettre un blasphème.
Il questionne les prémices de cette odieuse tragédie, avec une maîtrise magistrale.
Dans ce roman,Arthur Dreyfus livre un vibrant témoignage d’amour fou à travers Bernard : « Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé», aborde la façon d’affronter la disparition de l’être aimé, tant la défection est incommensurable. Comment vivre sans elle ? Cet amour éternel, hors norme, plus fort que la mort, Bernard n’a-t-il pas voulu l’immortaliser par ces figurines « main dans la main », soudées sur un même socle ? Le roman se clôt sur cette image apaisée, pétrie de tendresse, d’un couple indéboulonnable, « valsant en paix », peut-être sur une musique de La La Land ou celle d’« En attendant Bogangles », à l’insu d’ Alexia.
Ce brillant écrivain, multifacette, signe un roman prégnant, éprouvant qui secoue le lecteur, serre la gorge. Si la culture de Vincent,le doctorant croisé par Bernard dans l’avion pour Antioche, « force le respect », celle d’Arthur Dreyfus force l’admiration. Mais « il n’y a pas de ticket de rationnement » dans ce domaine !