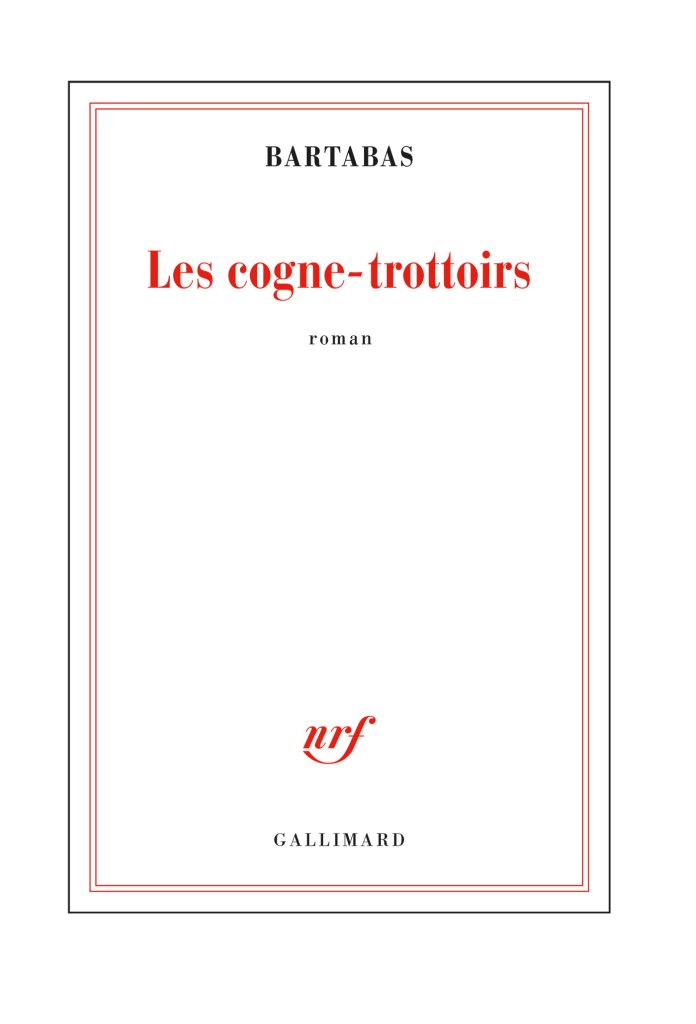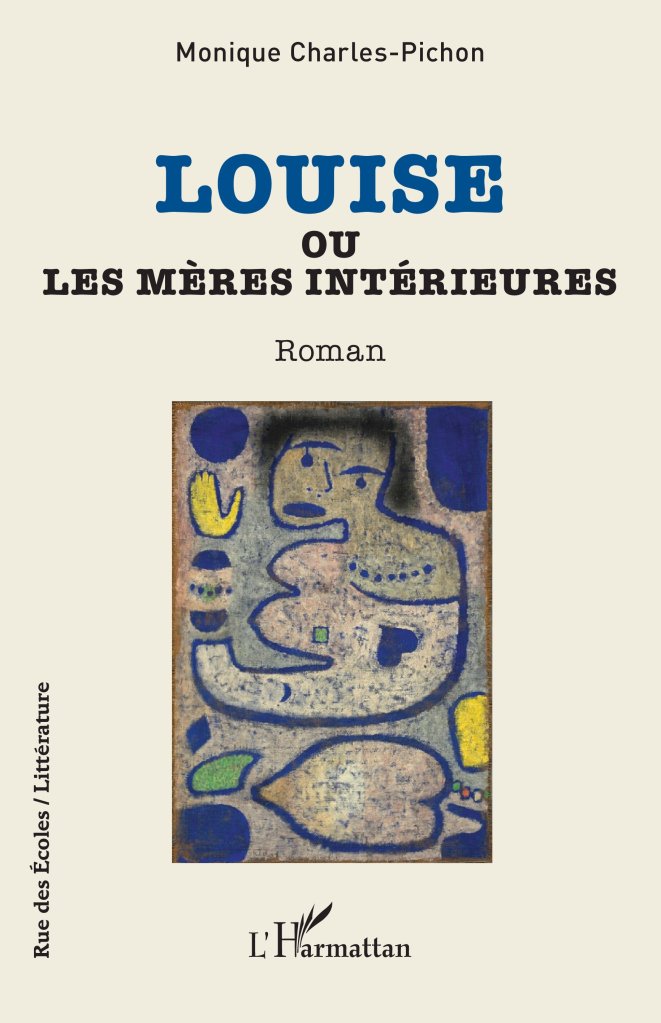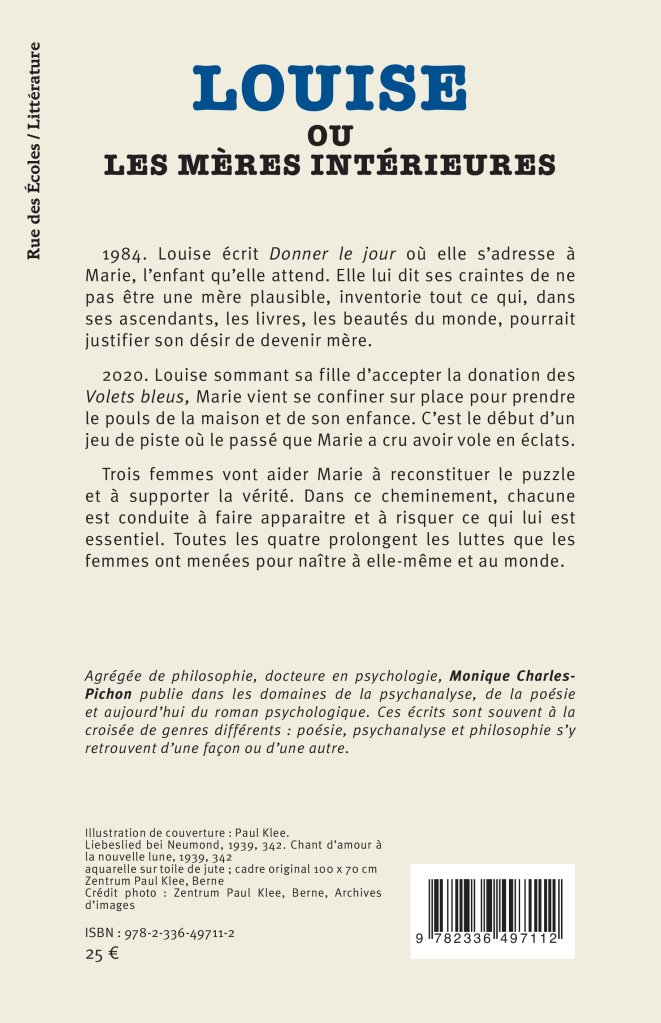Une chronique de Paule Duquesnoy
Bartabas, Les cogne-trottoirs, roman, Gallimard, collection Blanche, 288 pages, janvier 2026, 21€.
Violent, sensible, exubérant, torride ! Généreux, réconfortant, gorgé d’espérance, car dans de ce livre traversé par l’odeur du sang, l’adversité – c’est peu dire – la souffrance jusqu’à l’insupportable, est surmontée, magnifiée, courageusement, joyeusement – il s’agit de la vraie joie, pas d’une joie de pacotille -, fraternellement, car ces cabossés de l’existence sont solidaires, en union de solitude.
L’âne Balthazar, s’il n’écrit pas ses mémoires comme Cadichon, n’en pense pas moins, sait entendre ce qui n’est pas dit, et braire à bon escient. C’est le sage de l’histoire, le philosophe bienveillant. Il « apprend (à Marie) à fermer les yeux pour mieux entendre le récit de la pluie et accepter la machinerie de l’existence ». Est-ce le cousin de Balthazar, celui du film de Robert Bresson, « Au hasard Baltazar » ? En tout cas il se range parmi les ânes pour lesquels nous nous prenons d’affection : outre Cadichon, l’âne-Culotte d’Henri Bosco, Modestine, l’ânesse de Stevenson, sans oublier Trotro l’ami des enfants.
Il est entouré d’hommes et de femmes profondément attachants, brûlés jusqu’à la moëlle – en eux flambe le feu sacré – qui suscitent notre admiration, parce qu’ils avancent, s’abreuvant à leurs larmes, jusqu’au bout de l’idée qu’ils se font d’eux-mêmes, d’autant plus vivants qu’ils donnent réalité à leur rêve.
Christian, l’Ange blanc, le funambule de Jean Genêt, avance sur son fil, le sexe dressé en guise de balancier. « Nu, il taille l’air de ses bras et trace un chemin secret que lui seul semble voir ». Le corps s’élève. La place. Les tours de la cathédrale. Spiritualité du corps.
Le langage n’est jamais vulgaire car les mots sont justes. On pisse, on pleure, on saigne, c’est simplement la réalité des vivants. Les moments où la poésie vous prend aux tripes n’en sont que plus « précieux ». La poésie populaire est chantée dans les bas-fonds par des analphabètes anonymes » pourrait être un slogan de Léo Ferré, clamé par son poète Bipède volupteur de lyre / Epoux châtré de Polymnie/ Vérolé de lune à confire/ Grand-Duc bouillon des librairies/ Maroufle à pendre à l’hexamètre/ Voyou décliné chez les Grecs/ Albatros à chaîne et à guêtres/ Cigale qui claque du bec (Poètes vos papiers). De même : « Vos théâtres ne sont que des maisons closes, leurs toits sont des couvre-ciel ! On y pratique la contemplation béate, à distance…Un théâtre où le public s’identifie à des spectres ! Des spectres professionnels !»
Baltazar tourne sa queue sept fois avant de braire, il préfère penser et aimer. Si la muette (l’angelotte) parle avec ses mains, et son corps, les livres lui ouvrent un passage vers une autre vie, ils parlent à son silence.
La langue superbe de Bartabas fixe des moments intenses : « Dans l’euphorie du soir, comme des apôtres fatigués, les yeux brûlés de rimmel, ils lèvent leur verre à la santé de l’angelotte. Ils savent que nul n’apaisera jamais le sang qui les calcine ; cette nuit, le vin aidant, ils ne veulent être que tendresse et douceur. » Nous avons sous nos yeux ce tableau – qu’aurait pu peindre Le Caravage – nimbant les saltimbanques, grandioses, d’une clarté crépusculaire, et nous sommes remués.
La naissance, la mort, les deux bouts de l’existence, touchent au Mystère. Entre, On souffre pour ne pas mourir. La vie, la mort, celle des hommes, des femmes, celle de l’animal. Au-delà encore la vie. Au centre, le désir, un désir fou, irrépressible qui se pose où il peut. Chacun garde une dignité, même dans l’abjection.
L’Amiral, au passé énigmatique, au rut fougueux, à la verve gouailleuse, qui porte son navire tatoué sur son torse, et crache le feu, lui-même pétri de poésie et de peinture, a su déceler en chacun de ses baladin son meilleur : la force chez le Cyclope, le goût des sentences et des formules chez René le Baron, ancien professeur de Lettres et de Philosophie qui devient l’Érudit, la tendresse offerte chez l’Ange Gabriel à la vie chaotique, qui a gardé pour toujours l’envie de pleurer, l’espérance chez le Père Joly, prêtre défroqué, qui ne cesse de croire dur comme fer à la Rédemption, et nous entraîne à sa suite, le chant chez Madame Lili, la Castafiore, qui a échappé de peu à la rafle du Vel d’Hiv et reporte son affection sur Vagabond, son chat « Une vraie artiste ne renonce jamais, jamais elle ne baisse pavillon. ». Tous avaient un avenir social et professionnel tracé, qu’une chiquenaude a fait basculer, donnant une autre impulsion à leur destinée qui s’accomplit malgré tout, devenant mission. L’Amiral les porte, les transporte sur l’élan de sa voix. Et il a besoin de ce rapport à l’autre pour se sentir lui-même vivant.
Se joignent à eux Gaspard, l’homme aux rats, ancien vétérinaire, qui a tout perdu en jouant aux courses, et s’est mis à fréquenter les rats ; Clovis Trouille, le comptable pétomane, qui, les soirs du week-end, mène une vie parallèle ; Abdelkader le circassien, acrobate hors pair, que l’Amiral appelle « Le Petit Prince des Trompe-la-Mort », Andrea, l’illusionniste. Il y a aussi la fille aux oiseaux, dite la Mésange, qui « charme » ses volatiles, et Cascabelle, la blanche Cascabelle, percée jusqu’au fond de ses entrailles, qui se cherche un groupe auquel se joindre, les féministes, les muettes, et trouve une aile sous laquelle se reposer.
Un grand-duc blessé les unit, car, outre l’âne Baltazar, les animaux entretiennent une relation mystique avec les humains. Cascatelle entre dans la tête de l’oiseau, ouvrant « grand les yeux alors que l’oiseau abaisse enfin ses paupières en relâchant la pression de ses serres. »
Bartabas peint le portrait de chacun des Baladins, hissant les formes et les couleurs, tableaux qui s’imposent à nos yeux, et à nos cœurs. Car l’essentiel n’est-ce pas d’aimer ?
Les saltimbanques se déploient dans les rues, sur les places de Paris, boulevard Saint-Germain, devant l’église, au jardin des Tuileries, traversent le Pont-Neuf. Une soirée étrange et baroque à l’Hôtel Meurice, où le spectacle se joue dans la salle. Les bars, le parc des Buttes-Chaumont. On va à l’église parfois, à la cathédrale, celle de Reims, aux anges de pierre. Puis c’est Lyon, Avignon.
Bartabas nous immerge dans ce monde de baladins qu’il connait si bien, Célébration des corps en ébullition, des cœurs brûlant à fleur de peau. Assistez chez vous au nouveau spectacle de Bartabas ! S’il porte en lui quelque chose de l’Amiral, le révélateur de talents, c’est d’abord lui le metteur en scène, le monteur en selle de l’histoire initiatique de Cascabelle et de son âne, qui rejoignent ainsi la grande famille Zingaro.
Dans le temps où s’enchâsse la lecture de ce livre, je découvre dans le film Plein Pays, présenté par son réalisateur Antoine Boudet », Jean-Marie Massou, un personnage « extraordinaire » , artiste de l’art brut, qui vécut dans le Lot, où, seul avec son tracteur, il a creusé en profondeur de longs souterrains, orné des pierres, créé des musiques étranges, qui attendait les extra-terrestres, un « sauvage » génial qui aurait très bien pu, – et même dû dans la logique des choses – sans diverses interventions, passer son existence en hôpital psychiatrique. Mais cela est un autre sujet. Quoique…..