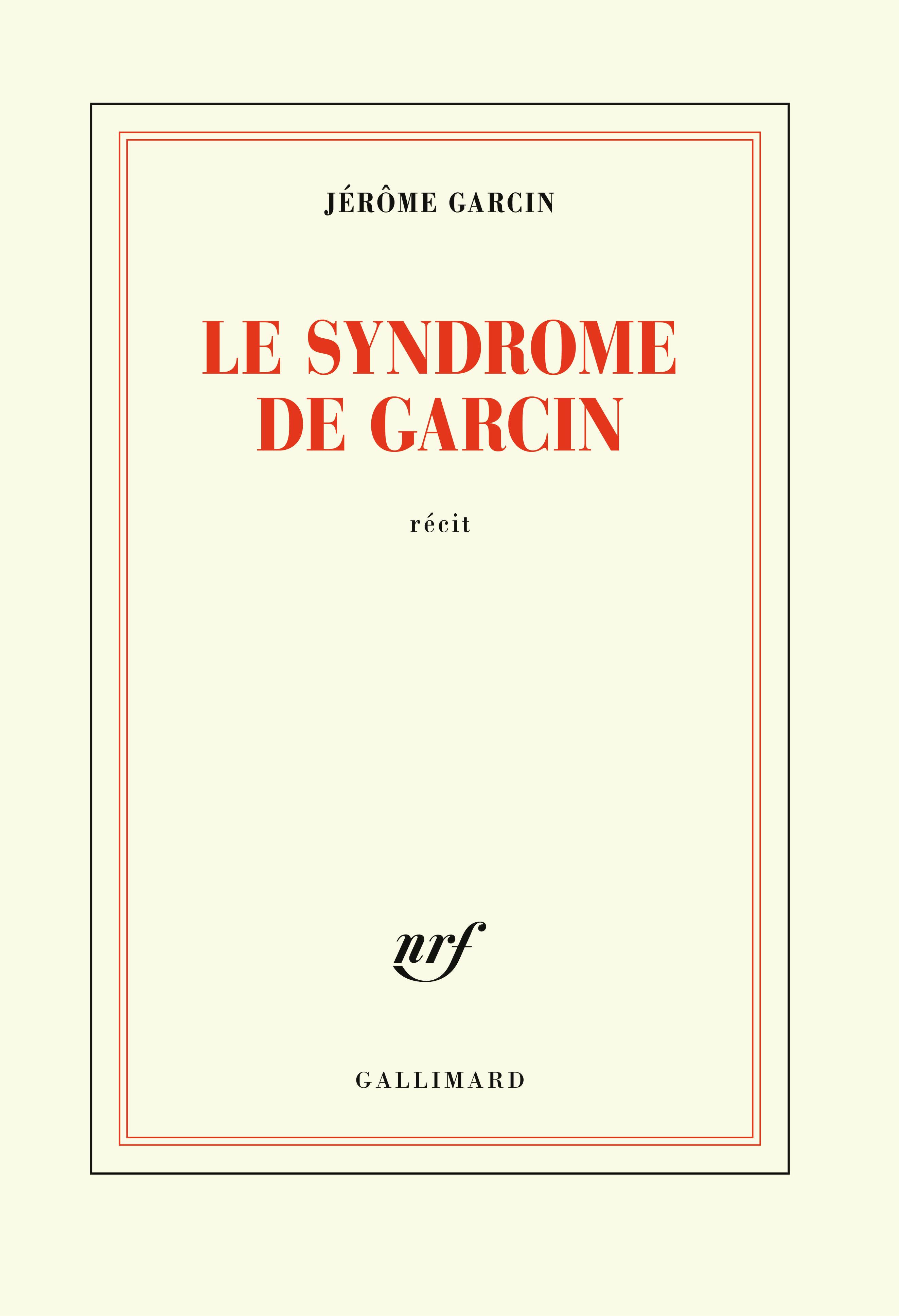Chronique de Nadine Doyen

Claire Fourier, Radieuse – Une croisière en Adriatique, récit, Éditions de la Différence (224 pages – 17€)
Besoin de changer d’air ? De s’émerveiller ? Claire Fourier propose à son lecteur d’embarquer avec elle. Comment ne pas succomber à une telle invitation au voyage !
Mais voyage-t-on pour changer d’air ou « pour le retrouver dans un cadre différent » ?
Claire Fourier n’a pas à se poser la question, puisqu’elle est la lauréate du Prix de la ville de Vannes pour son talent. Mais, encore habitée par son expérience de solitude et de méditation (qu’elle raconte dans « Dieu m’étonnera toujours »), la narratrice redoute cette croisière en Adriatique, qui n’est pas sa destination rêvée et où on ne peut éviter la promiscuité. Elle, « une femme du Nord », c’est la Baltique qui l’aimante, Rügen, ne serait-ce que pour se croire dans un tableau de Caspar David Friedrich et retrouver son héros « Hermann » des Silences de la guerre (livre qui lui a valu la croisière) Ce qui explique que son départ soit teinté de déception et sa réaction un rien provocatrice : souhaiter le crash de l’avion.
Claire Fourier anticipe les escales culturelles où les hordes de touristes convergeront tous vers les mêmes sites touristiques. Elle a bien l’intention de fausser parfois compagnie au groupe pour se fondre aux autochtones et mieux observer « les gens ». « Les gens » que Raymond Depardon capte en photos, Claire Fourier les approche, leur parle, les questionne et en brosse des portraits fidèles, pittoresques. Elle se révèle une subtile portraitiste de ce microcosme que forme la meute des croisiéristes. Elle radiographie ce melting-pot sans complaisance.
Rien ne lui échappe, visages, propos, silhouettes, postures…
La narration, datée comme un journal de bord, débute au 15 août, Jour J-1.
Le 16 août, elle s’envole avec son mari pour Venise, port d’embarquement.
Celui-ci va donc subir la mauvaise humeur de Radieuse, prénom temporaire qu’il lui attribue par ironie, le temps de la croisière. Car comme tous les Français, Radieuse « râle » et ne peut s’empêcher de comparer la Chartreuse où elle se retira un été et ce bateau, « puce des mers » où il faut s’adapter à la promiscuité.
La croisière est ponctuée de six escales, le long de la côte dalmate. Radieuse nous fait partager la vie à bord (repas, conférences, danses, spectacles, farniente, soins du corps) et participer à une pléthore de visites. Elle distille un rappel historique très détaillé pour chacun des lieux, souvent associé à un écrivain (le Monténégro/Loti). Elle mitraille en mots les paysages qui défilent, Split, « ahurissant patchwork », puis Korčula, « la ville où serait né Marco Polo ». On apprend que Dubrovnik, « la perle de l’Adriatique », doit son nom aux chênes qui couvraient autrefois la montagne. Hvar est « un petit Saint-Tropez ».
La narration est construite en mettant en exergue les contrastes.
Les merveilles des musées, la richesse des églises, des tableaux de Titien, d’une Vierge noire qui la « cloue sur un banc ». Le drapé d’un « manteau bleu doublé de vert, étoiles brodées » convoque le « génial couturier » Galliano pour Radieuse.
Une Crucifixion lui rappelle le retable de Grünewald, une Piéta la plonge dans l’extase, et, à côté, « la laideur de la foule », « ces corps flasques, adipeux ».
Gros plan sur la guide, Iljana, « Snoopy », qui porte un tee-shirt à l’effigie du Beagle de Charlie Brown, un « canon à mots », « une oriflamme », une « comtesse vénitienne » qui fascine Radieuse au point d’en brosser un portrait dithyrambique. Puis gros plan sur « une jeune trisomique » hurlant ou la vendeuse de lavande.
Claire Fourier dépeint de magnifiques variations de la mer, de jour, au soleil couchant, de nuit, offrant une gamme de couleurs (cuivre rouge, pourpre). Radieuse, de son balcon, « en peignoir blanc », s’abîme dans la contemplation des « reflets lunaires », donne un « baiser aux étoiles », quand elle ne lit pas. Que lit-elle ? Thomas Mann, Michaux.
Claire Fourier entrecoupe son récit par des évocations de Moby Dick
de Melville, et le ponctue ici et là de citations de Goethe, Mallarmé, Yeats, Montherlant, Camus.
En « glaneuse de Dieu », « panthéiste », « mystique », elle apostrophe les cieux, développe une réflexion philosophique sur Dieu, sur la vie, le bonheur et le voyage. Elle nous livre de multiples interrogations, dont l’une résume les autres :
« Peut-on regarder quelqu’un avec insistance sans se mettre à l’aimer ? »
Elle glisse une parenthèse sur les liens dans un couple, ne cachant l’érosion de l’amour : « Parler à mon compagnon de quarante ans revient à parler toute seule. »
Un mot revient souvent : humain. Un autre mot résonne : « Vide », l’auteur soulignant ainsi « l’errance des masses humaines ». Des mots étrangers émaillent les conversations ou descriptions. D’un pays à l’autre, Radieuse compare les sonorités. « La langue italienne est une berceuse ». À Dubrovnik, « nom raboteux, malsonnant », « rien de doux, ni d’avenant », « la langue croate, un jeu d’osselets ».
On perçoit un air de Schubert, « le cri rauque d’un oiseau de mer », un orchestre qui répète, une chorale, « le chuintement de l’eau qui grignote les quais », « Tic !Tac! C’est le temps que fend le navire ».
Tous nos sens sont mis en éveil, comme Radieuse qui veut « tout caresser ».
À Perast, décrit(e) par Larbaud « comme une petite boîte de bois peint » nous parvient « un parfum de rose venu on ne sait d’où ». Senteurs, couleurs du marché de Hvar ou des loups en devantures à Venise. La croisiériste Radieuse arrive à nous faire percevoir le tangage, entendre les vagues qui claquent, la mer qui « jappe ». On vogue, danse, file ou s’attarde. À bord, on chante, caquette, on rit fort. « Les matelots briquent ». La « pouliche » Iljana » virevolte, s’amuse, fait de l’esprit, fédère « son troupeau » et le séduit. La narratrice déambule, arpente les ruelles, « furète », Pierre mitraille avec son appareil photo.
La variété du vocabulaire donne un rythme alerte, fougueux, à
l’image de Radieuse.
Claire Fourier déploie un style singulier, avec des phrases elliptiques : « M’est avis que… », « Me plaît l’homme… », apportant de la nervosité. Elle recourt à deux niveaux de langue : relâché (« Laisse béton », « Bon sang », « Cela me casse »), châtié (« les écailles d’or frétillent sur l’eau de jade », « La mer fourmille de confettis dorés »). On retrouve avec joie sa plume qui combine poésie, érudition, érotisme, sensualité, autodérision et humour. Elle jongle avec les mots : « Ne jasons pas, jazzons ! ».
On entend la voix de l’auteur qui dénonce ce tourisme de masse et fuit « cette ménagerie humaine », ce « troupeau burlesque ». Mais n’aspirent-ils pas tous à la même quête : « changer d’air », leitmotiv du récit ? Revenue à Venise, Radieuse, « atrabilaire », peste contre ces « bétaillères, ces « navires à huit étages qui déversent leur « zoo humain » et défigurent « le port de la Sérénissime ».
Pierre invite Radieuse à lui confier son ressenti avant de quitter « Venise-la-mélodieuse », le 23 août. Elle s’interroge sur l’art de voyager : n’est-ce-pas « le retour qui donne un sens au voyage » ? N’avons-nous pas tous constaté aussi qu’« il faut en passer par le présent insatisfaisant pour arriver au souvenir réjouissant » ?
Vive la « revenance » ! On retrouve Claire Fourier, coquette, et qui préfère « porter la beauté sur elle » plutôt que la voir sous vitrine, au musée. Claire Fourier nous aurait-elle convertis au hygge ? (1)
Radieux, ravi, ressourcé, revigoré est ainsi le lecteur qui, comme Ulysse, a fait un voyage enrichissant, alliant culture, spiritualité et fantaisie grâce à la rayonnante Radieuse.
« Il n’est de voyage que de marche vers les hommes », nous dit finalement Radieuse, après avoir au long de ses pages noué au petit point, ou au point de croix, observation, contemplation et réflexion.
Futurs lecteurs, autorisez-vous à larguer les amarres.
©Nadine Doyen
(1) : Hugge : une nouvelle façon de penser le bonheur, venue du Danemark, prônant les plaisirs simples, un mode de vie rassurant, qui a