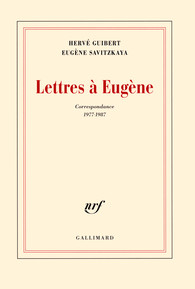-
Vassilis Alexakis – Le sandwich – Stock (188 pages -18,50€).
Ce premier roman qui vient d’être réédité, Vassilis Alexakis y faisait allusion dans L’enfant grec, avouant qu’il ne se souvenait plus du rôle de Gaspard. Une façon habile d’aiguiser notre curiosité. Qui est ce moine Gaspard qui a retenu le narrateur prisonnier dans un puits ? Pourquoi ? La conversation perçue intrigue. Qui le sauva ?
Qui a kidnappé sa femme Françoise ? Parviendra-t-il à la retrouver ?
L’avertissement, en ouverture, du livre nous assène une réalité sordide, le destin tout tracé de la femme du protagoniste. Si Claire Fourier qui affirme dans un titre de roman : « Je veux tuer mon mari » ne passe pas à l’acte, il n’en est donc pas de même pour le protagoniste de ce roman.
Armez-vous de patience, lecteurs, car on peut y être déboussolé. Les réponses aux multiples interrogations, l’auteur nous les distille progressivement. D’ailleurs il apostrophe souvent son lecteur, le met dans la confidence, s’évertue à lui démontrer la finitude des hommes, étayant ses propos d’exemples, parfois puisés dans des contes.
Le narrateur, une fois son identité déclinée, revisite sa rencontre avec Françoise, revisite sa vie de jeune marié, parsemée de péripéties et livre des bribes plus privées. Il explore leur couple, ses hauts et bas : « On s’y bagarre, on y rit, on y pleure, on s’aime quoi ! ». Il en arrive à perdre ses convictions sur le mariage. Il compare « l’amour à un bateau », donc avec des tempêtes à traverser. Il aborde des thèmes liés : l’infidélité, la jalousie, la violence dans le couple et ses conséquences (séparation, vengeance, crime). Françoise, cette femme « chérie » devient dans sa bouche « la salope » et le narrateur nous prend à témoin de ce délitement des sentiments jusqu’au désamour et la tragédie inéluctable.
Vassilis Alexakis, campant son récit à Paris, pense à ses lecteurs non parisiens, et brosse un portrait subliminal du quartier latin, des lieux mythiques ou qui lui sont familiers. Il nous convie à arpenter avec lui les rues parisiennes.
Si vous voulez gagner l’estime de l’auteur, retenez autre chose que la superficie de la place de la Concorde qui est pour lui « sans grande valeur » car « on peut aussi bien » la « trouver ailleurs ».
On devine en germe son attirance pour les livres et l’écriture.
D’ailleurs le narrateur ne congédie-t-il pas Pipiou et toute sa bande (le dindon, l’écureuil gourmand, le poulain, la poule…, une vraie arche de Noé) pour commettre « ce bouquin » ? Vassilis Alexakis reconnaît avoir plus de tendresse pour ses héros d’enfance de L’enfant grec que pour ceux de son premier roman qu’il aurait eu tendance à tourner en dérision.
Le sandwich mêle en effet dialogues, digressions, extraits de contes, situations foutraques, absurdes. Le récit est construit comme un roman policier, l’intrigue y est relatée à rebours, de quoi y perdre son latin ! (ou son grec). Vassilis Alexakis justifie ce mélange des genres afin de « s’affranchir de ses lectures » de jeunesse et de se libérer de son overdose émotionnelle, pour pouvoir écrire.
L’auteur sait tenir en haleine son lecteur, le prend même à témoin. Il fait monter la tension crescendo : « On ne peut pas dire que je ne l’ai pas prévenue » ou « Un accident est vite arrivé ». Il distille les indices prémonitoires jusqu’à l’ultime : « Le jour du drame vient de se lever ». Le narrateur, sous l’effet de la drogue et de l’alcool, devient un monstre. Ce qui soulève la question de la responsabilité de « l’époux sadique », plus sauvage qu’un loup. On songe à cet article 122.1 stipulant que « n’est pas responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». On est loin des injonctions : « Sois bon », « Fais le bien » citées dans certaines pages. Il souligne également l’influence du passé dans l’acte criminel. La fêlure ne viendrait-elle pas d’une famille désunie, d’une enfance malheureuse ?
Quant à l’épilogue, âmes sensibles s’abstenir, car Vassilis Alexakis ne nous épargne aucun détail. Il relate dans une plume gore, sanguinolente les mutilations, dépeçant ce corps qui l’avait trahi. Cet acharnement interminable, innommable n’est pas plus glauque, ni plus insoutenable que certains faits divers et vient confirmer que les histoires d’amour finissent mal en général. Le contraste avec la sérénité affichée au café où le criminel « se repaît » d’un sandwich est saisissant.
Les fidèles lecteurs de l’auteur pourront constater l’évolution de son écriture en 40 ans. La Grèce n’y est pas omniprésente comme dans les derniers romans, à la veine autobiographique. Mais l’écriture reste fondée sur l’humour et le dialogue.
Vassilis Alexakis a réalisé son rêve d’enfance : « devenir menteur » et conteur pour le bonheur de ses aficionados.
©Chronique de Nadine DOYEN