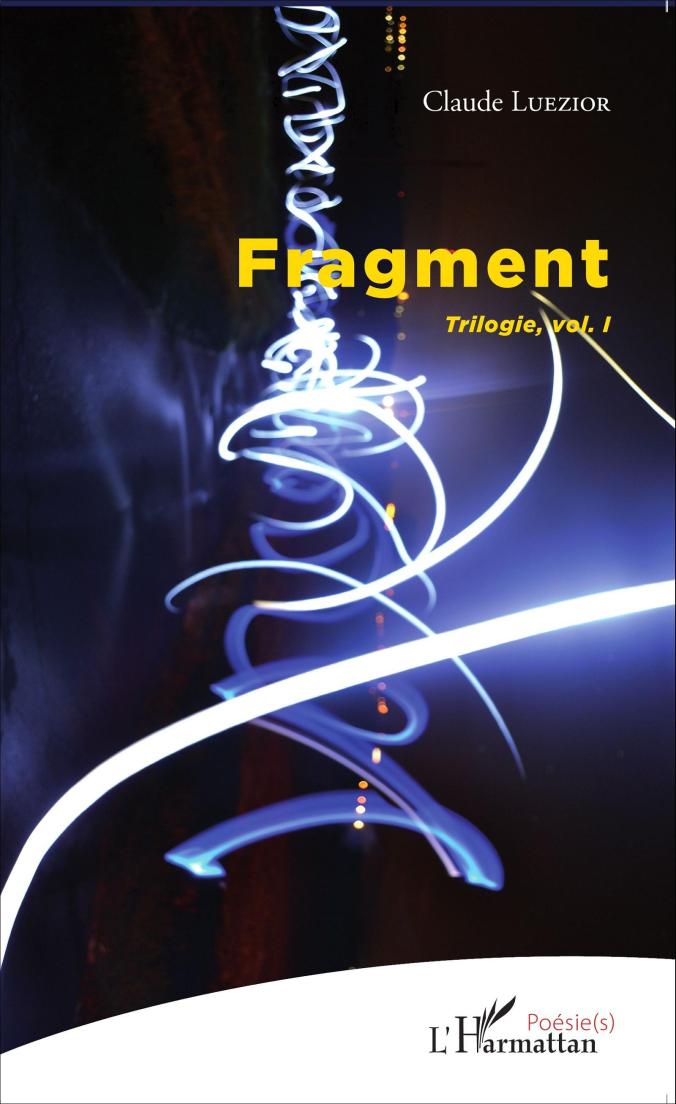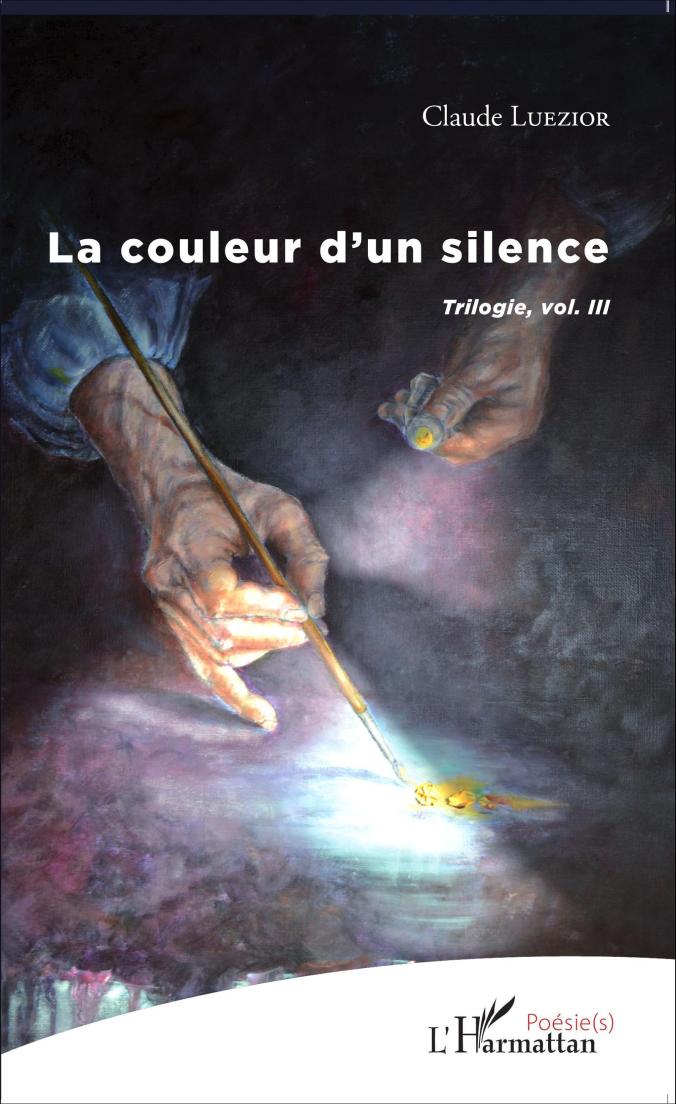Chronique de Nicole Hardouin
TRILOGIE de CLAUDE LUEZIOR
DANS LA VOIE LACTÉE DU DIRE
Si l’on se souvient de ce qu’écrivait Ernest Psichari, petit-fils de Renan, le silence est un peu de ciel descendu sur la terre, on peut penser que le poète CLAUDE LUEZIOR solfie la musique des sphères pour dire ses mots-nuages, ses mots-silences.
Pour atteindre ce ciel, il pose son échelle de Jacob contre les parois d’un puits inversé, monte et descend, casse les barreaux de l’aube. Sous sa plume, entre souffle et soufre, ailes et cendres, volupté et humour, naissent des oiseaux qui prennent leur envol dans des syllabes de rosée. Théâtre, tragédie dans la voie lactée du dire.
Si créer c’est collaborer avec les dieux, CLAUDE LUEZIOR vit avec le Daïmon cher à Socrate. Il aiguise le chant de sa pensée au plus près de l‘image, tantôt noire comme l’or du démon qui inscrit le signe d’Hérode / sur ma porte, tantôt bleue comme les premiers matins qui s’étoilent, pensées / au firmament / de tes yeux. Ainsi roule la pierre de ses lignes sur la marelle de sa materia prima.
Ses mots ont le goût d’un vagabondage : il y a toujours un puits où l’on attend une femme ou le sens du recueillement : la cathédrale étire / ses colonnes et arcatures / sur une verticalité / nervurée de prières. Entre Éros et Thanatos, le poète coule sa liturgie / celle où une audace / enfin se liquéfie. La psyché de l’écrivain peut implorer, sur les cimes d’un glacier : écoutez, je vous prie / ma supplique d’écorché ; plus loin, la voilà qui s’agenouille au fond du gouffre ou d’un ciel en gésine pour détacher l’hostie du ciboire / et la parole de nos déserts.
CLAUDE LUEZIOR marie le sacré au profane, le piment des petits riens (boire l’hydromel / de ces riens sans importance / qui signent la vie) au gond plus grave du quotidien en interrogeant la lumière qui s’encalmine sur l’ombre des étoiles. On partage ses lignes d’horizon, ses éclaboussures d’ombres. Ses mots prennent alors le reflet de celui qui lit : osmose des mystères.
CLAUDE LUEZIOR peaufine la couleur d’un silence, écrit en fragment sur l’arc solaire et, d’un seul geste, ouvre les abois du crépuscule. Dans cette trilogie, le silence et la nostalgie (ivre d’un mal étrange / l’ombre chancela / on entendit une masse / mon corps m’avait trahi) sont davantage présents que dans ses précédents recueils, sans pour autant, ici là, retrouver l’espoir : ensemencer le sillon / quand chuchote la glèbe. L’auteur griffe ses miroirs, nage dans ses marées tumultueuses et nous renvoie, avec un rare sens du dire et de l’image, les échos intérieurs de sa mythologie intime.
Il déplie avec un art consommé l’éventail de ses émois, pensées et désirs. Ce, dans une crémation du dire où il entraîne le lecteur. On ne peut que suivre le poète sur les chemins escarpés de ses songes, sauter dans sa barque qui n’est pas celle de Charron mais plutôt celle du nautonier qui sait hisser les voiles de son illimité.
Claude LUEZIOR, Trilogie : Fragment, D’un seul geste, La couleur d’un silence. Collection Poésie(s). Éditions L’Harmattan, Paris, 2015.
©Nicole Hardouin