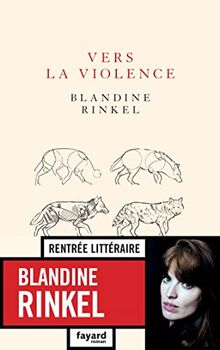Une chronique de Nadine Doyen

Hélène Honnorat, Sois sage, ô mon bagage, Editions Yovana ( 158 pages – 25€) Version illustrée par Luis Hurtado, septembre 2022
Hélène Honnorat a été bien inspirée de proposer une version illustrée de son ouvrage paru précédemment en 2020, dont le titre est inspiré par Baudelaire. En ouvrant cet opus, vous risquez d’être tenté de prendre connaissance des illustrations très colorées de l’artiste Luis Hurtado qui pimentent le livre. Ceux qui fréquentent la gare Saint-Lazare reconnaîtront la sculpture d’Arman. Sur le pont-couvercle d’un bateau, Albert Londres note que par la magie des étiquettes les valises révèlent leur provenance. On est intrigué par cette aviatrice américaine Amelia Earhart, penchée hors de la carlingue d’un avion, qui bombarde un paquebot à coups d’oranges. Sorte de signal MayDay !
On s’émerveille devant la capacité du sac fourre-tout en tapisserie de l’iconique Mary Poppins, au mot magique, « superlong » ! La nurse y range un ensemble hétéroclite : une patère pour son chapeau, un miroir, une plante, un disgracieux lampadaire, des chaussures… Certaines illustrations sont très suggestives, d’autres aiguisent la curiosité et invitent à se plonger dans la lecture pour en appréhender le sens.
L’auteure se livre donc à un vaste panorama des façons de voyager selon les époques sous le signe de Mercure, le dieu des voyageurs. Certains voyagent léger, d’autres ont eu besoin de porteurs en grand nombre ! Allez-vous vous reconnaître en Sisyphe ou Icare ? L’auteure oppose « les minimalistes » aux « maximalistes ».
On découvre les exigences de la reine Victoria qui avait besoin de son propre lit lors de ses déplacements ! ( ce qui mobilisait « une suite de soixante à cent personnes »!) L’écrivaine a consulté maintes sources ( voir l’ample bibliographie) et nous fait croiser des voyageurs, des aventuriers des plus éclectiques ou excentriques. Elle décrypte le sens des mots, leurs origines : bagage, « du vieux français bagues », « laie », qui a donné la layette et renvoyait à un coffret servant de « caisse d’emballage ».
Elle a articulé son inventaire en 7 parties dont le chapitre « partir est une fête » qui plonge le lecteur dans l’euphorie des départs et « la volupté des premiers préparatifs » ! Elle balaye toutes les sortes de contenant et livre sa vision de ce mystérieux objet qu’est le bagage : « Acolyte festif, vacancier complice de fugues amoureuses, de passions interdites, ou misérable ustensile, pesant, signe de rupture, d’exode, de guerre… ». Le bagage, sorte de « foyer », de « double » ! Pour Hélène Honnorat, les bagages sont « des objets aussi fantastiques que les boîtes musiciennes, les lanternes magiques ou la lampe d’Aladin. »
Les bagages se sont adaptés aux modes vestimentaires ! Pas facile de transporter les crinolines, les chapeaux ! Hélène Honnorat s’interroge sur qui fait les valises, les malles, et les réceptionne. Avec humour, elle se demande si l’époux de la célèbre aventurière Alexandra David-Néel lui préparait son sac.
Pour satisfaire ceux qui emportaient leur bibliothèque, Vuitton a inventé ( en 1911) une malle capable de contenir les 29 volumes de l’Encylopaedia Britannica, ainsi que la malle-bibliothèque ! Vive l’invention de la liseuse, des tablettes, mais les réfractaires vénèrent toujours l’objet livre.
Les femmes coquettes ont vu l’avènement du vanity-case, « croisement d’une cage de déplacement pour chat et d’une glacière de camping »! Elles vont pouvoir transporter leurs divers flacons, leurs produits de beauté ( l’incontournable cold cream), leurs parfums.
Quand se développe la tendance au « pique-nique », les mallettes, malles débordent « de porcelaine fine, d’argenterie.. ». Par exemple, la panoplie du maharaja de Baroda se compose d’un lunch-case et d’un tea-case ! ( bien pratique lors de ses chasses au tigre à dos d’éléphants, illustration à l’appui). Une note d’humour quand sont évoquées les provisions alimentaires pour trois jours des personnages de « Trois hommes en bateau » de Jerome K. Jerome. Une expédition qui convoque tout récemment celle relatée par Philibert Humm dans Roman fleuve.
La voyageuse décline son tropisme anglo-saxon, pour les adeptes des déguisements, citant des femmes comme l’américaine May French Sheldon, en route pour cartographier le lac Chala, en 1871. L’illustration la représente dans une tenue d’apparat ( « tunique de soie brodée de pierreries »), avec un baudrier d’où pend une épée et un poignard destiné au décolleté.
On a plaisir à croiser une pléthore de personnalités ( Malraux, Morand, Michaux, Cendrars, Chatwin, Jane Austen, Lawrence, Eco ( et son saumon), A. Londres…, impossible de tous les citer) ainsi que des auteurs contemporains comme Sylvain Tesson, Franz Bartelt. On frissonne à l’idée que l’on pouvait entendre glapir un ou plusieurs passagers clandestins au-dessus de sa tête dans un avion ! Pratiques révolues.
C’est d’un autre clandestin dont il est question, quand nous est révélé la cavale de Carlos Goshn ! Comment a-t-il pu survivre dans cette malle ! Des secrets sont dévoilés. D’autres faits divers sont évoqués, comme « la tonitruante affaire baptisée Air Cocaïne » !
La globe-trotteuse dispense quelques conseils pour faire sa valise de façon efficace, méthodique, mais cela implique de consentir à quelques exercices sacrificiels ! Les valises à roulettes sont décriées par certains. Depuis l’invention de « cette immonde chose », en 1970, la nuisance sonore est insupportable, « hachant les nuits citadines ».
L’écrivaine, qui a beaucoup voyagé, confie aimer arpenter le globe en solo et glisse à la fois des souvenirs personnels et de savoureuses anecdotes exhumées de ses nombreuses lectures. Hélène Honnorat signe un livre divertissant, dense, d’une grande richesse, doté d’un double intérêt. Il suscite l’envie de lire les ouvrages cités ( d’y faire des escales!) et de voyager !